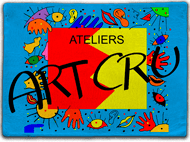Benjamin BERBUDEAU
L'expression créatrice analytique
L'expression créatrice analytique
présentation par Guy LAFARGUE

Psychologue clinicien, Psycho-sociologue,
Docteur en Sciences de l'Éducation
Fondateur et directeur des Ateliers de l'Art CRU
@
L’EXPRESSION CRÉATRICE ANALYTIQUE © est une nouvelle discipline dans le champ des sciences humaines et des pratiques médiatisées du développement de la personne ou de l’accompagnement thérapeutique offert aux personnes dans le cadre des pratiques analytiques privées et dans le cadre des institutions de soin.
Fondateur de ce courant de recherche, j’ai créé les termes d’ EXPRESSION CRÉATRICE ANALYTIQUE en 1994, en relais de l’ appellation plus connue d’ Ateliers d’Art CRU, que j’avais inventés en 1984, qui ont servi à désigner à la fois une pratique singulière de l’expérience créatrice dans un cadre centré sur l’expression de la personne, et le nom de l’Association destinée à promouvoir leur développement dans la vie sociale. Ils constituent l'outil pédagogique, culturel et/ou thérapeutique que j’ai élaboré et développé pendant 40 ans. Elle est déjà largement répandue en France, en Suisse francophone et en Belgique.
Les termes d’ "Art Cru" sont eux-mêmes l'idéogramme d'une orientation de travail centrée sur l’expérience créatrice dont les axes éthique, méthodologique et théorique sont inscrits dans la Charte des Ateliers d'Art CRU que le lecteur trouvera exposée à la fin de ce texte. Cette Charte constitue l'élément identificatoire et fédérateur des praticiens de cette discipline.
L'Art CRU n'est ni un mouvement artistique, ni un mouvement philosophique, ni une orientation culturelle de l’expérience créatrice, mais un cadre praxique, théorique et technique, pensé pour favoriser l'expression créatrice de la personne, et pour répondre aux demandes de transformation constructive et dynamique de son lien au monde.
Les Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques mettent en synergie :
- L'engagement des personnes dans une expérience soutenue d'expression personnelle dans les langages de la création. Cet engagement se développe au sein d’un cadre construit, et dans une dynamique de groupes restreints. Elle peut se développer dans une dynamique d’accompagnement analytique individuel.
- La pratique rigoureuse par l'animateur d'une certaine qualité de travail avec la parole qui permet aux personnes qui s’engagent dans ce mode d’expérience personnelle : de vivre de façon confiante la traversée de ces temps d’expression. Elle leur permet d'intégrer les événements subjectifs liés au travail de découvrement qui accompagne toute expérience créatrice authentique, d'en assimiler les effets dynamiques (ce que nous appelons les “effets de sens“) et d'engranger les bénéfices de la compréhension des tensions et souffrances personnelles qui sont à la fois causes et effets des invalidations pour lesquelles les personnes demandent à vivre et à expérimenter un cadre de cette nature.
L’expérience créatrice est un mode d’expérience puissant de changement de la personne dans la compréhension de son histoire, dans la modification positive de ses attitudes dans ses relations à l'autre, dans les rapports qu’elle entretient avec le monde social, et dans les liens avec les acteurs des institutions dans lesquelles ils travaillent.
Expression Créatrice Analytique
Le terme analytique est pris ici à son sens culturel commun de mise en mots, de communication et de clarification des différentes dimensions qui constituent l'expérience vécue par les participants pendant le temps de l’Atelier consacré à l’expression créatrice.
Le terme analytique désigne la mise en travail d’énonciation, d’élaboration et de régulation des résonances et émergences affectives, émotionnelles et psychiques qui accompagnent nécessairement tout engagement authentique dans une expérience créatrice, quel qu'en soit le cadre : éducatif, d’accompagnement psycho-social ou thérapeutique .
C'est cette dimension essentielle de notre protocole - demise en tension de l’expérience créatrice vers une parole énonciatrice de l’expérience vécue pendant les temps de création- qui nous fonde à décerner à cette discipline le qualificatif d’analytique.
Expression Créatrice analytique :
éducation æsthétique et formation culturelle
Discipline autonome dans le champ des praxis du changement, l'Expression Créatrice Analytique est centrée sur l’expression de la personne dans les langages de la création. Cette discipline s’exerce :
- Dans le cadre de la formation æsthétique généralede la personne. Le terme æsthétique est pris à son sens étymologiqued'expérience sensible, associé, pour ce qui nous concerne ici, à l'expérience créatrice qui est au fondement même de l'expérience culturelle.
- Dans le cadre d'une formation à l'éducation créatrice respectueuse des capacités innées de l'enfant à vivre harmonieusement son lien au monde. Ce potentiel reste également présent et mobilisable en chaque adulte, quel que soit le degré d'invalidation objective ou subjective où celui-ci se trouve placé dans son existence,
- Dans le cadre de la remobilisation des ressources toniques affectives, émotionnelles et imaginaires et du soutien de la socialité des personnes en rupture provisoire ou prolongée de lien social, dans une démarche respectueuse de la souffrance affective singulière à l'origine des grandes situations d'exclusions de toutes natures : handicap d'origine organique ou psycho-sociale (vieillesse, privation légale de liberté, privation prolongée d'emploi, ségrégations ethniques, prévention de la délinquance, maladies évolutives...).
Expression Créatrice analytique
et pacte thérapeutique
Les Ateliers d’Expression Créatrice Analytiquess'exercent de façon privilégiée dans le cadre du soin affectif/psychique apporté aux personnes, enfants, adolescents et adultes, en travail ou en nécessité d'entreprendre un travail d’analyse thérapeutique, faisant ou non l’objet de soin en institutions psychiatriques.
Nous désirons rendre compte ici de deux confusions dommageables entretenues à la fois par la vulgarisation culturelle des sciences psychologiques, par l'idéologie comportementaliste que nous combattons et par certaines dérives de la psychanalyse appliquée.
La première confusion porte sur l'assimilation qui est faite des manifestations émotionnelles et affectives comme étant ce qui inscrit l'ordre du " thérapeutique" au cœur d'une activité de cette nature. Ce point de vue est réducteur. Les effets de l'expérience créatrice sont exactement les mêmes, sont de même nature, dans un Atelier à visée éducative que dans un Atelier à visée thérapeutique. C'est la façon de traiter ces événements manifestes du vivant qui changent selon le pacte conclu avec le client.
Ce qui est "thérapeutique",ce ne sont pas les effets du processus de création, quel que soit le cadre de référence du professionnel de l'analyse, mais c'est le contrat (le pacte) passé entre un sujet demandeur d'un soin analytique et un professionnel qui offre sa compétence analytique dans le traitement médiat de la souffrance affective ou émotionnelle du sujet et dans la recherche active de son origine . L'engagement solidaire des deux partenaires dans le projet du soin analytique est ce qui se désigne du nom de thérapeutique . Cette compétence du thérapeute et de son client s'exerce de manière spécifique sur l'analyse des liens subjectifs qu'ils établissent entre eux dans la situation actuelle qui les réunit comme lieu de représentation dans les langages de la création des liens originaires source de souffrance et d'invalidation.
L'expérience créatrice n'est "thérapeutique" que pour autant qu'elle s'inscrit dans un pacte posé comme tel par les deux partenaires de l'aventure analytique . Ce qui spécifie en tant que telle la fonction du thérapeute, c'est l'engagement entier de son intelligence, de sa sensibilité et des savoirs qu'il a acquis de l'expérience pour apporter à son « client » sa part de contribution personnelle à la clarification du sens des événements singuliers et des processus émergents de leur lien unique. La notion d' "effets thérapeutiques" destinée à justifier des pratiques émotionnelles et psychiques manipulatoires est une notion-écran destinée à masquer le manque aux exigences spécifiques du travail analytique/thérapeutique.
L'autre confusion vient des méthodes de la psychanalyse appliquée, c'est à dire par des agencements de dispositifs de la part de psycho-analystes qui, sans modifier le point de vue de la cure à partir duquel ils opèrent, récupèrent et "utilisent" le processus créateur de façon auxiliaire. Ces praticiens récusent l'expérience créatrice comme étant le lieu nucléaire du travail de changement du sujet. Ils se servent du cadre des Ateliers d'Expression Créatrice comme adjuvant thérapeutique, en en détournant les principes opérants au service du travail associatif et de l'interprétation posés comme centre opératoire. Ces psycho-analystes abandonnent ce qui est au fondement de leur praxis – la médiation psychique - pour la médiation artistique/culturelle, sans modifier le point de vue opportuniste et utilitariste à partir duquel ils opèrent. Ils clivent leur discours entre ce qui serait d'un coté " le thérapeutique" et de l'autre "le créatif" tenant sur ce point le même discours que les comportementalistes tiennent sur "la créativité". L'expérience thérapeutique est, par essence, expérience créatrice, ou elle n'est pas.
Formation de praticiens
d' Ateliers d' Expression Créatrice Analytiques
Les formations de praticiens que nous dispensons dans ce domaine visent à développer chez les personnes en formation la capacité de construire les cadres et les dispositifs spécifiques à cette discipline, à accompagner les effets d'émergence des fragments de la vie affective de la personne, les manifestations émotionnelles qui en jalonnent le cours, à soutenir les changements dynamiques dont ce type de travail est le catalyseur puissant; de conduire et d' accompagner le travail de parole où s'inscrit, s'élabore et s'enracine le travail du changement qui en est attendu.
La formation de praticiens d' Ateliers d’Expression Créatrice Analytiques est organisée pour permettre aux participants
- de vivre de façon significative pour eux-mêmes le travail de l'expression créatrice qu'ils proposeront ensuite à leurs publics,
- de conduire l'animation des Ateliers du groupe de formation,
- d'élaborer la théorie de l'expérience vécue de l'engagement dans le processus d'expression personnel aussi bien que celle de la fonction d'animation des séances du groupe de formation,
- d’apprendre à discerner et à conduire la compréhension les manifestations affectives groupales et de leur rôle dans l'émergence ou la rétention du travail de l'expression personnelle.
- de nourrir et de mettre en perspective ce travail d'élaboration conceptuelle au contact des travaux de praticiens/chercheurs dont les outils théoriques sont en grande proximité des options que nous prenons ici :
- Carl ROGERS pour ce qui concerne la dynamique de l'écoute active non-directive.
- Max PAGÈS pour sa théorie de "La vie affective des groupes"..
- Donald WINNICOTT pour ses théories du développement psycho-affectif et du jeu.
- Mélanie KLEIN pour sa contribution à la théorie générale de la vie f(ph)antasmatique.
- Françoise DOLTO pour sa contribution personnaliste à la connaissance du lien thérapeutique et pour sa théorie des "images inconscientes du corps".
- Arno STERN pour sa contribution fondamentale à la pratique de l'Éducation Créatrice et au dispositif de l'Atelier qu'il a inventé sous le nom du "Closlieu"
- Harold SEARLES pour sa contribution clinique et théorique à la problématique du contre-transfert.
- Jean DUBUFFETpour sa formidable création du concept et de la Collection d'Art BRUT , et pour son analyse esthétique incisive de l'art culturel ; et Michel THÉVOZ pour sa contribution soutenue au développement et à l'élaboration théorique de l’expérience de l'Art BRUT.
- Le mouvement surréaliste et la contribution particulière d'André BRETON à l'exploration de l'automatisme psychique appliqué aux processus de création.
Ces auteurs constituent le fond théorique commun invariant à partir duquel chaque formateur, selon ses inclinations vers la psychanalyse, la phénoménologie, la théorie des systèmes, vers l'art contemporain...introduit ses propres sensibilités théoriques.
@
Daniel Stern : Les enveloppes pré-narratives
Daniel Stern :
Les enveloppes pré-narratives
Approche des concepts de Daniel STERN
Commentaire de texte en papier recyclable
sur le modèle cognitivo-affectif de la formation de la pensée
d’après les travaux de Daniel STERN
rapportés dans le N° 14 du journal de Psychanalyse de l’enfant
dans les Actes du Colloque de Monaco
Guy Lafargue
@
Dans le cycle “Des théoriciens pour travailler”, je vais me livrer devant ton tendre miroir à ma psykastique préférée : rendre simple une pensée complexe sans pour autant en neutraliser les forces subversives C’est pas du tout désintéressé. Je me propose, dans les pages qui suivent, de te faire découvrir les facéties d’un créateur pleine peau dont la pensée m’a sauté le cortex au moment de terminer mon bouquin sur l’Écriture. Tu comprendras que si je me livre avec passion à cet exercice coûteux et ingrat, c’est d’abord parce que je t’aime, et ensuite parce que cet homme vient mettre de l’huile dans le feu de mon moulin à penser; et que je m’imagine de façon impudique que tu vas y trouver toi aussi matière à te lubrifier les neurones. C’est en lisant des types comme ça que ta propre psyché reste incisive et voluptueuse.
Daniel STERN est un type assez particulier. C’est un cumulard de la psychanalyse et des sciences cognitives. C’est un américain qui pense (y’en a) et qui suscite le respect de la part de ses frangins du cénacle freudien français (de ce qu’il en reste). Je vais donc bosser sous tes yeux ébahis dans la pure tradition de mes scriptations insolentes. Je vais travailler pour toi à désosser ces écritures compliquées pour te faire découvrir une pensée de traverse de haute densité intellectuelle et psychique que j’ai dégotée dans le n° 14 du journal de psychanalyse de l'enfant qui rapporte les actes du Colloque de Monaco.
Selon la théorie freudienne, la formation de la pensée serait issue du processus hallucinatoire de réactivation des traces mnésiques de satisfaction surgies de l'expérience de l'absence de l'Objet de satisfaction. Dans cette vision solipse, la formation des représentations psychiques est réactionnelle au manque. Toute la tradition freudienne et néo-freudienne, est en symbiose avec ce point de vue. A quoi t’ajoute la théorie du dénommé BION qui fait ronronner l’aéropage (un néo-kleinien, du siècle dernier) comme quoi la formation de l'activité de pensée est étroitement liée à l'introjection de la psyché maternelle.
Daniel Stern propose une toute autre théorie explicative des processus originels constituants de la réalité psychique du nourrisson, sous la forme du concept d' "enveloppe prénarrative " que l'éditorialiste du N°, Pierre Ferrari, désigne "comme forme fondamentale des manifestations psychiques du bébé ". Avec ce concept, Daniel Stern introduit de plain-pied la dimension affective dans la formation des processus cognitifs (territoire d'exercice de la pensée).
Pierre Ferrari introduit ainsi l'exposé de Daniel Stern :
" Il situe l'enveloppe prénarrative avant l'émergence du langage comme unité non fragmentée possédant un développement temporel, une structure cohérente avec sa signification, son scénario dramatique, sa motivation et ses moments de tension. Il s'agirait donc d'unités d'expérience subjective, premières formes de la pensée présentes dès la période prélinguistique, prenant appui sur des prédispositions innées, mais construites à partir de la réalité vécue par l'enfant dans son expérience intersubjective interpersonnelle ".
En introduction à son exposé, Stern rappelle d'abord ce que je crie depuis longtemps dans le désert, qu'il conviendrait de ne jamais oublier, que les théories sont des formations psychiques, des images. Et que ces images "déterminent et reflètent la façon dont nous envisageons les pensées, les fantasmes et les souvenirs de la petite enfance, ainsi que la façon dont nous conceptualisons les origines de la psychopathologie et certaines conclusions théoriques des reconstructions psychanalytiques ". Je défendais déjà ce même point de vue il y a 20 ans dans mon article célèbre “Théorie mon amour", à savoir que les théories sont des manifestes subjectifs, "des constructions hypothétiques" rappelle STERN à propos de la théorie freudienne de la formation de la pensée.
II propose ensuite de réfléchir sur l'idée d'une" unité de base de l'expérience subjective" qui nous permettrait de "constituer une clé révélant la structure de la réalité psychique et de servir de matériau pour conceptualiser la genèse et l'élaboration de ce monde subjectif" . Remarquons en passant que réalité psychique et monde subjectif sont ici équivalents.
Pour désigner cette "unité de base hypothétique de la réalité psychique infantile ", Stern propose le concept d' "enveloppe prénarrative ". De quoi s'agit-il?
Ce concept part de l'idée très simple, communément admissible, selon laquelle tout événement psychique se présente à la perception comme une narration,c'est à dire comme une sorte de récit, comme une séquence scénarisée, comme une sorte d' unité dramatique avec sa temporalité propre, avec les éléments de base d'une proto-intrigue tels qu'un agent, une action, un but, un objet, un contexte. En fait, comme un script, comme une représentation d'événement généralisé dit Stern. C'est à ce schéma d'événement ressenti, à cette unité de structure événementielle dont le sujet a perception que Stern donne le nom d'enveloppe prénarrative, ajoutant qu'une telle enveloppe "caractérise un aspect de la réalité subjective qui est principalement affectif (renforcé par moi), et cela, dès la naissance " .
Ces enveloppes prénarratives seraient des sortes de matrices structurales/ structurantes des formes mentales, imaginaires, que sont les formes psychiques à leur stade natif, génétiquement constituées dans/par le cerveau humain. Et c'est à la conjonction, ça c'est moi qui l'ajoute, de cet aspect affectif de l'impact événementiel et de la capacité psycho plastique de l'appareil neurologique à transformer des sensations en trace/images qui serait à proprement parler la fonction psychique. En définitive, le célèbre aphorisme de Lacan selon lequel "L'inconscient est structuré comme un langage" prend ici une tout autre signification que Lacan n'avait peut-être pas prévue, comme quoi, le langage, c'est à dire le matériau symbolique/psychique en lequel le Réel se représente dans une forme abstraite, est structuré par l'inconscient, c'est à dire par les matrices prénarratives.
Les caractéristiques importantes de ces enveloppes prénarratives sont les suivantes:
- elles se manifestent "avant l'émergence du langage ou des aptitudes à la production narrative" , c'est pour cela qu'on les nomme "prénarratives ";
- elles peuvent être décrites comme des "contours de changements dans le temps, décrivant une trajectoire dramatique de tension ". C'est à dire comme des structures d'action : préparation, engagement, résolution, latence;
- "elles s'adaptent à la plupart des structures essentielles à la narration. C'est l'unité à partir de laquelle la narration, transposée, va émerger";
- ce sont des "facteurs innés qui déterminent les limites et le contenu possible d'une enveloppe prénarrative. Ces prédispositions innées jouent un rôle essentiel en déterminant quelles constructions mentales peuvent être tirées de l'expérience". Cela expliquerait par exemple l'universalité des figurations mentales archétypales ;
- elles sont une "construction mentale à partir de l'expérience du monde "réel" qui émerge de l'expérience subjective";
- "ce n'est pas une structure innée ni la réédition par le moi d'une telle structure" ;
- elles sont une propriété émergente de l'expérience subjective de l'enfant, avec des pulsions issues d'un contexte interpersonnel. Les apports psychiques maternels ne constituant dans cette perspective que des modulations des flux psychiques émergents, des influences parmi d'autres, privilégiées certes, mais non fondateurs de l'organisation psychique endogène.
Cette perspective ouvre incontestablement sur la phénoménologie psychique un point de vue déviant incorporant des points de vue fondés à la fois sur certaines données de la méta-psychologie (concernant les phantasmes originaires par exemple), et sur des données actuelles des neurosciences et de l'éthologie en conflit avec elle.
D'elle peuvent se déduire les plans de fonctionnement où se trament les formations psychiques:
- La sensation, les ressentis sensoriels et pathiques, et les éprouvés affectifs originaires constitutifs du Réel selon Lacan.
- Les images - l'Imaginaire selon Lacan - construites à la croisée des traces sensorielles et des marqueurs affectifs.
- Les concepts, le Symbolique selon Lacan, qui sont des formations mentales dérivées du travail d'abstraction des images, décontextualisées aussi bien de la sensation que de l'affect.
- La perception enfin - fonction du Je - comme agrégation en ensembles signifiants unifiés d'éléments initialement rencontrés de façon chaotique, s'exerce sur ces trois plans issus du Réel, de l'Imaginaire et du Symbolique.
Pourrait-on risquer en cet instant de dire que la pensée et la perception sont une seule et même fonction, la pensée s'exerçant sur l'articulation signifiante, coordinatrice, d'un ensemble de sensations/perceptions hétérogènes constituant l'expérience globale, organismique, du sujet à un moment donné de son expérience vécue, par où elle devient, justement, narrative ?
La pensée, enfin comme activité émergente devant une instance, le Je, en prise sur les processus de figuration imaginaire ou conceptuelle.
Daniel Stern précise que "des facteurs innés (donc liés à l'organisation neurologique) déterminent dans une large mesure les limites et le contenu possible d'une enveloppe prénarrative ". La formation des enveloppes prénarratives obéirait donc à des patterns de figuration relativement stables et adaptés aux situations existentielles centrales. Ces patterns ne sont pas déjà là, tout prêts, ils se construisent.
En outre, nous dit Stern, l'enveloppe prénarrative "apparaît sous la forme d'un mouvement vers la cohérence, en phases successives (souvent passagères) de multiples esquisses, constamment révisées . ..,', et qui ne doivent pas nécessairement atteindre un stade final de fixité, de cohérence, mais uniquement une ou deux esquisses courantes à partir desquelles il serait possible de travailler".
Je ne puis m'empêcher ici de faire remarquer que cette théorie - d'un mouvement vers la cohérence soutenu par la pulsion, associé aux enveloppes prénarratives - confirme de façon spectaculaire les hypothèses de Carl Rogers sur le travail thérapeutique conçu comme travail d'élargissement de la perception, comme travail de la pensée émergente soutenue par" la tendances à l'actualisation du soi", appliqué à la clarification de l'expérience vécue ici-et-maintenant dans la communication non-directive). Stern ajoute qu' "une grande partie de ce que nous considérons comme des pensées est constitué en fait de fragments en processus d'émergence ".
L'élément, si j'ose dire fédérateur, de cette activité dispersée d'esquisses, d'ébauches narratives multiples, qu'est l'activité de pensée en mouvement vers la cohérence, est assuré par la pulsion. Selon Stern, et je partage sans réserve ce point de vue, c'est la pulsion "qui est supposée assurer la création (ou plutôt la préexistence) d'une cohérence narrative ".
La pulsion, même modulée par l'affect, est le substrat organisateur de la pensée, même si ce n'est pas elle qui attribue une signification aux événements vécus, qui est le rôle génétiquement attribué à la pensée, au psychisme: "Seul le psychisme, nous dit Stern, par la pensée et la construction, peut créer une signification. Les pulsions, elles, peuvent donner une structure aux événements, mais c'est "la pensée" qui confère une cohérence subjective et une signification". Ça, il faut se le caler dans la psyché: les significations, l'activité de signifier propre à l'être humain, n'est pas donnée par la pulsion (agissant selon la psychanalyse par l'intermédiaire du Moi) mais par la pensée. "Il n'y a pas de signification de base (d'un point de vue subjectif) dans notre nature psychobiologique ou psychosomatique ".
La signification est un acte de pure création . Il n'y a de signification que subjective. La signification ne se révèle pas, elle se constitue. " Les instruments du moi, ou la “pensée” ", n'ont pas de signification inhérente à révéler, à découvrir ou à transposer. Leur fonction est plus purement "créative ", puisqu'elle consiste à fabriquer une signification subjective à partir de l'ensemble impressionnant d'événements (pulsions incluses) qui constituent notre expérience vécue ".
La pensée a pour fonction centrale l'attribution d'un sens à ce qui se passe: "Le moyen le plus universel que la pensée s'octroie pour donner un sens à ce qui se passe est d'utiliser l'unité désir/motivation/but pour créer des propriétés émergentes telles que les récits ou les enveloppes prénarratives afin de donner cohérence à l'expérience "
"Les pulsions, nous dit Stern - engendrent des événements récurrents répondant à un schéma et constitués d'épisodes internes et externes. C'est en grande partie à des motivations programmées de manière innée que ces événements doivent leur structure et leur organisation" .
Dans cette perspective alternative à celle de la psychanalyse, les phantasmes originaires ne seraient pas des représentants de pulsions mais des créations prépsychiques, des protopensées progressivement constituantes du Moi. C'est la séparation entre une pensée et une psyché qui est abolie. Là où, pour la psychanalyse existe un Moi qui structure des pensées dérivées des pulsions, la perspective constructioniste de Stern aboutit à comprendre le Moi comme construit des formations psychiques. Expérience psychique et expérience du Moi sont une réalité dynamique unique.
Le Moi de la métapsychologie freudienne serait en fait une sorte d'assemblage synthétique fait de narrations multiples, cohérentes entre elles et avec l'expérience vécue, la pulsion jouant dans cette synthèse la fonction actuelle d'organisateur de la représentation sous le contrôle (virtuel) de la partition génétique. L'actuel, dans le monde psychique, est déterminé par le virtuel, et non par le résiduel. Ce n'est pas le passé qui constitue la narration mais la narration qui établit le passé C'est le virtuel de la partition génétique qui constitue l'organe immatériel que l'on appelle la conscience, ou le "Je", où s'inscrivent les événements internes et externes et où se dessinent et se décident en dernier ressort les programmes comportementaux.
Dans le plan psychique, c'est le virtuel de l'actualisation de la programmation génétique, et les écarts entre le virtuel et l'actuel événementiel, qui déterminent les directions et les mouvements mentaux, et non le résiduel. C'est dans l'instant de la création que se constitue l'historicité et non dans l'histoire advenue. Cette position est antinomique à celle de la métapsychologie psychanalytique et en synergie avec la dynamique non-directive rogérienne.
Ces paradoxes vont être d'une très grande importance pour notre conception de la clinique analytique et de la conduite du travail thérapeutique, où nous avons a rendre compte des déterminants psycho-affectifs qui structurent notre action, c'est à dire des figures narratives créées dans laprécarité et l'urgence du drame analytique ou empruntées de façon prothétique aux créateurs qui ont eu à faire avant nous ce travail inaugural.
@
Cette perspective referme sans ambiguïté l'hypothèse d'un Moi préexistant à la pensée et ouvre celle d'une activité de figuration mentale - imagination et/ou pensée - inhérente au fonctionnement du cerveau possédant des propriétés essentiellement émergentes sous contrôle permanent de la perception consciente et infra consciente (et de la pulsion, nous y reviendrons), et ce, dès la naissance, et probablement dès l'expérience fœtale elle-même.
"L'expérience, nous dit Stern, autrement dit l'aspect subjectif de ces phénomènes innés. (renforcé par moi) ne suppose pas une expérience préalable avec l'environnement ". Autrement dit, l'expérience est toujours formation subjective, c'est à dire située dans le champ de la perception. Le subjectif est toujours perception d'un perçu/éprouvé/ressenti. Il n'y a pas de subjectivité non perçue, inconsciente. Il n'y a pas de pensée latente. Il n 'y a toujours que des pensée successives, émergentes traitant d'une donnée immédiate de la perception. L'activité de penser est une activité actuelle de traitement mental de l'ensemble des informations sensorielles, émotionnelles, spatio-temporelles, pulsionnelles, idéelles, qui assiègent en permanence l'organisme en réponse aux sollicitations internes, pulsionnelles, et aux provocations de l'environnement:
"Différents événements et émotions sont réunis comme autant d'éléments nécessaires à un événement unique et unifié qui adopte une forme de structure proche de la narration. L'enveloppe pré narrative est justement une telle propriété émergente de la pensée ".
"La pensée est une propriété indépendante du cerveau. La pensée s'applique à tout ce qui est vécu y compris l'acte de penser. Elle n'est pas engendrée par ces états de pulsion ; elle constitue plutôt le milieu mental constant où la vie instinctuelle a lieu; et les enveloppes prénarratives qui en émanent sont des propriétés émergentes de la pensée qui organisent les différents ensembles d'expériences occasionnées par les activités des pulsions . "(renforcé par moi)
Production de formes d'expérience subjective - d'unités narratives - au sein d'une multiplicité de centres d'analyse des états existentiels - unités d'expérience vécues - sous contrôle des structures génétiques; unités narratives construites à partir de la perception des écarts entre le virtuel potentiel (le programme génétique), le résiduel immédiat (la trace de la sensation marquée d'affect) et l'actuel (la sensation immédiate), et conjonction de processus parallèles locaux liés à chacun des centres d'analyse: voilà ce qu'est la vie psychiqu e. Ce sont ces écarts entre "mémorats" (trace mnésiques marquées d'affect) et sensation immédiate, répétés de façon stable au sein de séquences invariantes (la répétition des soins corporels par exemple) qui constituent les matériaux primaires utilisés par le cerveau pour la formation de prototypes abstraits que sont les enveloppes prénarratives. "C'est la constellation spécifique d'éléments invariants, pris tous ensemble, qui constituent l'unité d'expérience". "Le processus de formation d'une enveloppe prénarrative en tant que catégorie d'une expérience vécue implique déjà une forme précoce d'abstraction "
Un autre aspect crucial de la réflexion sur l'activité psychique porte sur ses différents constituants associants productions imaginaires (émergentes) et souvenirs d'événements (récurrents) liés à la mémoire et au rappel. Les souvenirs sont des expériences imaginaires fixées en engrammes, de narrations stables (la mémoire), sortes d'incrustations bioélectroniques d'ensembles événementiels équivalents au process d'incrustation, de gravure d'un compact disc : " En tant qu'expériences imaginaires. les souvenirs sont toujours associés à l'expérience concrète en cours, ces deux formes d'expérience constituant conjointement la réalité psychique de l'enveloppe prénarrative ".
"Enveloppes prénarratives et souvenirs"
Une autre dimension de l'activité imaginaire, par où l'illusion de l'existence d'un inconscient psychique est favorisée, tient aux processus d'évocation des objets psychiques, de ce qui s'est constitué comme tel en une sorte de banque de données psychiques constituée des dépôts psychiques mémorisés. En effet, si l'on reprend le mouvement par lequel se constituent les enveloppes narratives, certaines narrations par le caractère de fort investissement affectif qui s'y attache vont se fixer en objets psychiques comme tels, c'est à dire acquérir le statut d'objets concrets pour la perception (à l'œuvre dans le délire et l'hallucination). A ce titre, ils acquièrent le statut de souvenirs et sont mémorisés comme tels, et mobilisables au gré du travail des pulsions. Ce sont ces objets imaginaires qui se condensent de façon spectaculaire dans le travail du transfert.
Ainsi, la vie psychique peut être considérée comme composée de deux sortes d'éléments entrant en composition créatrice en proportions dictées par la qualité émotionnelle et l'urgence affective des sollicitations actuelles:
- les narrations actuelles, émergentes, liées à l'activité pulsionnelle en prise avec la réalité (les rêveries, les fantaisies, les contes, les rêves nocturnes, le jeu de création),
- les narrations mnésiques liées aux objets psychiques, tels qu'ils se manifestent dans le transfert, dans lesquelles le sujet utilise des structures actuelles pour répondre à des investissements affectifs anciens liés aux premières relations d'objet (les fantasmes, les rêves nocturnes).
Les enveloppes prénarratives fonctionneraient alors comme matrices structurales de la formation des scénarios psychiques actuels, utilisant les matrices affectives dont le sujet dispose liées aux objets originaires pour structurer la relation pulsionnelle aux objets actuels appelées par l'intensité pulsionnelle actuelle. C'est ce que je veux dire lorsque je dis dans mon jargon que la pulsion est maquée par les signifiants.
C'est donc dans le jeu entre activité pulsionnelle dirigée vers un but (libidinal ou social) et investissement affectif que se construisent les narrations psychiques . La vie psychique n'est que la résultante de ce jeu, dont la fonction est d'informer en permanence le Je de l'état de satisfaction ou d'altération des visées organismiques représentées dans et soutenues par le jeu pulsionnel.
Et la conséquence de ce point de vue sur la conduite des situations de changement de l'économie psycho-affective de la personne dans l’expérience analytique dans les groupes de développement personnel, de formation ou de thérapie, est majeure, puisque c'est l'axe même du cadre, la conception du dispositif et des modes d'intervention du praticien/analyste qui vont induire ce qui est susceptible de s'y dérouler:
- axé de façon prévalente sur la dimension périphérique et prothétique de la narration (le pur jeu "sur" les narrations psychiques) comme cela est le cas dans la psychoanalyse,
- axé sur la mobilisation des matrices affectives et le jeu pulsionnel médiatisé par les langages de création, y compris de la narration psychique comprise comme jeu créateur. Par où nous sommes ramenés à notre préoccupation première: l'expérience structurée de l'écriture créatrice.
@
"Enveloppes prénarratives "
et formation des f(ph)antasmes
Dans la perspective exposée par Daniel Stern, le fantasme consiste en la "refiguration d'expériences vécues représentées". Il est fondé sur le principe de la "représentation analogique“
La représentation analogique est "un mode de représentation intermédiaire entre une expérience vécue dans la durée réelle" et"une abstraction complète sans durée vécue ". "Seuls sont choisis pour être représentés des segments déterminés de l'enveloppe prénarrative". Ces segments d'expérience élus pour constituer les enveloppes prénarratives précoces le sont en fonction d'investissements à la fois sensoriels/sensuels et affectifs.
Cette conceptualisation est particulièrement abstraite. Il me semble qu'en l'illustrant d'un exemple concret nous pourrions mieux comprendre ce qu'il en est. Personnellement, je n'ai pas à ma disposition de travaux d'observation des interactions précoces mère/nourrisson, mais par contre, j'ai les observations faites dans le travail analytique avec quelques adultes agissant dans la relation intertransférentielle des éléments archaïques de cet ordre, qui me permettent une reconstruction de ce jeu avec les signifiants fondamentaux de la relation bouche/sein et de sa constitution en phantasme.
Si l'on prend l'expérience précoce de l'allaitement au sein, que se passe-t-il au plan de l'élaboration de l'enveloppe prénarrative de l'expérience bouche-mamellon et de la constitution de cette séquence en f(ph)antasme lors des avatars de sa réalisation?
Au cours d'une relation normale, l'expérience vécue se déroule selon la séquence temporelle suivante:
- épuisement des ressources énergétiques endogènes
- déclenchement des signaux métaboliques du comportement nutriciel
- rupture du cycle du sommeil/éveil/éprouvé de la faim/enclenchement de la pulsion orale
- formation du désir/motivation vers le sein
- manifestations gestuelles/vocales d'injonction à la présentation de l'Objet (object présenting)
- apparition vocale/visuelle/gestuelle de la mère
- manipulation du corps, prise dans les bras (holding).
- désangoissement
- don/accès au sein/prise orale
- succion/afflux du lait
- expériences sensorielles du contact bouche/sein/langue/cavum/lait
- expériences sensorielles: tactiles (préhension buccale, manuelles), visuelles/ sonores (regards fusionnés, paroles de la mère/babillages), kinesthésiques (éprouvés du portage), cœnesthésiques (travail des organes internes) - satiété,
- excorporation de matières/soins corporels (handling )
- endormissement.
Pour le bébé, l'expérience objective et la séquence comportementale adéquate se déroulent en quatre temps: éveil, attente/appel, résolutions pulsionnelles (absorption, excrétion), endormissement/régression. Comment ces unités d'expériences objectives se transforment-t-elle en "enveloppe prénarrative " (en unités d'expérience subjective), en représentations psychiques et en phantasmes?
Si l'on parvient à une description claire et adéquate des processus de passage de l'expérience physiologique/comportementale à la figuration mentale qui rend compte du vécu subjectif, c'est la compréhension de la vie psychique dans son ensemble qui est susceptible de se clarifier.
Si j'ai bien compris les hypothèses de Daniel Stern, une telle séquence va donner lieu à l'élaboration d'un certain nombre d'enveloppes prénarratives, coexistantes entre elles, coalescentes, concernant:
- les stimuli sensoriels et communicationnels liés à l'environnement maternel : (éveil/attente/signaux d’appel/approche)
- les sensations posturales liées à la réalisation pulsionnelle
- les sensations érogènes orales liées au processus de satisfaction
- les sensations somatiques incidentes
La répétition de chacune de ces séquences va très rapidement donner lieu à la construction d'enveloppes prénarratives stables associant certains segments combinés retenus pour leur intensité affective, par exemple :
- une qualité du sentiment de sécurité lié à l’état d’être tenu dans les bras + une qualité du flux du lait dans la bouche + une qualité sonore de la voix de la mère.
Ou bien : - une expérience d'angoisse liée au retard de l'arrivée de la mère + une frustration pathogène liée au retrait prématuré du sein avant la réplétion + un affect d'intense colère.
Ou bien : - le remplacement brutal et intrusif du sein par un biberon + un comportement sadique de la mère envers le corps du bébé + un affect de dépression ou de violence émotionnelle.
Chaque unité subjective d'expérience va s'inscrire comme mémoire stable, comme schème affectif liant sensation/émotion/affect comme enveloppe prénarrative. Et chaque nouvelle expérience va être abordée, anticipée par ces contenus de mémoire. Une formation mnésique vient s'inscrire comme sensation en tant que telle dans le continuum sensoriel, avant même le déclenchement de la séquence comportementale. Le sujet aborde chaque nouvelle expérience avec une représentation pré-structurée, subjective, construite par l'expérience vécue antérieurement, à partir de moments érotiques ou pathiques. Stern précise que de nouvelles expériences sont susceptibles de remanier ces protoreprésentations. Ce sont ces traces mnésiques, ces mnésies comme je les ai moi-même nommées, qui constituent les prototypes psycho-affectifs qui vont servir de matrice pour l'élaboration phantasmatique aussi bien que pour l'élaboration créatrice.
Comment s'effectue le passage de l'enveloppe prénarrative à la narration phantasmatique et quelle fonction cela a-t-il dans l'économie développementale ? Et comment travailler à la résolution traumatique des stases affectives/émotionnelles ayant accompagné certaines expériences traumatiques par où la narration est devenue phantasme, c'est à dire lorsque des objets psychiques deviennent des équivalents d’objets de la réalité?
@
J'illustrerai l'intérêt de ces questions par deux exemples empruntés à mon travail d'analyste, tous deux intégrés à un scénario unique :
Au début de son engagement analytique, ma cliente, Érynie, entrait au bout de quelques minutes dans des états de fureur incoercibles, et elle attaquait tout ce qui ressemblait à du tissu dans mon cabinet. Au début, c'étaient surtout les rideaux qui étaient suspects, puis les tentures murales, qu'elle essayait de déchirer avec les ongles. Et elle y parvenait parfois. Angoisse extrême et fureur auxquelles je répondais par une contention physique intense et extrêmement vigilante, car elle passait sans transition du tissu à ma peau. Au bout d'un certain nombre de séances, je compris que les tissus cachaient des bêtes terrorisantes, des souris.
Et puis quelques mois plus tard, à la suite d'une séance, elle fit un rêve (nocturne) dans lequel au début du rêve, elle et moi nous trouvions de part et d'autre d'un guéridon sur lequel je m'apprêtais à servir le café. Et se superposait alors à moi, dans son rêve, la personne de sa maman, inclinée au dessus du guéridon, de telle façon qu’ Érynie voyait sous le chemisier la poitrine de sa maman couverte de caca. Dès l'instant où j'avais entendu prononcer le mot café s'est instantanément imposé à moi le verlan fait caca. Je compris alors que le tissu, segments d'un enveloppe prénarrative, était à la fois ce qui renfermait de l' extrêmement mauvais (la poitrine de la mère remplie de caca) et contenait du trop douloureusement attirant, le mamellon/souris, arraché de la bouche. Pour finir je comprends et le lui communique ainsi que le sein de sa maman est ce qu'il y a de plus désiré et de plus dangereux à éprouver ici dans sa relation à moi. Je donne forme dans une parole à un contenu de pensée qui reconnaît simplement ce qui est exprimé dans l'agir, qui est alors possiblement assimilable ; sur l'unité d'expérience subjective de type hallucinatoire dans laquelle la relation sein/bouche est représentée comme expérience traumatique.
Le deuxième scénario hallucinatoire, qui complète le premier, se résume en une injonction qu'elle me communique à certains moments de particulière violence de la pulsion orale ou elle me dit "Ma bouche est dangereuse",."Arrache ma bouche!". Ou bien “ Arrache ma langue !”. Ou bien : “ Je vais tuer ta bouche !”. Ce que je perçois/comprends à un moment donné, c'est exactement ceci : que la séparation de la bouche et du sein est phantasmatiquement représentée comme une plaie/douleur insoutenable liée à la perte/absence du mamelon vécue comme arrachement organique et rupture de l'unité symbiotique bouche/sein. La narration est stable, l'enveloppe prénarrative solidement constituée.
Comment cette expérience originaire du lien au sein se transforme-t-elle en persécution, en éprouvé du sein comme éprouvé de danger de mort ? Et comment cette matrice prénarrative génère-t-elle des représentations psychiques organisées autour de la phobie du tissu ? Par quel jeu de déplacements analogiques la pulsion orale en vient-elle à se représenter comme phantasme de destruction? Et comment le travail de l'expression créatrice analytique opère-t-il pour conduire le client de l'agir phantasmatique à la décharge affective puis à la pensée par où une distance objective à l'expérience ancienne devient possible?
Tel est pour moi le véritable défi de la situation analytique : de créer un espace où puisse jouer le processus par lequel le pur affect puisse s'exprimer (ici expression physique de la colère du client et contention structurante du thérapeute, là expression créatrice au travers de la représentation de l’objet dans la création), s'énoncer dans le mouvement-même de son expression (" Ma bouche est dangereuse"); et, au terme de la décharge affective subjectivement mortelle (et objectivement dangereuse si je relâche mon attention) conduite à son terme émotionnel et résolutoire et se former la perception concrète par Érynie de mon intégrité émotionnelle et physique au sortir de cette épreuve par où, à mon avis, s'ouvre une nouvelle enveloppe prénarrative détoxiquée de l'angoisse de mort par où le sujet peut commencer à élaborer une nouvelle narration, une nouvelle pensée de l'événement. Ce qui est le cas. En fin de séance, se produit spontanément une métacommunication sur ce qui vient d'être vécu, une mise en mot de ce qui vient de se passer, une création narrative nouvelle dans laquelle les paramètres affectifs sont fondamentalement satisfaisants. Érynie peut alors dormir en mon absence. Je lui accorde une vingtaine de minutes de sieste à la fin de chaque séance, pendant laquelle elle dort profondément, ce qui lui arrive rarement chez elle. Et parfois elle rêve.
Je veux dire que dans la structure thérapeutique/analytique que j'ai construite, le mouvement va du transfert (affectif) vers l'évocation phantasmatique et l'expression émotionnelle et physique dans une lutte corporelle/émotionnelle conduite à terme de façon satisfaisante et génératrice d'un travail d'élaboration psychique. Dans ce jeu, dans l’hallucination de leurre maternel dont j'assume la forme, ce qui à mon sens permet l'ouverture de nouvelles enveloppes prénarratives, c'est que fait métaphore (représentation analogique) le holding musclé que je suis mis en demeure, sous peine de mort, d'opposer aux attaques meurtrières d'Érynie, qui perçoit très bien à travers sa fureur que je suis un contenant fiable, étanche et non coercitif. Elle fait, dans une identification transférentielle massive, une nouvelle expérience affective satisfaisante du portage et du nourrissage symbolique qui parvient à déconstruire, à disjoncter les enveloppes prénarratives traumatiques, les signifiants originaires. C'est à partir de là que quelque chose de l'ordre d'une réelle formation psychique, qu'un fonctionnement de la pensée créatrice s'ouvre et peut-être s'enracine, constructeur d'identité là où n'existait qu'une béance mortelle.
@
Nous nous sommes provisoirement éloignés en apparence de la question de l'écriture. pour faire détour du coté de la psycho-dynamique du travail analytique. En apparence seulement car dans l'écriture se joue une puissante alchimie reliant les phantasmes originaires, l'activité fantasmatique primaire, l'activité de pensée, l'activité émotionnelle/affective et l'activité corporelle qui l'actualise, leur donne lieu pour reprendre les termes de Cadoux, au travers de la gestualité graphique. Je suis convaincu que l'ensemble de ces plans par où la vie psychique est à la fois active et passive est profondément engagé. En tout cas, dans la perspective de la création d'espaces d'Atelier où faire travailler l'écriture comme médiation pour le travail thérapeutique/analytique.
Peut-on instaurer un dispositif dans lequel l'écriture va pouvoir fonctionner comme appât pour la relation de transfert et pour son traitement?
Mais revenons-en aux thèses de Bernard Cadoux .
@
Catastrophe psychique et écriture
Selon le point de vue où je me place, ce qui fait problème dans la métapsychologie freudienne, c'est la représentation à la fois topographique et mécaniste de la phénoménologie psychique en terme de contenant/contenus. On trouve la trace omniprésente de cet artéfact conceptuel dans toutes sorte de formules théoriques fondées sur la désignation d'un "dedans de la psyché" qui aurait une fonction contenante et d'un hors-psyché où le sujet expulserait les éléments hétérogènes à son propre fonctionnement.
Je pense que cette représentation de l'expérience psychique a une fonction essentiellement économique pour les psycho analystes qui y inféodent leur système de pensée, en ce sens qu'elle permet la maintenance dans la théorie et dans la cure (reportée sur le dispositif et les inducteurs techniques) du clivage de l'affect dans le couple affect/représentation. Le hors-psyché de la cure analytique c'est le cadre technique de la cure lui-même qui est chargé de le contenir, maintenu à l'écart de la mise en doute de son rôle d'écran de protection, de pare-excitation pour le thérapeute vis à vis des puissantes décharges affectives/émotionnelles opérantes dans le transfert profond, psychotique ou non-psychotique.
Selon moi, les termes de catastrophe psychique, d'effondrement psychique, de conflit psychique, de douleur ou de souffrance psychique n'ont pas de sens. Ils assignent à une instance instru-mentalisée, topographiée et mécaniste, une fonction substantive qu'elle n'a en aucune façon.
@
Le modèle informatique me paraît être un modèle métaphorique beaucoup mieux à même de rendre compte de la phénoménologie psychique que celui de "l'appareil à penser" qui entretient la confusion entre les plans de l'expérience psychique, de la pensée réflexive et de la perception consciente.
Le système informatique comprends une organisation anatomique répartie en organes complémentaires : l'ordinateur (Système nerveux central ), le clavier et la souris (organes de formulation de la décision/réalisation motrice), l'écran (lieu de la représentation psychique), et l'imprimante (lieu de la condensation concrète de l'image/message en vue de sa communication). A ce système/base nous introjectons (input) un récepteur parabolique de programmes télévisuels et nous câblons le tout sur le réseau Internet par où nous arrive toute l'information audiovisuelle produite dans le monde entier. Nous sommes ainsi proches de l'organisation du système nerveux humain, à deux différences prêt : l'absence d'une instance interne à l'ordinateur assumant la fonction perceptuelle - les états de conscience - assumée par l'opérateur humain, la fluidité associative et la mobilité de la rétroaction perceptuelle propre au cerveau humain, et l'opérativité émotionnelle (bien que les machines cybernétiques auto-régulées peuvent développer des comportement émotionnels "objectifs" rudimentaires d'alerte, de satisfaction, de protection contre des agressions mettant en danger leur intégrité mécanique.
Ce système comprend les fonctions suivantes
Choix d'une fonction de traitement : texte (écriture), tableur (données mathématiques /arithmétique), image photo/vidéo/son (montage/création).
Le disque dur représente l'espace cortical de stockage de deux sortes d'informations:
- l'ensemble des informations programmatives stables, - les applications - des modes de traitement de l'information (équivalent métaphorique de l'inscription des codifications génétiques) en place avant toute utilisation de l'ordinateur, qui définissent l'ensemble du programme des traitements possibles et des outils d'actualisation définissant la puissance et les compétences de l'ordinateur;
- un espace vierge de stockage des informations événementielles distribué selon deux modes de mémorisation: la mémoire vive de l'ordinateur (mémoire court terme) enregistrant les séquences actuelles de l'activité de l'opérateur (le Je), dont un certain nombre vont être sélectionnées par celui-ci pour être fixées dans la mémoire long terme (disque dur). Les informations contenues dans la mémoire vive, non fixée sur la mémoire dure sont détruites lorsqu'on éteint l'ordinateur.
Dans ce système métaphorique, je représente l'activité psychique comme étant ce qui apparaît à l'écran. L'enregistrement de ce qui apparaît à l'écran va devenir un objet informatique (un objet psychique) mobilisable (remémorable) par la fonction de rappel, et être utilisé dans de nouvelles combinatoires de reformulation, de la même façon que le souvenir par le Je.
Les enveloppes prénarratives pourraient être assimilées aux formes logicielles qui permettent de transformer des excitations afférentes au système (le désir) en informations codifiées (texte ou image). Ce logiciel biologique est structuré par l'organisation génétique et ses visées exprimées dans les séquences pulsionnelles, modulées par l'expérience de la confrontation à la réalité. Sa fonction est de permettre de métaboliser des unités d'expérience vécues en traces représentables, en unités d'expérience subjective, en images psychiques.
Dans cette métaphore, l'expérience psychique émerge comme processus terminal de figuration, comme résultante de l'ensemble des opérations afférentes/éfférentes au système.
Ce point de vue fixant l'expérience psychique comme symbolisation de l'état des lieux rend caduque l'idée de toute force causale inhérente à l'image. L'image ne peut pas souffrir, ni s'effondrer, ni être pathologique ou quoi que ce soit d'autre. Elle est pur effet, pure représentation indemne de tout pouvoir causal. La crainte de l'effondrement psychique est elle-même une image de mot, une séquence narrative, pour un effondrement qui a déjà eu lieu nous rappelle Winnicott, et qui n'a pas trouvé, justement son moyen de figuration, son lieu de représentation, son lieu d'être pour reprendre les termes de Cadoux ; qui n'a pas trouvé à s'inscrire comme trace et comme événement appréhendable par le Je.
L'effondrement est effondrement de l'organisation perceptuelle, de la défense affective/psychique érigée contre la douleur qui envahit la totalité de l'expérience et oblitère toute possible perception.
C'est l'affrontement non médiat de la douleur affective originaire qui déclenche l'angoisse de mort et mobilise les défenses contre ces éprouvés intolérables qui ont conduit l'organisation à la faillite originaire. Mais la faillite n'est pas du psychisme (qui n’est qu'un pur concept) elle est identitaire. Elle réside dans la capacité à lier ces éprouvés et à leur donner un sens, puisque la pensée, dont c'est l'unique fonction, fait défaut. Dans le travail thérapeutique/analytique, c'est du traitement de ce processus dont il est question. Alors, que peut bien pouvoir signifier une approche du travail analytique qui se bornerait à ne s'occuper et à ne se servir que de ce qui se passe sur l'écran, en espérant que le regard porté par le tiers analyste sur ce qui lui est donné à voir aura la capacité de modifier les matrices narratives ? C'est à peu près ce qui se passe si l'on assigne au seul travail psychique la fonction de lieu central et d'outil princeps de l'investigation et du traitement analytique.
Mais peut-être bien que la question de l'écriture - Traitement de Texte - assistée par ordinateur (TTAO), va nous aider à dépasser cet obstacle.
Depuis que j'écris à l'ordinateur, j'ai observé un certains nombre de processus psychiques et affectifs directement liés aux rétroactions de l'image/écran sur mon propre processus de pensée et d'élaboration imaginaire, qui m'apportent une qualité de jouissance spécifique à ce mode d'écriture. Cela a induit chez moi de plus en plus réticence, lorsque je suis seul, à reprendsre l'écriture manuscrite. Certaines personnes qui n’ont pas sauté dans le train informatique, ne manqueront pas d'interroger l'acte électrographique lui-même en signifiant qu'il ne s'agit pas d'un acte à proprement parler d'écriture, que lui échappe toute gestualité signifiante. Ceci est à la fois vrai et faux. Avec la dactylographie électronique, on avance d'un cran dans le processus de l'abstraction symbolisante. LACAN s’est planté en terre au moment du démarrage de la révolution informatique. S’il avait mordu à la Chose, il y aurait sûrement succombé, et cela lui aurait sans doute remanier la pulsion idéologique forcenée dans le sens poétique.
Mon expérience personnelle de la Chose informatique est que je gagne en qualité et en acuité abstractivante ce que je perd en gestualité signifiante. Et je gagne en outre une faculté précieuse, terriblement efficace, qui est la possibilité d'inscrire rétroactivementet instantanément toute production psychique induite déclenchée par la lecture de l'image/écran.
Ce à quoi certains vouent un véritable culte, le brouillon et la rature, apparaît dans ce nouveau mode de création comme une entrave vétuste au libre fonctionnement de la pensée, au libre jeu du Symbolique. Le TTAO épouse avec une grande plasticité le fonctionnement spontané de la pensée, exactement comme les surréalistes en indiquaient l’avènement.
L'électro-dactylographie n'est pas assujettie à l'attitude et à la subjectivité manuscrite. Et cette interaction entre la pensée résiduelle inscrite à l'écran et le flux de pensée actuel nourri à la double source de l'émergent et du déjà écrit, provoque des effluences affectives permanentes, des remaniements immédiatement répercutés dans l'organisation textuelle toujours appréhendée comme image instable jusqu'au terme du processus de création, c'est à dire jusqu'à l'épreuve effective concluante que le texte soit saturé de l'affect dont il est l'expression, dont la construction a reflété chacune des étapes de la mobilisation æsthésique de l'affect dans la représentation de mot.
Avec l'écriture dactylographique on est d'une certaine façon affranchi des astreintes de la gestualité par où l'écrivain aménage la résistance au symbolique, puisque l'écriture constitue une régression, un repli æsthétique de la pensée aliéné à la vieille motricité. L'image/écran au contraire constitue une pensée en miroir, une sorte d'avancée fracassante dans le stade du miroir.
Avec le TTAO, on abandonne toute préoccupation de logique spatiale d'organisation du texte. Toutes les opérations de transfert séquentiels de texte sont immédiatement réalisables : pas de latence entre désir et exécution. Tous les jeux de surlignages, de marquage des caractères, sont à chaque instant formulables et immédiatement remaniables. Et ce d'autant plus que la dactylographie à deux doigts comme je la pratique est encore aliénée à l'astreinte du regard du clavier. Le surmoi grammatical et orthographique est desserré, remis à plus tard. C'est le jeu même de l'expression qui s'ouvre, à partir de la relâche de la censure. Tous les impératifs moïques et surmoïques peuvent être provisoirement desserrés, voire abandonnés, le temps de la réalisation, et les automatismes de pensée (lécriture automatique) prennent les commandes de la dictée des représentations " en l'absence de tout contrôle exercé par la raison" (Manifeste du surréalisme - André Breton).
La représentation visuelle, immédiatement scriptée, rétroagit sur le processus de pensée actuel invité au jeu perpétuel de la figuration et de la correction en miroir par une affectivité toujours active et en recherche permanente de la forme pleine, de la résolution.
Circus Mélanie : Hommage à Mélanie Klein
Circus Mélanie : Hommage à Mélanie Klein
Des théoriciens pour travailler
Quelques outils bien concrets et indispensables à portée de la main
pour la conduite de l'animation des Ateliers d'Art CRU
Exposition d'idées de Guy Lafargue pour les étudiants en formation
de praticiens d'Ateliers d'Expression Créatrice centrés sur le soin à la personne
@
Impertinences affectueuses (dans affectueuses, il y a le signifiant "tueuse") sur la déjantée de la psychanalyse : Mélanie Klein.
Quelques outils bien concrets et indispensables à portée de la main pour la conduite des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques
@
Hier soir, vers 20h45, alors que je bûchais pour vous mon scoop sur la nana number one de la psychanalyse post freudienne - Mélanie Klein - ARTE lançait sur l'écran ce joli conte psychanalytique d'Alfred Hitchcock tourné en 1945 :"La maison du Dr Edward", dans lequel la superbe Ingrid Bergman (une autre super nana fabuleuse de l'autre siècle) tient le rôle de Mélanie Klein.
https://www.youtube.com/watch?v=g9eOMCZyBiI
Dans l'histoire institutionnelle de la psychanalyse (entre 1932 et 1950), Mélanie Klein a joué le rôle de la boule dans le jeu de quille, le jeu de quille représentant les sociétés de psychanalystes du vieux continent à forte densité masculine.
Pour ceux d'entre vous que cela intéresserait de creuser de ce coté de l'histoire, je recommande la plongée dans quelques ouvrages dont : "Mélanie Klein" de Julia Kristéva (Coll. Le génie féminin, Fayard Ed.) ; et "Le génie clinique de Mélanie Klein" du dénommé Inshelwood (Ed.Payot, coll."Désir"), un anglais amoureux de la pensée de Mémélanie.
Et naturellement, pour nourrir le travail de la pensée théorique, les livres de Mémélanie elle-même, - "L'amour et la haine" pour les novices, (Payot ED.) et "Envie et gratitude" (NRF Ed.). Et enfin le must, le pavé de référence du dénommé Inshelwood: " Dictionnaire de la pensée Klenienne".
Quant à moi, je vais centrer mon exposé de synthèse dans la perspective suivante, qui est de prendre en compte le caractère difficile voire hermétique de la pensée Kleinienne. Et donc, de tenter le pari d'extraire d'une matière relativement abstraite (lorsqu'on ne possède pas les pré-requis permettant de se déplacer dans cette complexité sans en perdre le suc), une représentation concrète faisant liaison avec votre expérience. D'articuler ces concepts à notre préoccupation centrale ici qui est la conduite des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques, et la prise en main d'outils théoriques pour travailler dans une certaine lucidité sur ce qui se passe.
J'en profite pour rappeler au passage que l'étymologie du mot "théorie" vient du verbe grec "théorein " qui signifie "observer ". Et donc, que la théorie, c'est une façon de mettre de l'ordre dans les observations faîtes sur les phénomènes ... et, pour ce qui nous concerne, sur les phénomènes qui se développent au sein des Ateliers d'Expression Créatrice.
Je souligne bien la présence du terme Créatrice indissolublement liée aux termes Ateliers d'Expression, qui constitue l'Objet institutionnel de la formation que nous donnons ici.
Donc, la théorie Kleinienne et ses articulations à la question de l'animation des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques par où elle nous concerne de très près.
Nous aborderons successivement huit plans d'expérience constituant l'essentiel de la théorie Kleinienne et nous laisserons de coté d'autres aspects théoriques à caractère plus spéculatif.:
- La définition de la vie fantasmatique.
- Les mécanismes constituants de la vie psychique : projection et introjection.
- Les relations objectales
- La question des pulsions destructives: envie et avidité
- Les mécanismes de défense contre les angoisses les plus profondes
- La technique Kleinienne du jeu VI:Le transfert et le travail de l'interprétation
- La créativité
@
I. La vie fantasmatique
Le fantasme est un mot. Un mot de la vie ordinaire de chacun de nous, que nous prononçons la plupart du temps lorsque nous évoquons de trucs relatifs à l'exercice de la sexualité.

Yolande Parrou "Tarot de la connaissance psy" de Guy Lafargue
Que savons-nous de ce que c'est qu'un fantasme?
Quelle représentation nous en faisons-nous ?
C'est très important d'en avoir une idée au moins approximative lorsque nous nous préparons à créer et à conduire un cadre dans lequel l'activité fantasmatique des personnes avec lesquelles nous travaillerons va s'engager de façon permanente dans le jeu de l'expression créatrice, et dans des degrés d'intensité affective susceptibles de nous poser les problèmes qui constituent notre métier.
Comme point de départ, je vous propose de considérer le fantasme comme un scénario, comme une sorte de script qui se manifeste dans une forme psychique, c'est à dire imaginaire, c'est à dire sous la forme d'une séquence faite d'images mentales liées en une unité dramatique, avec une ouverture, une action dramatique centrale et une conclusion.
On pourrait dire que le fantasme - petite scène psychique de durée subjective et de complexité variable - constitue une unité narrative, un récit autour d'un thème central concernant (comme nous l'a enseigné la psychanalyse) les échanges érogènes ou pathogènes à prédominance orale, anale, génitale ou autre.
Le développement de ce scénario a toujours une couleur affective (la couleur est le langage de l'affect) , c'est à dire qu'il est toujours affecté d'un coefficient de plaisir ou d' douleur et d'angoisse, en des intensités variables.
Les "phantasmes" (originaires), sont les premières manifestations mnésiques avant le constitution de la vie psychique enfantine (dans la période périnatale). Ils sont le premier stade de la formation des images psychiques (protopsychiques). Ils sont saturés en sensations, en "mnésies" marquées par le caractère impérieux des besoins et des affects originaires : faim, douleur, angoisses d'abandon, de mort. Ils constituent les strates originaires de la future activité de représentation psychique. Ils sont marqués de l'adhésivité symbiotique dans laquelle il n'y a encore ni sujet, ni objet.
Ce n'est qu'après la période transitionnelle (telle qu'elle a été définie par Winnicott que l'enfant devient capable de différencier l'objet (la mère) de son propre être. Il devient capable de se représenter sa mère en son absence. Il développe alors une intense activité psychique créatrice dont les "fantasmes" constituent l'album imaginaire au travers duquel il s'explique à lui même sa relation au monde. Ses créations psychiques lui servent "à rendre homogène à sa propre expérience du monde ce qui lui est hétérogène "( Piera Aulagnier : "La violence de l'interprétation").
Dans un fantasme co-existent toujours une structure narrative (ce qui apparaît, le script) et une qualité et une intensité affective (les éprouvés affectifs attachés à la représentation qui ne sont pas immédiatement identifiables par le sujet et encore moins par l'animateur).
Pour Mélanie Klein, d'une part le fantasme est la traduction au plan psychique des motions instinctuelles, et il intègre d'autre part les mécanismes de défenses érigés contre ces motions (Hinshelwood p.40).
On peut donc considérer que les fantasmes sont la représentation psychique d'une sorte d'état de compromis entre des motions pulsionnelles, désirs, instincts du sujet et le frein à leur réalisation ou 1 t empèchement de leur expression quelles qu'en soient les causes: environnementales ou subjectives.
Mélanie Klein suivant en cela les travaux de Freud désigne un plan d'activité fantasmatique qui entre dans le champ de la perception du sujet, en quelque sorte des fantasmes ciné(ma)tiques (fantasmes conscients, rêverie éveillée, souvenirs de rêves) qui se prêtent en quelque sorte au récit ( et dont on fait couramment l'expérience dans l'activité de création) et un groupe de fantasmes inconscients qui sont à la base de tous les processus mentaux, qui accompagnent toute activité mentale et dont la finalité selon Mélanie Klein est la satisfaction hallucinatoire du désir. Selon elle cette activité est permanente chez le nourrisson. En cela elle marque une différence radicale avec la théorie de Freud qui envisageait l'émergence du fantasme comme essentiellement réactionnelle à la frustration de la réalisation des motions pulsionnelles.
Pour Freud, le sujet fabrique un fantasme lorsque la décharge motrice n'est pas possible.
Pour Mélanie Klein, le fantasme inconscient est constituant de toute expérience de la réalité.
II constitue pourrait-on dire le milieu mental permanent dans lequel viennent s'insérer les événements de la réalité somatique.
L'activité fantasmatique inconsciente serait donc originaire et soutiendrait la totalité de la vie psychique à ses débuts, et tout au long de l'existence du sujet.
Une des élèves de Mélanie Klein, Suzan Isaac, a orthographié phantasme avec ph pour désigner ces formes psychiques de première génération (liés aux premiers vécus affectifs d'incorporation, de fusion, de destructions sur lesquelles s'édifieront par la suite les fantasmes de deuxième génération, ceux abordés par Freud (autour de la relation œdipienne), et toute l'organisation de l'expérience psychique ultérieure.
@
En quoi la vie ph(f)antasmatique, dans son aspect archaïque ou dans son aspect plus secondarisé nous intéresse-t-elle ici? La réponse est double :
- d'une part parce que l'activité de création et le jeu avec les matières permettent la scénarisation concrète, physique, des fantaisies et fantasmes psychiques et offrent une possibilité de mettre en forme et de laisser trace là où l'expérience fantasmatique s'évapore; et que cela va donner un socle à l'activité de penser à partir de cet événement nouveau: la trace dépositaire de l'affect inconscient ou du fantasme cinétique.
Cela est vrai en particulier pour les fantasmes de deuxième génération. - d'autre part, l'espace de projection plastique et c'est selon moi le plus intéressant, l'espace de projection créatrice va devenir le lieu d'un mode d'activité phantasmatique non représentable dans l'expérience psychique et qui concerne les expériences affectives originaires et les défenses associées.
@
II. Les mécanismes de base constituants de la vie psychique
Introjection et Projection
Il s'agit là de deux mécanismes constituants/constitutifs de l'expérience psychique et de cette partie de la psyché que les psychanalystes ont appelé le Moi, le Moi étant une instance au service de l'instinct de vie, et, en quelque sorte, le lieu virtuel où se mettent en représentation psychique les rapports que le sujet entretient avec son environnement d'Objets attractifs ou répulsifs.
Le Moi, pour Mélanie Klein, est inné, et l'une de ses fonctions majeures est précisément la défense contre les pulsions destructives (manifestations de l'instinct de mort) et leur évacuation vers l'extérieur.
Ces deux processus projection et introjection se développent en prenant appui sur deux fonctions primordiales du corps que sont l'incorporation du sein dans la bouche au cours de la tétée et l'expulsion de la merde et du .sentiment de bienfaisance dont cela s'accompagne.
Le sein - Objet externe - devient dans la mémoire somato-affective un sein/bouche, organe subjectivement unique, producteur de satisfaction pulsionnelle et de résolution de la douleur orale.
Ces deux opérations vitales, input/output, constituent en quelque sorte la matrice, le prototype, de tous les comportements ultérieurs du sujet liés à des situations vitales où il s'agira de prendre des objets externes à l'intérieur (le bon objet) ou de rejeter à l'extérieur des matériaux physiques ou psychiques encombrants ou dangereux, à un titre ou à une autre, (mauvais objets).
Dans l'introjection, donc, les objets externes, en particulier les objets d'amour et leur prototype - le sein deviennent des parties du moi, des Objets internalisés, avec lesquels, en leur absence, le sujet poursuit un dialogue phantasmatique.
Dans la projection, le sujet, littéralement, expulse en dehors du Moi les expériences insatisfaisantes, douloureuses ou angoissantes.
Généralement il les expulse sur l'Objet le plus proche et le mieux capable de les recevoir, c'est à dire; au début, la mère dont c'est une partie de la fonction que d'héberger les expulsions phantasmatiques de son bébé sans lui retirer le bon Objet dont il dépend. Il préserve ainsi un état de moindre tension interne dans sa relation aux mauvais objets internes ou aux mauvaises parties du Moi.
C'est dans ce mouvement que se construisent ce que la psychanalyse a pérennisé sous le nom de relations objectales.
Selon Férenczi (qui est le créateur du concept d'introjection et le psychanalyste qui a formé Mélanie Klein), la névrose se construirait sur la base de mouvements d'introjection excessive, là où l'expérience psychotique s'édifierait sur la base de mouvements de projection excessive.
Sur la base de ce double mouvement centripète (oral) et centrifuge (anal) va se développer un mécanisme actif dans la construction du Moi que l'on appelle l'identification.
Dans l'univers Kleinien, au début, les phantasmes originaires sont la réalité. Il y a confusion entre le Soi et l'Autre, (par exemple, entre la bouche et le sein, il n'y a pas de discontinuité). Le phantasme et le monde sont dans un état de relative indifférenciation, sont en quelque sorte la même entité, l'id-entité, l'id/le même étant, une sorte de mimésis, un mode d'appropriation des qualités de l'Autre comme qualité du Soi. L' "id ", c'est le même ; et l'entification , c'est un mot dérivé du mot entité, du participe présent du verbe être - l'étant.
En quelque sorte, l'identification, ça serait l'édification de l'être ( l' êtrification) , c'est à dire la constitution du Soi comme forme psycho-affective de la chose charnelle, des éprouvés de corps sans représentation.
A partir d'un moment, très tôt, le bébé devient producteur d'id…d'idées (étymologiquement, l'idée est "l'apparence, l'image, la forme mentale des choses", la "représentation ").
Le bébé construit sa représentation de Soi par introjection mimétique des éléments sensoriels et langagiers associés aux évènements affectant son expérience corporelle.
C'est sur ce process originaire que j'ai appelé quelque part la mêmification que le bébé va commencer à explorer le monde des objets, se mêmifiant aux objets qui lui procurent bien-être et plaisir, et détruisant/rejettant les Objets néfastes dans l'action corporelle et dans le phantasme.
A partir de la mise à jou(i)r de ce processus inaugural de la formation de l'id-entité, va se développer un autre mécanisme, que Mélanie Klein a appelé l'identification projective, elle-même liée à ce qu'elle a appelé les processus de clivage :
- clivage de l'Objet , c'est à dire de séparation des caractéristiques bonnes et mauvaises de l'Objet, qui va permettre au sujet de préserver les identifications satisfaisantes et de projetter sur autrui une partie désavouée du Moi, qui est attribuée par le sujet à une autre personne et est totalement récusée comme constituante du Soi.
- Et clivage du Moi, c'est à dire fragmentation du Moi qui a pour effet d'atténuer la charge affective en détruisant fantasmatiquement les mauvais fragments (mécanismes de déni, comme dans le rêve, ou dans le conte merveilleux, ou les mauvaises parties du Soi ou de l'Objet sont représentées par des personnages étrangers perçus par la conscience du sujet comme étrangers, atténuant ainsi l'intense culpabilité liée aux motions destructives).
Ces processus psycho-plastiques sont particulièrement actifs dans l'expérience créatrice dans ce jeu incessant de va-et-vient, de double mouvement, de projection des images psychiques préexistantes dans les matières/supports et guidés par une intentionalité consciente, et de condensation psychique consécutive à une projection guidée directement par l'état affectif actuel, une production de première main si l'on peut dire, productrice en retour d'une activité imaginaire nouvelle ou d'une activité de pensée.
C'est à dire d'un jeu émergent, à proprement parler créateur.
@
III. Les pulsions destructives
Envie et Avidité
Un grand débat articule ici plusieurs concepts ligotés entre eux qui tournent tous autour de la figure totémique de l'instinct de mort, génératrice de l'angoisse primordiale et de la constitution du Moi comme bunker. J'exagère à peine.
Chez Mélanie Klein, la scène théorique est un peu construite comme les tragédies grecques, enfin, c'est une image pour dire qu'ici, le héros, c'est l'Instinct de mort "tout entier à sa proie attaché" comme disait une des femmes calcomaniée par Jean Racine (Hermione peut-être, à moins que ce ne soit Andromaque, en tout cas une de ces femmes typiquement kleinienne puissamment agitée par l'amour et la haine). A savoir que, dans le script biologique, l'expression de l'instinct de mort à l'intérieur attaque directement un Moi encore précaire et déclenche une angoisse primordiale source de l'expérience affective la plus ancienne et la plus pénible dont le bébé fait l'épreuve irrémédiable à la naissance, épreuve constante et qu'il a à résoudre: la menace d'anéantissement du Moi et de l'Objet.
Et M.K. dit clairement que l'issue à cette calamité constitutionnelle, c'est dans la qualité et le degré de cohésion de l'instinct de vie, soutenus par l'amour de la mère, que le bébé la trouvera. Si la mère n'apporte pas ce soutien, où si elle est trop folle pour s'occuper de son bébé, le destin du bébé s'engage sous de bien mauvais augures.
C'est donc un monde dualiste, type Play Station avec les Antagonistes héréditaires campés chacun sur leurs machine désirante et destructrice, qui envahissent la scène interne du sujet pour un combat à l'issue incertaine.
Les machines de guerre bricolées par Thanatos : l'envie et l'avidité
Pour Mélanie Klein, la conduite envieuse, ou pulsion envieuse, présente trois aspects définitifs : elle est innée, constitutionnelle et irréductible :
"L'envie est une manifestation sadique-orale et sadique-anale des pulsions destructives.
Elle intervient dès le commencement de la vie et elle a une base constitutionnelle " (p11) "L'envie implique la relation du sujet à une seule personne, qui remonte à la toute première relation exclusive à la mère "(p.11) Ce sentiment vise directement à s'emparer de l'Objet convoité et à lui faire subir des dommages :
" L'envie est le sentiment de colère qu'éprouve un sujet quand il craint qu'un autre ne possède quelque chose de désirable et n'en jouisse ; l'impulsion envieuse tend à s'emparer de cet Objet et à l'endommager " (p.18).
Pour le nourrisson le sein est cet Objet et il semble que cet autre soit la mère.
Pour Mélanie Klein, le mécanisme de la projection est directement lié à l'envie en ce sens que, par une stratégie non-consciente, le sujet évacue sur l'autre ses pulsions destructives. Elle voit dans l'envie la force la plus destructrice dans la mesure où elle compromet en premier lieu le lien primitif avec la source de satisfaction des besoins , la mère : " L'envie est le facteur le plus actif pour saper à leur base même l'amour et la gratitude dans la mesure où elles s'attaquent à la plus archaïque de toutes les relations humaines : la relation à la mère " (p.11).
L'enfant concentre ses premières attaques sur le sein nourricier, paradoxe qui peut devenir désastreux puisque ce sein lui apporte concrètement de la vie : " Le sein est le premier Objet à être envié par l'enfant. Ce sentiment ne fait qu'intensifier sa haine et sa revendication et perturbe ainsi sa relation à sa mère " (p.21).
La conséquence de ses attaques est multiple: elle ne favorise pas l'enracinement d'une bonne image intérieure: " l'envie contribue à rendre l'élaboration du bon Objet difficile à l'enfant " (p.17).
En outre: " Le sentiment d'avoir endommagé et détruit cet Objet primitif ébranle la confiance du sujet : il doute de sa sincérité dans ses relations ultérieures, de sa capacité d'aimer et d'éprouver de la bonté " (p.29).
Une des façons dont cette envie se manifeste consiste, pour le nourrisson et par le moyen de mécanismes projectifs, à investir le corps de la mère de toute cette négativité encombrante et douloureuse:
" L'envie tend en outre à introduire dans la mère, avant tout dans son sein, tout ce qui est mauvais, et d'abord les mauvais excréments e t les mauvaises parties de soi afin de la détériorer et de la détruire " (p.18).
L'envie excessive
Mélanie Klein distingue entre l'envie "primordiale" et les formes différentes qu'elle affectera par la suite, notamment dans ses dimensions excessives.
Elle en attribue la responsabilité à des mouvements persécutifs et dissociatifs particulièrement virulents: "Les formes excessives que peut revêtir l'envie dénotent que les éléments paranoïdes et schizoïdes sont particulièrement intenses" (p.21).
Mélanie Klein consacre la totalité du chapitre quatre à examiner les conséquences d'une envie excessive. Je vous en propose la synthèse suivante.
Dans les attaques envieuses du sein de la mère, le nourrisson ressent qu'il endommage sa source de gratification et de ce fait en ressent une culpabilité normale.
Si ces attaques deviennent excessives, la culpabilité se renforce et devient insupportable. Le Moi, dont c'est la fonction, clive alors la pulsion et la projette sur l'Objet, renforçant son pouvoir de persécution.
De ce fait, le nourrisson est entraîné dans une situation confusionnelle entre l'angoisse paranoïde et l'angoisse dépressive dont l'aboutissement normal devrait être la translaboration, c'est à dire un état de perception nuancée de la réalité globale.
Si les sentiments paranoïdes et les mouvements dissociatifs sont renforcés par une culpabilité précoce trop forte, il y a échec de la translaboration.
Une deuxième conséquence de l'envie excessive porte sur les intéractions entre les manifestations libidinales spécifiques et les zones de leur expression corporelle appropriée :
- L'envie excessive s'oppose aux gratifications orales.
- Elle stimule en les intensifiant les tendances et désirs génitaux.
- Un double glissement se produit alors : d'une part on assiste à une imprégnation génitale de la relation orale investie sur un mode d'agression ; et, d'autre part les revendications et les anxiétés orales se déplacent dans la sphère génitale.
Mélanie Klein tire cestteleçons de son travail avec les enfants : que les sensations et désirs génitaux peuvent entrer en action dès la naissance.
Si une certaine confusion et un certain chevauchement entre pulsions et fantasmes oraux, anaux et génitaux sont tout à fait inévitables, donc normaux, durant cette période, lorsque les pulsions envieuses deviennent trop intenses, cette confusion entraîne un empiètement d'une tendance sur l'autre dans les lieux où celle-ci devrait être dominante en regard d'un développement normal.
Ce chevauchement empêche la prédominance d'une tendance à son stade évolutif correspondant, ce qui va avoir une répercussion parfois désastreuse sur la totalité de l'organisation de la vie sexuelle et du système des sublimations.
La génitalité va s'exprimer comme un mode de fuite des exigences orales qui sécrètent l'envie, et la génitalité elle-même va être empreinte de la méfiance et des déceptions liées aux altérations de la jouissance orale.
Mélanie Klein voit dans ce mécanisme l'origine ; de la masturbation compulsionnelle : " le manque de jouissance primaire introduit des éléments compulsionnels dans les désirs génitaux et peut mener à ['envahissement de toutes les activités, de tous les processus de pensée et des intérêts les plus divers par les sensations sexuelles " (p.39)
L'avidité
Le sentiment corollaire de l'envie est l'avidité.
Pour Mélanie Klein " L'avidité est la marque d'un désir impérieux et insatiable qui va à la fois au-delà de ce dont le sujet a besoin et au-delà de ce que l'Objet peut ou veut lui accorder" (pI8).
Le but de cette conduite avide:
"Au niveau de l'inconscient l'avidité cherche essentiellement à vider, à épuiser
ou à dévorer le sein maternel. Son but est une introjection destructive " (p.I8). Pour Mélanie Klein l'avidité est plus spécifiquement liée au mécanisme d'introjection, là où l'envie est liée au mécanisme de projection.
La conséquence pour l'enfant de ses tentatives d'introjection dévorante de l'Objet est l'éclatement et la dissolution de son Moi :
"L'intériorisation avide et dévorante de l'Objet - en premier lieu du sein maternel - s'accompagne d'un véritable morcellement du Moi et de ses Objets.
Le Moi disperse ainsi les pulsions destructives et les angoisses internes de persécutions ".
Quel est l'intérêt pour nous, dans le travail des Ateliers d'Expression Créatrice, de la connaissance et de la prise en considération de ces deux forces affectives majeurs?
Et bien tout simplement parce que le travail de la représentation créatrice est indissociablement lié à l'investissement affectif dont elle va être, justement la représentation.
Nous travaillons ici sur l' hypothèse que l'aire du jeu créateur constitue un appel puissant à l'émergence des signifiants, en premier lieu au travers de l'investissement affectif que l'on appelle le transfert.
Toute une partie du travail du praticien va être de permettre l'engagement de ces forces dans le jeu de la représentation créatrice : l'expression affective médiatisée est la loi qui organise le fonctionnement de l'Atelier et qui détermine le rôle de l'animateur.
@
De quelles ressources dispose le sujet pour faire face à ces forces affectives destructrices?
IV. Mécanismes de défense
Mélanie Klein aborde ensuite la description d'un certain nombre de mécanismes essentiels de protection du Moi contre l'expérience de la destructivité interne. Je me bornerai ici à en retracer la description et à en définir brièvement les caractéristiques :
Les mécanismes paranoïdes/schizoïdes
Donc, t'auras compris que " Chaque fois que l'angoisse surgit, elle est de nature paranoïde, e t les défenses qui se dressent contre elle, de nature schyzoïdes "(p.33).
Au centre des mécanismes paranoïdes se trouve l'angoisse de persécution, qui "constitue les couches les plus profondes du psychisme "(p.80-84).
Ça, c'est donc une idée trés forte, comme quoi l'activité psychique originaire est déclenchée par un éprouvé persécutoire qui va donner naissance aux premières formations de phantasmes qui sont, à proprement parler, des protoreprésentations intermédiaires entre des réactions purement somatiques, et les formes psychiques élaborées auxquelles le jeune enfant parviendra à la fin de cette première période de son existence.
@
Le travail du clivage
Le concept de "clivage" constitue un des concepts centraux de la théorie Kleinienne.
Il s'agit d'un processus de défense contre les sentiment paranoïdes (persécutoires), qui consiste :
- soit à séparer fantasmatiquement les propriétés affectives des Objets pour extraire de soi les mauvaises parties incorporées ;
- soit à fragmenter le Moi lui-même en le séparant en partie mauvaises détachables et expulsables, et en partie bonnes, protectrices, incorporables, le but étant toujours le même : neutraliser les aspects menaçants de l'Objet ou du Moi.
C'est par le mécanisme du clivage que vont pouvoir jouer les processus identificatoires et les processus projectifs.
La position paranoïde et la position dépressive
Mélanie Klein s'attache à décrire l'évolution du bébé dans les premiers mois de ce conflit existentiel entre pulsions antagonistes.
Les deux principaux moments de cette évolution sont constitués par la position paranoÏde/schyzoïde et par la position dépressive.
La position paranoïde est caractérisée par une utilisation prévalente des mécanismes de dérivation des pulsions destructives sur l'Objet assimilé de ce fait à un Objet persécuteur.
Cette position est à la fois résolutoire, puisqu'elle évacue les tensions (sur un mode hallucinatoire) ; et, simultanément, elle est source de conflit et de culpabilité.
L'Objet persécuteur est attaqué en même temps qu'il est envié. Et, parce qu'il est envié, cela est source d'angoisse et de détresse.
Pour ce protéger de ce choc en retour le nourrisson adopte des conduites dissociatives schyzoïdes qui ont pour effet de disperser les pulsions, de les cliver et d'en atténuer l'intensité.
Là où l'angoisse est de nature persécutive, les défenses sont de nature dissociatives. C'est là à proprement parler la position paranoïde/schyzoïde.
La position dépressive "s'installe vers le deuxième trimestre de la première année, et atteint son point culminant vers le sixième mois "(p.37).
Cette position est l'amorce de la phase résolutoire des conflits de la phase précédente dus à l'indifférenciation du nourrisson vis à vis du corps de sa mère et de ses pulsions propres. En quelque sorte, le nourrisson fait le deuil de la confusion: il accède à l'Objet global; il commence à établir la distinction entre la réalité interne et la réalité externe; il élargit le champ de ses relations d'Objet, ce qui va le conduire vers les manifestations précoces du conflit oedipien.
Le besoin de réparation des conduites d'endommagement de l'Objet s'affermit.
L'angoisse proprement" dépressive " de cette période porte sur l'angoisse de perdre la mère du fait de ces attaques qu'il lui porte. Cette période se termine normalement par l'établissement d'une introjection stable de l'Objet aimé.
Ce que Mélanie Klein appelle la position dépressive est pour le bébé une façon d'accepter de faire le deuil des modes de jouissance originaires, c'est à dire de renoncer aux satisfaction charnelles primitives pour s'aventurer dans de nouveaux modes de jouissance non plus "à l'Objet" mais "de l'Objet" dans une distance conquise au prix de ce sentiment de perte acceptée. qui ouvre à de nouvelle modalités de la satisfgaction érogène/érotique
@
V. La technique thérapeutique
Dans son livre "Envie et gratitude", Mélanie Klein parle très peu de sa technique analytique ; en particulier des adaptations de la cure-type au cas particulier de la thérapie de tous jeunes enfants.
C'est dans un autre livre, "Le transfert et autres écrits", qu'elle détaille la "technique de jeu psychanalytique", qui, à bien des égards ressemble à un mini-atelier d'expression centré sur le jeu spontané.
Les principaux éléments de la doctrine Kleinienne concernant la technique de jeu sont les suivants :(Inshelwood, p 19).
- "Le jeu chez. l'enfant est l'équivalent de l'association libre chez. les adultes" .
- " Le jeu est une forme d'externalisation des préoccupations internes, et surtout d'une préoccupation pour des relations à des Objets que l'on croit exister à l'intérieur de soi "
- Il s'agit pour le psychanalyste, au travers de l'interprétation des angoisses les plus profondes (inconscientes) mises en représentation dans le jeu, " de comprendre l'esprit du patient, et à lui communiquer ce qui s'y passe" ("Transfert et autres écrits" p.34).
Cette communication modifie significativement et positivement l'angoisse du sujet et l'ouvre à une relation moins défendue. Elle élargit le champ de la création fantasmatique et de son libre écoulement dans le jeu.
Vous comprendrez l'intérêt de ce point de vue pour l'Atelier d'Expression Créatrice à visée thérapeutique, qui est bien entendu une structure différente de celle du travail psychanalytique du point de vue des formes du jeu et des modes d'action de l'analyste/thérapeute.
Mais il y a un socle solide commun aux deux situations, à savoir que le jeu dont il est question dans l'Atelier d'Expression Créatrice est le jeu de création.
L'expérience créatrice est pour l'adulte, aussi bien que pour l'enfant d'ailleurs, un mode de libre représentation de l'expérience affective inconsciente du sujet.
Ça, c'est un roc fiable sur lequel appuyer notre propre mise en jeu du cadre expressionnel, surtout lorsque nous sommes appelés à l'engager dans la dimension du soin analytique.
@
VI. Le travail du transfert
Un autre socle commun avec la doctrine Kleinienne, est que le développement de l'expérience créatrice dans l'Atelier d'Expression est inéluctablement inscrit dans le développement des processus de transfert que les personnes vont investir sur l'aire de jeu singulière de l'Atelier et de ses différentes composantes. C'est à dire que le jeu de création va s'inscrire comme mise-en-représentation des investissement affectifsdu cadre, de l'animateur/analyste et des médiations créatrices privilégiées, investissements que le sujet consent à engager et qu'il va concentrer de façon prévalente soit sur la médiation, soit sur le cadre, soit sur l'animateur, soit sur le groupe ou sur l'un ou l'autre des participants comme figures originaires de la constellation familiale.
Mélanie Klein va développer dans "Les origines du transfert" son point de vue :
- " Il n 'y a aucun besoin instinctuel, aucune situation d'angoisse, aucun processus mental qui n'implique des Objets externes ou internes; en d'autres termes, les relations d'Objets sont au centre de la vie émotionnelle ". (p 19)
- "Le Transfert prend naissance dans les mêmes processus qui, dans les stades les plus précoces, déterminent les relations d'Objet" (p. 20)
Si socle commun il y a sur ces deux dimensions de la création comme équivalent du processus associatif dans le travail analytique / thérapeutique, et de l'organisation du cadre de l'Atelier, il nous reste à saisir ce qui va différencier fondamentalement l'intervention analytique d'un psychanalyste/thérapeute de celle de l'animateur/thérapeute au sein de l'Atelier d'Expression Créatrice.
@
Je voudrais ouvrir ici une parenthèse sur la question du travail de l'envie, de l'avidité et des processus de transfert sur le vécu groupaI de l'Atelier (et sur les institutions).
Les travaux sur la dynamique des groupes, d'inspiration psychanalytique aussi bien que psycho-sociologiques ont mis en évidence la réalité groupale comme instance phantasmatique originaire, et comme imago maternelle.
Le groupe en tant qu'il se forme et se développe comme unité stable dans un travail de production imaginaire et fantasmatique (ce qui est le cas des Ateliers d'Expression Créatrice), favorise de façon importante la mobilisation des phantasmes originaires et des défenses que nous avons évoquées.
@
Les modalités opératoires du travail d'intégration
de l'expérience créatrice/analytique :
interprétation, perlaboration et translaboration
Mélanie Klein a donc développé autour de la création de l'aire de jeu avec des jouets, comme équivalent de l'aire de travail psychique pour l'adulte, un mode d'intervention interprétatif visant à communiquer au patient ce qu'il donne à voir et à entendre dans son jeu de ce qui traverse son expérience la plus profonde.
Une sorte de lecture directe, CRU, en miroir de ce qu'y inscrit explicitement le sujet, ce qui a pour effet immédiat d'introduire, dans l'expérience subjective du sujet, l'éprouvé qu'il est réellement écouté dans sa parole et qu'il est compris au plus juste de l'angoisse qu'il exprime dans l'énonciation symbolique dans le jeu.
La question de l'interprétation chez Mélanie Klein a été la source de grands conflits au sein du mouvement psychanalytique.
L'interprétation constitue pour Mélanie Klein la participation fondamentale de l'analyste/thérapeute à l'intégration de l'angoisse, des pulsions destructives et au démentellement des défenses qui en découlent.
Le but de la thérapie psychanalytique vise pour Mélanie Klein au contrôle et à l'endiguement des pulsions mortifères par le Moi.
Elle insiste en particulier sur la nécessité " d'analyser de façon répétée les angoisses et les défenses liées à l'envie et aux pulsions destructives pour faire progresser l'intégration... Seul l'analyste, à force d'analyser leurs sentiments hostiles dans le transfert peut leur permettre de revivre ces sentiments dans leurs premières relations affectives, réduisant ainsi le clivage du Soi " (p.89). "Ce n'est qu'en touchant aux couches les plus profondes de l'envie que l'analyse a des chances d'avoir son plein effet". (p.30).
@
Je vais ici faire un petit détour buissonnier.
Dans le chapitre VII des "Écrits techniques de Freud", Jacques Lacan aborde une problématique qui m'est particulièrement chère, mitoyenne de celle des interventions parlantes (ou créantes) de l'animateur dans l'Atelier d'Expression. Cela concerne les dits de l'animateur/analyste au sujet en regard de son jeu, de son action avec les objets/jouets.
Lacan évoque la chose au sujet du travail analytique de Mélanie Klein (qu'il taxe au passage d'opérer "avec la dernière brutalité ", p.81) avec un petit garçon, "le petit Dick", enfermé dans une position autistique, au moyen de ses interventions verbales symbolisantes.
Dans l 'histoire rapportée, l'enfant, qui fait entrer un petit train dans une gare, entend dire par Mélanie Klein ce dont il est préoccupé du coté de la libido : "Dick est le petit train, et il veut entrer dans maman". A la suite de quoi, le garçon sort de l'impasse autistique où il s'était réfugié, et il commence à avoir besoin de sa nourrice.
La préoccupation centrale de ce chapitre porte avec précision sur le caractère opérant de l'énonciation interprétative.
Jacques Lacan nous donne sa version de ce qui opère la mutation du garçon, du processus mutatif qui s'engage à partir de ce moment où l'analyste reconnait et dit dans-sa-bouche-à-elle ce dont il est question dans-son-expérience-affective-à-Iui, c'est à dire la nécessité où il se trouve d'occuper l'espace interne de la mère, et d'être entendu dans cette nécessité angoissante.
C'est cela qu'a tout d'un coup compris de façon empathique Mélanie Klein et qu'elle réverbère à l'enfant dans un véritable acte de Parole, qui est ici la reconnaissance adressée à l'enfant, à voix haute, de la partition (du signifiant) qu'il lui donne à "interpréter": " l'accollement du langage à l'imaginaire du sujet" dit Jacques Lacan (le "langage de la zone érogène du corps" dit Françoise Dolto) c'est à dire l'extraction symbolique de la donne imaginaire du sujet dans son jeu, par où l'analyste ou l'animateur/thérapeute ne fait de façon sensible que prendre acte de ce qui est là , et que personne d'ordinaire ne voit : la nécessité où cet enfant trouve d'être perçu/accepté/compris comme encore affectivement/phantasmatiquement lié à l'espace interne de la mère.
Ce qui déclenche l'attention de l'enfant, ce qui met en alerte, qui effracte les défenses autistiques, et fait émergence de son humanité, c'est que quelqu'une, qui est le contraire d'une brute, très émue par la détresse de cet enfant, écoute sa personne (comme dirait Dolto), et, en quelque sorte, est son porte-parole, à lui qui a renoncé à toute parole et qui reste muré dans le monde des objets non-humains, que c'est cela qui est opérant, mutatif.
C'est ça, le facteur opérant, ce que Carl Rogers appelle l'empathie, cette saisie non-médiate du cadre de référence interne de l'autre, et la communication qu'il en donne au sujet dans des termes qui n'en déforment pas la structure, en l'occurrence ici, la reformulation symbolique de l'expression non-médiate de l'enfant avec les objets qui sont, pour lui, de pures motions affectives, des représentations du Réel.
On retrouve exactement la même structure dans le livre de Winnicott consacré à la psycho-analyse d'une enfant de deux ans, "La petite PIGGLE" ( (PAYOT, Ed.): "Ce qui importait, dit Winnicott, c'était avoir l'expérience d'être comprise" (p.73).
Et moi j'ajouterai que c'est probablement ainsi que la chose se passe pour l'artiste, en tout cas qui est ainsi espérée, dans ce moment de vérité de l'exposition, dans ce moment de parole publique où il engage son œuvre dans le regard de l'Autre, des autres et attend de lui, d''eux, cette expérience empathique d'être fondé, d'être révélé dans son être, par l'interprétation à ciel ouvert de la partition inconsciente qu'il offre au travers de l'œuvre reconnue par l'Autre par où il peut se constituer comme sujet.
Pour en revenir à Dick,
c'est quand cet enfant entend les mots qui sont la représentation de son état affectif qu'il peut commencer à penser et à exprimer une demande de soin.
Le démarrage du processus de croissance inauguré ici, c'est la mise au travail de ce que Carl Rogers appelle "la tendance à l'actualisation de Soi"
@
Ceci nous amène insensiblement à la question de l'interprétation dans le cadre des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques.
Qu'est ce qu'interpréter dans ce cadre où l'expérience créatrice est fixée comme scène centrale pour l'expression du sujet, et où est ouvert le temps de parole comme lieu d'élaboration de l'expérience vécue?
Cadre dans lequel l'expression du sujet est répartie sur deux aires de représentation: celle du jeu créateur et celle de l'élaboration de l'expérience vécue dans le temps de parole? La réponse à cette question est, bien entendu, qu'il n'y a pas de réponse dans le champ d'un savoir préétabli. La réponse à cette question ne peut faire l'objet d'un enseignement. magistral.
La seule chose que je puisse en dire ici, c'est que l'aventure expressionnelle/analytique est inscrite dans la construction progressive du sens, de cette connaissance issue de l'expérience, de ce savoir qui se donne à élaborer et se constitue tout au long de la rencontre entre les protagonistes du lien analytique.
Je privilégierai quant à moi cette conception poétique qui prend le mot interprétation dans la signification qu'il a dans le domaine musical, à savoir, d'interprétation jouée sur un instrument sonore qui donne corps à une partition écrite (affective), qui donne audience aux signifiants affectifs dans les langages de la création.
L'interprète donne à entendre au sujet ce qui de sa symbolisation dans le jeu est la transcription inconsciente et imaginaire ou abstraite des signifiants.
Interpréter n'est en aucune façon extraire et communiquer des significations qui seraient cachées au sujet, mais énoncer dans sa langue ce qui est là dans le langage et auquel le sujet ne peut avoir accès que par son inscription dans l'imaginaire de l'Autre, dans sa reconnaissance par l'Autre, cet autre qui est l'animateur/analyste.
Jacques Lacan communique ça en disant que l'Inconscient, c'est la Parole de l'Autre.
C'est dans l'@utre que se forme l'image concrète de l'Objet insconscient, qui se détruit en tant qu'inconscient dans l'acte même de sa constitution.
Mélanie Klein utilise deux modes d'explication des effets de sens structurants pour le sujet dans la relation analytique: la translaboration et la perlaboration.
Ces deux concepts décrivent des processus d'intégration des effets de sens surgis de l'expérience expressive créatrice dans l'espace analytique que nous pouvons tout à fait transférer à la compréhension des processus expressifs à l'œuvre dans l'Ateliers aussi bien que dans le temps de Parole.
La translaboration :
Terme spécifiquement Kleinien, qui signifie le travail d'assimilation directe par le sujet lui-même des émergences affectives, psychiques, émotionnelles ou mnésiques au sein de son propre jeu créateur. C'est un travail fourni par le sujet qui effectue une élaboration psychique autonome, interne, à sa propre évolution: "un ensemble de processus qui permettent de résoudre et de dépasser certaines positions affectives de la prime enfance " (p.224) ... " un remaniement des affects et des relations d'Objet qui amène une réduction du clivage intra-psychique et qui favorise l'intégration du Moi" (p.224).
La perlaboration désigne, comme pour les Freudiens, un processus par lequel le sujet intègre une interprétation de l'analyste et surmonte les résistances qu'elle suscite.
La perlaboration implique étroitement les interprétations de l'analyste.
@
7) La créativité comme réparation
M.K. met au premier plan du développement du nourrisson les pulsions de vie, et la relation d'amour satisfaisante à la mère.
Voici ce qu'elle dit p.26 :
" Le "bon" sein qui nourrit et amorce la relation d'amour à la mère est le représentant de la pulsion de vie. Il est ressenti comme étant la première manifestation de la créativité. Au cours de cette relation fondamentale l'enfant reçoit non seulement la gratification qu'il désire, mais éprouve le sentiment d'être maintenu en vie " .
Et puis, un peu plus loin, "L'identification à un bon objet intériorisé, dispensateur de vie, donne une impulsion à la créativité...La capacité de donner et de préserver la vie est ressentie comme le don le plus précieux, et la créativité devient ainsi la cause la plus profonde de l'envie ".
Ça, c'est important!
L'envie : ce mécanisme est inhérent, pour Mélanie à l'existence de la créativité, qui est elle-même liée à l'expérience perturbante avec le conflit : " Tout conflit qui comporte la nécessité de le résoudre constitue un élément fondamental de la créativité"
Pour Mélanie Klein, la créativité est liée à la prédominance des pulsions libidinales sur les pulsions destructrices.
Par rapport à la théorie conventionnelle de la créativité comme mécanisme de sublimation elle apporte à la théorie de la création un différentiel central, car elle considère l'expérience créatrice comme une tentative faîte par le sujet pour réparer les dommages causés par la destructivité aux Objets internes ou externes par les pulsions destructrices.
Ce processus est lui-même associé au travail que le bébé effectue au moment de la position dépressive, c'est à dire à un moment où il commence à engager une relation différenciée avec les objets externes
J'en resterai là avec ce travail d'approche des concepts et positions psycho-analytiques de Mélanie KLEIN.
Je voudrais pour conclure cet exposé, reprendre quelques éléments du jeu conceptuel entre les différents plans du travail d'élaboration, de translaboration et de perlaboration selon que nous engageons des Ateliers d'Expression Créatrice centrés sur l'expression de la personne, et les mêmes ateliers centrés sur le soin analytique. (dans la visée thérapeutique)
Je définirai l'ATELIER D'EXPRESSION CRÉATRICE comme étant essentiellement orienté par la visée translaborative, et le second l'ATELIER D'EXPRESSION CRÉATRICE ANALYTIQUE/ THÉRAPEUTIQUE dans une visée intégrant les deux dimensions translaborative et perlaborative.
Je m'explique.
A la question: que fait l'animateur de façon spécifique dans un Atelier d'Expression Créatrice Analytique "normal" (ça peint et ça élabore l'expérience vécue) ? La réponse serait : l'animateur/analyste conduit le cadre, gère le dispositif, accompagne les processus de création et les catharsis émotionnelles, et s'en tient dans ses interventions au soutien du travail de translaboration. Il n'introduis pas d'activité de co-élaboration des signifiants ; et il reconduit le sujet, chaque fois qu'il y est sollicité, dans la reprise du jeu créateur. Il utilise les forces, il n'en analyse pas un sens qui ne viendrait pas spontanément à la figuration créatrice ou à la figuration psychique pour le sujet lui-même.
Lorsqu'un contrat thérapeutique explicite est posé, alors, l'animateur/analyste participe avec le sujet à un travail commun de construction du sens, et donne au sujet matière à perlaboration de son propre champ de raisonnaces au sens où je le définissais tout à l'heure d'une sorte de nommination de ce qui est là, que le sujet donne à voir et à entendre, des signifiants qui viennent prendre corps dans l'espace psychique et affectif de l'animateur.
Guy Lafargue
Bordeaux le 6 Fevrier 2002
revisité le 1° Mars 2015
Winnicott : La crainte de l’effondrement
Donald Woods Winnicott
(1897–1971)
La crainte de l ’effondrement
Introduction
Cet article, écrit il y a plus de cinquante ans, constitue un des textes majeurs de WINNICOTT pour comprendre un des processus fondamentaux de l'expérience affective que nous rencontrons de façon vigoureuse dans la pratique des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques, et que nous sommes invités à élaborer de façon intelligente. Cette force affective agit de manière puissante dans le cours de l'expérience créatrice ; et son élaboration s'avère être un puissant levier de transformation de la relation que le sujet entretien avec ses angoisses de mort.
J'ai trouvé par le plus grand des hasards ce texte original de Winnicott sur internet. J'ai eu la présence d'esprit de le scanner pour le partager avec mes étudiants. Je n'arrive plus à retrouver sa trace. Je le restitue donc dans son intégralité.
1° Août 2015
Guy Lafargue
@
Texte original
La crainte de l’effondrement
Figures du Vide
Nouvelle Revue de Psychanalyse - Gallimard - 1975
Titre original : « Fear of Breakdown »,
@
« Mes expériences cliniques m’ont amené récemment à une compréhension nouvelle, je crois, de ce que signifie la crainte de l’effondrement. Je me propose ici d’exposer, aussi simplement que possible, cette compréhension nouvelle pour moi et peut être nouvelle aussi pour d’autres personnes qui pratiquent la psychothérapie. »
« Les variations selon les individus »
« La crainte de craquer, de s’effondrer est un trait remarquable chez certains de nos patients, mais pas chez d’autres. De cette observation, si toutefois elle est correcte, on peut conclure que la crainte de l’effondrement est liée à l’expérience antérieure de l’individu et à l’inconstance de son environnement. Mais, en même temps, il faut s’attendre à découvrir dans cette crainte un dénominateur commun qui dénoterait l’existence de phénomènes universels – phénomènes qui mettent donc chacun à même de savoir par empathie ce qui est ressenti lorsque l’un de nos patients manifeste très vivement une telle crainte. »
« L’émergence du symptôme »
« Ceux de nos patients qui souffrent de cette crainte ne s’en plaignent pas tous au début d’un traitement. Certains oui, mais chez d’autres, les défenses sont si bien organisées que la crainte de s’effondrer apparaît au premier plan comme facteur dominant seulement lorsque le traitement a fait des progrès importants. »
« Il se peut, par exemple, qu’un patient ait diverses phobies et une organisation complexe pour y faire face, de sorte que la dépendance n’entre pas rapidement dans le transfert. A la longue, la dépendance deviendra un trait capital et c’est alors que les erreurs et les failles de l’analyse deviendront des causes directes de phobies localisées, et ainsi de l’éruption de la crainte de l’effondrement. »
« Ce que signifie “ s’effondrer ” »
« C’est avec intention que j’ai utilisé le terme "breakdown" parce qu’il est plutôt vague et qu’il peut avoir des significations diverses. Tout bien considéré, on peut, dans un contexte, prendre ce mot comme signifiant la défaillance d’une organisation défensive. Mais une question se pose immédiatement : une défense contre quoi ? Et cela nous conduit à la signification plus profonde du terme, puisqu’il nous faut utiliser ce mot de breakdown pour décrire l’état de choses impensable qui sous-tend l’organisation défensive. »
« On remarquera à ce propos qu’il est légitime de penser que, dans le champ de la psychonévrose, c’est l’angoisse de castration qui se trouve derrière les défenses. En revanche, dans les phénomènes plus psychotiques que nous sommes entrain d’examiner, c’est d’un effondrement de l’édification du self unitaire qu’il est question. Le Moi organise des défenses contre l’effondrement de sa propre organisation, c’est l’organisation du Moi qui est menacée. Mais le Moi ne peut s’organiser contre la faillite de l’environnement dans la mesure où la dépendance est un fait de l’existence. »
« En d’autres termes, nous sommes en train d’examiner un renversement du processus de maturation de l’individu. Il s’ensuit qu’il est nécessaire que je formule à nouveau les premiers stades du développement affectif. »
« Le développement affectif : les premiers stades »
« L’individu hérite d’un processus de maturation, processus qui le fait avancer dans la mesure où un environnement facilitant existe et seulement dans la mesure où il existe. L’environnement facilitant et lui-même un phénomène complexe et nécessite à lui seul une étude spéciale ; il a pour caractère essentiel un développement qui lui est propre, étant adapté aux besoins changeants de l’individu en cours de développement. »
« L’individu passe de la dépendance absolue à l’indépendance relative et va vers l’indépendance. Dans la santé, le développement a lieu à une allure qui ne dépasse pas celle du développement de la complexité dans les mécanismes mentaux, ce développement étant lui-même lié au développement neurophysiologique. »
« L’environnement facilitant peut être décrit comme assurant le maintien (holding), le maniement (handling) auquel s’ajoute la présentation d’objet (object-presenting). »
« Dans un tel environnement, l’individu passe par un développement qu’on peut classer en catégories : l’intégration, à laquelle s’ajoute la résidence (ou collusion psychosomatique)et ensuite la relation d’objet. C’est là une simplification très grossière et exagérée mais qui peut suffire dans ce contexte.
« La dépendance absolue »
« À l’époque de la dépendance absolue, quand la mère assure une fonction de "moi auxiliaire", il ne faut pas oublier que le nourrisson n’a pas encore fait la distinction entre le « non moi» et le « moi » - ce qui ne peut se produire sans l’édification du «moi ».
« Les agonies primitives »
« À partir de ce tableau, il est possible de faire la liste des agonies primitives (l’angoisse ne serait pas ici un mot assez fort).
En voici quelques-unes :
- Le retour à un état non intégré (Défense : la désintégration)
- Ne pas cesser de tomber (Défense : l’auto-maintien)
- La perte de la collusion psychosomatique, la faillite de la résidence dans le corps (Défense : la dépersonnalisation)
- La perte du sens du réel (Défense: l’exploitation du narcissisme primaire, etc.)
- La perte de la capacité d’établir une relation aux objets(Défense: les états autistiques, l’établissement de relations uniquement avec des phénomènes issus de soi)
Et ainsi de suite.
« La maladie psychotique en tant que défense »
« Mon intention est de montrer maintenant que ce que nous voyons cliniquement est toujours une organisation défensive, même dans l’autisme de la schizophrénie infantile. Les agonies qui le sous-tendent sont impensables. C’est une erreur de considérer l’affection psychotique comme un effondrement. C’est une organisation défensive liée à une agonie primitive ; elle est ordinairement couronnée de succès(sauf si l’environnement facilitant le développement a été non pas déficient mais a suscité un espoir toujours déçu, ce qui est peut-être la pire des choses qui puisse arriver à un petit d’homme).
« Énoncé du thème principal »
« Il m’est possible maintenant d’exposer le point principal de ce que j’affirme, et il se révèle être très simple. Je soutiens que la crainte clinique de l’effondrement est la crainte d’un effondrement qui a déjà été éprouvé. C’est la crainte de cette agonie originelle qui a causé l’organisation défensive que le patient manifeste sous la forme d’un syndrome de maladie. »
« Cette idée peut ou non s’avérer utile immédiatement pour le clinicien. Nous ne pouvons presser nos patients. Néanmoins, nous pouvons freiner leur progrès par ce que nous ne savons authentiquement pas ; tout fragment, si minime soit-il, de notre compréhension peut nous aider à rester proches des besoins d’un patient. D’après mon expérience, il ya des moments où un patient a besoin qu’on lui dise que l’effondrement, dont la crainte mine sa vie, a déjà eu lieu. C’est un fait qu’il porte caché dans l’inconscient. L’inconscient dont il est ici question n’est pas exactement l’inconscient refoulé de la psychonévrose ; ce n’est pas non plus l’inconscient de la formulation freudienne, cette partie de la psyché qui est très proche du fonctionnement neurophysiologique. »
« Dans le contexte particulier dont je parle, l’inconscient signifie que l’intégration du moi n’est pas en mesure d’englober quelque chose. Le moi est trop immature pour rassembler tous les phénomènes dans le champ de la toute-puissance personnelle.»
« Il faut se demander maintenant : pourquoi le patient continue-t-il à être tourmenté par cela, qui appartient au passé ? La réponse doit être mise au passé que si le moi peut d’abord la faire entrer dans sa propre expérience du temps présent et dans la maîtrise toute-puissante actuelle (assumant la fonction de soutien du moi auxiliaire de la mère (l’analyste). En d’autres termes, le patient doit continuer à rechercher le détail passé qui n’a pas encore été éprouvé. Cette quête prend la forme d’une recherche de ce détail dans l’avenir.
« Tant que le thérapeute ne sera pas à même de travailler avec succès en se fondant sur l’hypothèse que ce détail est déjà un fait, le patient continuera à craindre de trouver ce qui est recherché sur un mode compulsif dans l’avenir. »
« Par ailleurs, si le patient est prêt à accepter quelque peu cette vérité d’un type bizarre, alors la voie se trouve ouverte pour que cette agonie soit éprouvée dans le transfert, en réaction aux défaillances et erreurs de l’analyste. Le patient peut faire face à celles-ci lorsque les doses ne sont pas excessives et il peut justifier chaque faille technique de l’analyste par le contre-transfert. »
« Tout cela est très difficile, prend du temps et est pénible, mais au moins ce n’est pas futile. Ce qui est futile, c’est l’autre possibilité et c’est ce qu’il nous faut examiner maintenant. »
« La futilité dans l ’analyse »
« Cet article se propose d’attirer l’attention sur le fait qu’il est possible que cet effondrement ait déjà eu lieu et se soit situé peu après le début de la vie de l’individu. Il faut que le patient « se le rappelle », mais il n’est pas possible de se rappeler quelque chose qui n’est pas encore arrivée, et cette chose du passé ne s’est pas encore produite parce que le patient n’était pas là pour que cela lui arrive. La seule façon de « se le rappeler » dans ce cas, c’est que le patient ait pour la première fois l’expérience de cette chose passée dans le présent, c’est-à-dire dans le transfert. Cette chose passée et future devient alors une question d’ »ici et maintenant », et est ressentie par le patient pour la première fois. C’est l’équivalent de la remémoration et cet aboutissement équivaut à la levée du refoulement qui se produit dans l’analyse du psycho névrosé (dans l’analyse freudienne classique).
« Il n’y a pas grand-chose à modifier pour transférer la thèse générale de crainte de l’effondrement à une crainte spécifique de la mort. C’est là d’ailleurs peut être une crainte plus courante et une crainte qui se trouve absorbée dans les enseignements religieux sur la vie future, comme pour nier le fait de la mort. »
« Lorsque la crainte de la mort est un symptôme majeur, la promesse d’une vie de l’au-delà ne parvient pas à apporter un soulagement ; la raison en est que, chez un tel patient, la quête de la mort est une compulsion. Là encore, c’est la mort, qui a eu lieu mais n’a pas été éprouvée, qu’il cherche ainsi. »
« La plus grande partie de mes concepts m’a été inspirée par mes patients, envers lesquels je reconnais ma dette. C’est à l’un d’eux que je dois l’expression « la mort phénoménale ». Ce qui s’était produit dans le passé était la mort en tant que phénomène mais non en tant que fait du type que nous observons. Nombreux sont les hommes ou les femmes qui passent leur vie à se demander si la solution est le suicide, c’est-à-dire envoyer le corps à la mort qui s’est déjà produite pour la psyché. Le suicide n’est toutefois pas une réponse ;c’est un geste de désespoir. Je comprends maintenant pour la première fois ce que voulait dire ma malade schizophrène (qui s’est tuée) lorsqu’elle disait : « Tout ce que je vous demande de faire est de m’aider pour que je me suicide pour la vraie raison et pas pour la fausse.» Je n’y ai pas réussi et elle s’est tuée en désespoir de cause. Son but (tel que je le vois maintenant) était de parvenir à ce que je lui dise qu’elle était morte dans petite enfance. Sur cette base je pense qu’elle et moi aurions pu la mettre en mesure de retarder la mort du corps jusqu’à ce que la vieillesse réclame ses droits. »
« La mort, vue de cette façon comme étant quelque chose qui est arrivée au patient mais que le patient n’était pas assez mûr pour éprouver, a le sens de l’anéantissement. Voici ce qui en est : un schéma s’est élaboré où la continuité d’être a été interrompue par les réactions infantiles du patient à l’empiètement, c’est-à-dire aux facteurs de l’environnement que celui-ci a, en raisin de défaillances, laissé empiéter sur le développement. (Dans le cas de cette patiente, les troubles ont commencé très tôt car il y a eu une conscience prématurée éveillée avant la naissance à cause d’une panique de la mère, et,en plus de cela, la naissance a été compliquée par un placenta praevia non diagnostiqué.)
Le vide.
« Là encore, ce sont mes patients qui m’ont montré que le concept de vide peut lui aussi être vu sous la même optique.»
« Chez certains patients, il est nécessaire que le vide soit éprouvé ; et ce vide appartient au passé, à l’époque où le degré de maturité n’avait pas encore permis l’expérience du vide. Pour le comprendre, il est nécessaire de penser non pas au trauma, mais plutôt que rien ne s’est passé quand cela aurait pu se passer. Pour un patient, il est plus facile de se rappeler un trauma que de se souvenir que rien ne s’est passé quand cela aurait pu se passer. A l’époque, le patient ne savait pas ce qui aurait pu se passer et il ne pouvait donc pas ressentir quelque chose si ce n’est noter que quelque chose pu être. »« Le vide qui se produit dans un traitement est un état que le patient essaye d’éprouver, un état passé qui ne peut être remémoré sauf s’il est éprouvé pour la première fois maintenant. En pratique, la difficulté réside dans ce que le patient redoute le caractère effrayant du vide et qu’il organisera, pour s’en défendre, un vide contrôlé par exemple, en ne mangeant pas ou en n’apprenant pas ; ou encore il se remplira sans merci par une gloutonnerie compulsive et ressentie comme folle. Lorsque le patient peut aller jusqu’au vide même et supporter cet état, grâce à la dépendance à l’égard du moi auxiliaire de l’analyste, absorber peut alors apparaître soudain comme une fonction qui donne du plaisir ; c’est à ce moment-là que manger peut commencer à être autre chose qu’une fonction dissociée (ou issue par clivage) en tant que partie de la personnalité ; de même manière, quelques-uns de nos patients, jusque-là dans l’impossibilité d’apprendre, peuvent commencer à apprendre avec plaisir. »
« Le vide est à la base d’apprendre aussi bien que de manger. Mais si l’expérience du vide n’a pas été éprouvée comme telle au début, cela devient alors un état qui est redouté et pourtant compulsivement recherché. »
La non-existence.
« La quête d’une non-existence personnelle peut aussiêtre étudiée de la même façon. On découvrira qu’ici la non existence fait partie d’une défense. L’existence personnelle est représentée par les éléments de projection et la personne s’efforce de projeter tout ce qui pourrait être personnel. Cela peut être une défense relativement complexe ; elle vise à éviter la responsabilité (au moment de la position dépressive) ou éviter la persécution (à ce que l’appellerai le stade de l’affirmation de soi, c’est-à-dire le stade du Je suis avec son implication inhérente : Je répudie tout ce qui n’est pas moi).On retrouve une bonne illustration dans le jeu de l’enfant : «Moi, je suis le roi du château et toi, tu es le vilain gredin. »
« Dans les religions, cette idée peut apparaître dans le concept de ne faire qu’un avec Dieu ou avec l’univers. On peut voir cette défense niée dans les écrits et la doctrine existentialistes, où exister donne lieu à un culte, en tentant par là de contre-balancer la tendance personnelle à la non existence qui fait partie d’une défense organisée. »
« Il peut y avoir un élément positif dans tout cela, c’est à-dire un élément qui n’est pas une défense. L’on peut dire que ce n’est que de la non-existence que l’existence peut commencer. Il est surprenant de constater à quelle période précoce une conscience d’un moi prémature peut être mobilisée (même avant la naissance, certainement au cours du processus de la naissance). Mais l’individu ne peut pas se développer à partir d’une racine du moi si celle-ci est séparée de l’expérience psychosomatique et du narcissisme primaire. C’est exactement là que commence l’intellectualisation des fonctions du moi. On notera à ce propos que tout cela se situe temporellement bien avant que se soit édifié ce quelque chose qu’on pourrait à bon droit appeler le Self. »
@
C'est la faute à Winnicott !
C'est la faute à Winnicott !
(publié par la revue de la Société Française d'Éducation et
de Rééducation psycho-motrice : "Pratiques Corporelles")
Guy Lafargue
@
Si t'es un accro de mes écritures théoriques, t'auras remarqué qu'il y avait longtemps que j'avais pas trempé ma plume pour te cajoler le neurone dans le sens de la mouette [1]. Si par contre tu débarques et que t'as l'esprit à l'affût, bienvenu dans ma pensée buissonnière.
Figures toi que la semaine dernière, mon patron m'a offert une formation permanente avec une nana tout à fait spécifique qu'a bricolé un cabinet de thérapie comme j'en aurais eu besoin à certaines périodes black de mon existence de psychologue dévoyé. Un truc qu'a de la tradition chez les britishs, qui s'appelle "Play-thérapie", qu'est construit comme la caverne d'Ali Baba façon Perrault, selon les principes de mon pote WINNICOTT.
La nana en question s'appelle Vérity Jane [2]. Une dame respectable, une vraie british rigolote, inventive, instable, possédée par son sujet, bourrée d'énergie qui raconte des trucs pas possibles sur les mômes qui se sont fait ramoner leur petite fleur de lotus par de vieux salauds. Elle soigne ces mômes-là avec des peluches, des flaques d'eau, des tas de sable, des crayons de malheur, des coussins de colère, des poupées solubles, des monstres terribles en plastoche, des boîtes à lettres privées, des sanctuaires de papier et plein de zobjets en bois, en ficelle, fil de fer, caillou, coquillages, plumes et tcétéra. Tout ça m'a donné envie de te parler en détail de mon pote WINNICOTT qu'est un vrai phénomène de foire.
Zoparavant, deux choses !
1) Je voudrais te partager un petit bout de mon rêve de théoricien qui est que j'ai satisfaction profonde à permettre aux gens sans réelle culture psy (qui se vivent souvent comme des handicapés intellectuels devant l'arrogance du savoir), à tous ceux qu'ont pas nécessairement craché au bassinet d'une psychanalyse homologuéée (y'a des gens matures) ou qu'ont pas composté leur ticket à l'Université, et qui sont par ailleurs très motivés pour s'engager dans la voie dangereuse de l'expérience créatrice et de son utilisation comme via ferrata vers la pratique analytique [3]. De permettre donc à ceux-là de se munir d'un jeu de représentations claires, basiques, concernant un certains nombre de choses qu'ils vont devoir traverser pendant leur formation intellectuelle dans ma crèmerie.
Connaissances nécessaires sur ce que sont : la vie affective, les processus psychiques, la vie f(ph)antasmatique individuelle et groupale…tous processi (hé oui ! chez les latinos, ça se décline comme ça au pluriel !) qui expliquent en partie (et permettent de mieux comprendre) la façon dont nos contemporains passent de l'état de mammifère à l'état de petits humains. Une sorte de science naturelle de la vie psycho-affective que tu pourras utiliser pour comprendre ce qui se passe chez tes clients lorsque tu les places dans un cadre analytique, ce qui est le cas lorsque tu animes des Ateliers d'Expression Créatrice versus Art CRU. A cet égard, WINNICOTT a bossé pour toi et moi. Il a établi de solides accroches théoriques que je vais te récapituler dès que j'en aurai fini avec les préambules[4]. C'est bien possible que, parfois, t'auras du mal à identifier ce qui est de WINNICOTT et ce qui est de mon CRU. C'est la faute à WINNICOTT. Je fais pleinement confiance aux snippers de l'orthodoxie pour vitupérer contre le caractère subjectif de certains de mes propos et pour redresser la vérité.
2) Je tiens aussi à te donner une clé concernant la ligne directrice de ma propre pensée personnelle à moi, ligne que je poursuis avec obstination depuis lurette, qui te permettra de comprendre pourquoi je m'intéresse autant à ce type : WINNICOTT. Je considère en effet que c'est l'expérience affective qui constitue le centre de toute compréhension des processus de croissance : émotionnelle, intellectuelle, relationnelle et des mouvements de régression du sujet humain. Le corollaire de ce point de vue indiscutableest que la vie psychique est toujours travail de représentation mentale formé en aval et à partir de cette force basique de l'affectivité, comme épiphénomène du travail affectif qui est visé dans toute situation analytique. Ça, c'est la donne majeure de mon enseignement. Si tu te cales pas ça derrière les sinus, tauras du mal à décrocher de la métapsychologie de Pépé FREUD.
La vie psychique n'est pas causale. Elle n'est en aucune façon productrice de sens, mais toujours effet de sens . Cette chose très importante, radicale (radicus dont se privent les adeptes), encore plus subversive aujourd'hui, introduit une démarcation brutale d'avec les systèmes théoriques spéculatifs qui ont fait de la psyché le veau d'or du travail analytique, qui tordent le nez sur les ressources considérables de l'expérience créatrice, les ânes ! Cale toi bien ce truc là entre les sinus : la vie psychique est le fond mental constant dans lequel l'humain puise pour se représenter le lien inconscient qu'il entretient avec le monde dans sa tentative toujours entravée de devenir sujet.
Une fois ceci avoué, faudrait voir maintenant à pénétrer dans le sujet. Croyes bien que je te pousse pas à me lire. Y'a déjà plein d'autres gens respectables que je voudrais pas froisser le surmoi qu'ont écrit des choses très censées et fondamentales sur Donald WINNICOTT. Moi, c'est la pure forfanterie qui me pousse. C'est la faute à ma pulsion otodidacte compulsive à expliquer dans un vrai langage, simple, goûteux, cajoleur, ce que ce type là à fait cadeau à l'humain de base qui a envie de s'occuper de son prochain avec intelligence et sensibilité.
Une théorie pour travailler
Pardonne-moi , mais il me reste encore un truc à t'introjecter au sujet du mot "théorie". Un truc que je répète à la moindre occase, au risque de passer pour un radoteur, mais tu verras, je crois que ça en vaut la peine.
"Théorie" (en anglish "theory") est un mot qui vient du verbe grec "theorein" qui signifie "observer". Une théorie n'est ni une opinion personnelle, ni une spéculation, ni une doctrine. C'est une observation fidèle de certains phénomènes qui apparaissent et se développent dans un contexte donné, construit en vue d'explorer, puis de vérifier, la valeur de certaines hypothèses sur le fonctionnement des choses. C'est un ensemble d'observations portant sur une expérience spontanée ou construite, sur lequel l'expérimentateur/observateur (le théoricien) se livre ensuite à un travail d'élaboration, de réflexion, de corrélations, de formulation d'hypothèses en fonction d'un objectif qu'il cherche à atteindre ou dont il cherche à vérifier ou à valider la pertinence. L'expérience, remaniée par les découvertes dont elle est productrice, constitue le lieu de cette validation. C'est cela qui est désigné par le mot de praxis : ce va et vient entre création du cadre où se développe l'expérience, accompagnement de l'expérience, observations de ses effets, mise à l'épreuve, vérification ou invalidation des hypothèses constituant le cadre, ajustement ou formulation de nouvelles hypothèses et modification du cadre. C'est à peu près cela la démarche scientifique.
Ce que je tenais à te signifier par là, c'est que la théorie n'est pas la chasse gardée des intellos, ni la propriété privée des gardiens de la doctrine de la foi. Être théoricien est à la portée de toute personne engagée dans une action délibérée de recherche de son lien à la connaissance. A la connaissance comme mode d’expérience et à la connaissance comme savoir constitué. Bien entendu, cela est exigeant. Cela suppose une sorte d'éthique de base protégé du narcissisme de vitrine, fondée sur l'honnêteté du processus de pensée et sur la sincérité. Dans le champ de l'expérience créatrice, tu peux apprendre et construire un savoir par l'expérience sans être tenu d'avoir fait quinze ans de psychanalyse, ni même de connaître les théories qui se déchirent dans l'arène corporatiste. L'ouverture à l'expérience, à l'expérience vécue, est la ligne directrice de ce que tu pourras apprendre chez moi si ma démarche rentre en raisonnance profonde avec tes propres préoccupations. Le savoir qui n'est pas construit dans l'expérience ne sert à rien. L'enseignement qui substitue un savoir à l'expérience est dommageable et ne forme que des mounaques.
Dans le domaine qui nous préoccupe - celui de l'expérience créatrice comme pratique métamorphique (transformationnelle) – avec les futurs praticiens d'Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques c'est ainsi que nous procédons : création du cadre (Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques), appel d'offre, immersion des personnes dans les différents dispositifs construits pour traverser l'expérience, élaboration de la "théorie" personnelle de l'expérience vécue et des inductions du cadre, et mises en perspective "théoriques" avec les travaux de recherche faisant autorité dans le champ que nous explorons.
Ce champ s'organise autour des problématiques suivantes : théorie de la formation de la structure affective (bricolage personnel), de la formation de la vie psychique et de ses déterminants affectifs (WINNICOTT), la dynamique de la vie f(ph)antasmatique[5] (Françoise DOLTO, Mélanie KLEIN), la dynamique de la relation interpersonnelle "centrée sur la personne" (Carl ROGERS) et enfin la phénoménologie psycho-affective dans les groupes restreints (Max PAGÈS).
C'est à partir de ces auteurs (et de quelques autres dans leur sillage) dont le cadre de travail analytique croise de façon significative la dynamique de l'expérience créatrice, que je soutiens mon propre travail d'interrogation de l'expérience æsthétique dans les Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques ©. Ce champ "praxique" est celui de l'expérience créatrice, par essence lieu privilégié où viennent en permanence se mettre en tension libératrice vers la représentation les traces des évènements originaires (par définition inconscients) qui ont été source de souffrances ou de traumatismes non résolus, évènements dont l'inscription mnésique est déterminante des liens actuels qui nous relient au monde.
Bon, cette fois, c'en est fini des hors d'œuvre, on peut apporter la pièce de boucherie
@
DOCTEUR DONALD
ET MISTER DOUDOU
Donald WINNICOTT était, dans l'ordre : anglais, né en 1896 [6], psychiatre de mômes, tombé dans la marmite psycho-analytique d'un élève de la dénommée Mélanie KLEIN (l'arrière grand-mère de Goldorak) dans les années 1930. Malgré cela, il est mort en bonne santé en 1971, ce qui ne prouve rien, certes, mais tout de même…quand les vivants clamsent dans leur lit avec l'odeur de leurs chaussettes aux pieds, moi, ça me fait du bonheur. On peut pas en dire autant de son copain BETTLEHEIM Bruno qui s'est éteint la mèche au dioxyde de carbone dans un sac de Supermarket en plastique biodégradable; ni celui de Jacques, dit le LACAN, qui s'était inscrit à l'amicale des obsédés du nœud ; ni celui de Pépé FREUD, addict au cigare, tenaillé par un scepticisme insondable et par les effets secondaires de son addiction à la cocaïne…
@
D'abord, faut que tu saches que WINNICOTT a été un emmerdeur de psychiatres et psychanalystes intégristes, primo parce qu'il était intelligent et qu'il maîtrisait son sujet, et secundo parce qu'il faisait des psychanalyses d'enfants à quatre pattes dans ses cabinets. WINNICOTT était pédopsy et, comme le rappelait volontiers feu le pape Benoît 16 (au 16° on ne répond plus de rien), faut pas confondre pédopsy avec pédéraste. Par les temps de pédophiles qui courent, ça mérite un coup de chapeau. Puis après, dans les années 1930, allaité à la mamelle Kleinienne, il est devenu psychanalyste. Et tout en rafistolant l'armure freudienne pour la rendre compatible avec son amour des enfants, il a observé et gambergé une théorie et une pratique du travail analytique placées sous le signe du jeu et de la créativité.
WINNICOTT, c'était pas un homme préoccupé de chefferie. C'était un homme de terrain, une sorte de poête dans le monde grégaire des psy : inventif, libre, critique, rebelle aux hégémonies intellectuelles du temps. Il ne cultivait pas l'ésotérisme dans les carrés mondains. Ce n'était pas un de ces ronds de cuir de la pensée qui ne connaissent les choses de l'expérience que par ouïe lire. Curieux, généreux, confiant dans l'orientation créatrice profonde des zêtres humains. Empêcheur de conceptualiser en ronron, il prenait à l'évidence un profond plaisir à construire une pensée claire et incisive à partir des enseignements de l'expérience clinique dont il modelait la matière au gré de ses intuitions. Un homme qui faisait confiance dans l'expérience. Il était grave, profond et plein d'humour pour parler du jeu analytique, et d'une simplicité exemplaire pour analyser les tragédies à l'œuvre dans l'espace thérapeutique.
@
LE BÉBÉ N'EXISTE PAS
De l'indifférenciation primordiale
à la perception du monde
Un beau jour de purée de pois (pea soup), alors qu'il s'adressait au parterre éclairé de la Société British de Psychanalyse, il dit cette phrase absurde comme quoi "le bébé n'existe pas". Il veut dire par là que ce qui existe, c'est un nourrissonmère, un truc homogène, inséparable, incompréhensible autrement que comme cette chose affective protoplasmique qu'il appelle une "dyade". Ça veut dire concrètement que pour le nouveau né, ce qui existe au début, c'est pas une mère et lui, c'est un monde sensationnel bouche/sein, sans discontinuité. La bouche et le sein sont un même objet/lieu/matière. Les psychanalystes de salon appellent ça "l'Objet a"…prononcer "petit a"). Cale toi bien ça dans le cortex préfrontal, parce que cette expérience là est à la source de tout ce qui va t'arriver de divin et d'infernal par la suite, dans ta tentative de devenir.
Au début, pour le nouveau-né, le monde tel que nous le percevons n'est pas encore constitué, sinon sous la forme indifférenciée d'évènements sensoriels/sensuels/ émotionnels/affectifs. Il n'y a pas de perception, pas d'écart par où commence à se former l'idée d'un autre. L'idée de Mémélanie [7] qu'il y a un "Moi" dès l'origine est du bidon. En particuliers, le bébé ne perçoit pas une mère à l'extérieur, pas plus qu'il n'est capable d'identifier des évènements internes. Sa Majesté Bébé existe dans une continuité d'être bouche/sein (et dans toutes les extensions de ce mode primordial de satisfaction vitale). Il réagit à tous les stimuli internes et externes sur un mode instinctif (sur un mode affectif pur) sans en distinguerer une provenance.
Le problème qu'il a à résoudre est de passer de cet état symbiotique, quasiment hallucinatoire, de totale dépendance à l'Objet, à l'état de sujet relié à l'Objet (interdépendant).
Pour pouvoir faire ce passage, cette transition de la symbiose à l'individuation, le petit mammifère humain va devoir travailler à transformer ces expériences hallucinatoires (protopsychiques) en représentations psychiques organisées et en activité de penser. Le jour où t'as pigé ça, t'as compris l'essentiel de ce qui a conditionné ton destin jusqu'au trognon. C'est ce passage de la sensation au symbole que WINNICOTT a appelé les " phénomènes transitionnels". Transition du Réel [8] (le monde des sensations et affects originaires) vers le Symbolique (la pensée en mots) via l'Imaginaire (la pensée en images).
La boîte à outils conceptuels
Les anglais ont un atout linguistique qui plaide en leur faveur : pour signifier le caractère actuel (actionnel) de la réalité désignée par un mot, ils le déclinent au participe présent en y ajoutant le suffixe "ing". Par exemple le mot "play", qui désigne à la fois le verbe "jouer" ("to play") et le nominatif "jeu", se transforme en "playing" (le jeu) qui signifie l'acte, la participation présente, le processus lui-même de jouer, dans sa dimension d'actualité vécue. La transformation de "jouer" (to play) en "jouant" (playing) vient surligner le caractère d'actualité dynamique à l'œuvre dans ce dont il est question : ainsi en va t'il de :
"expériencing" pour désigner le processus de ce que moi je traduis par "expérienciation"; et des autres termes forgés par WINNICOTT : " holding" (le portage du bébé), "handling"(les manipulations du corps pendant les soins physiques), "object-présenting" (pour désigner le don du sein, puis de tout ce que la mère apporte au bébé). La langue française utilise aussi cette forme grammaticale ("étudiant") où la redécouvre lorsqu'elle parle de l' "analysant" pour désigner l'acteur du travail analytique.
Y'a un autre truc linguistique qu'on partage avec les britishs selon que ça t'arrange l'inconscient : sur un même mot/concept dans l'une des deux langues, t'as deux mots dans l'autre qui désignent des nuances qualitatives parfois tranchées. Par exemple :
- Les anglais ont deux mots "play" et "game" pour le même unique mot français "jeu" (play = jeu spontané, game = jeu à règles), " care" et cure" pour le mot "soin" (cure = soin médical, "care" = attention portée à la personne, au sens de "prendre soin").
- A partir du verbe "créer" (to create) et du même nom dans les deux langue "création", les français possèdent deux adjectifs "créateur" et "créatif" alors que les anglais - me semble t'il - n'en ont qu'un, le mot "créative" qui se substantifie en " créativity", que l'on retrouve également en français ramené de façon ambiguë au mot "créativité".
Tu te demande bien où je veux en venir ? J'y viens.
En définissant l'Art CRU (Expression Créatrice Analytique) comme praxisd 'évolution de la personne et comme "modèle" proposé à l'identification, dans le cadre d'une formation de praticiens, j'ai nécessité éthique à définir avec clarté le champ conceptuel singulier conquis à partir de trente années d'expérienciation de ce cadre spécifique posé dans la Charte des Ateliers d'Art CRU.
Ce cadre et les dispositifs qu'il met en jeu, est entièrement différent de celui de disciplines voisines : essentiellement celui de la psycho-analyse freudienne, de ses variantes orthodoxes ou dissidentes, de ses dérives (la psychanalyse appliquée); et celui des courants comportementalistes, syncrétiques, fondés sur les manipulations arthopédiques du jeu (game) . Ses effets en portent la marque singulière et constituent un champ théorique singulier.
La "créativité" est un de ces concepts-valise revendiqué pour justifier toutes les dérives de la psychanalyse appliquée, de la psychiatrie comportementale et de certaines (pas toutes) méthodes d' "arthérapie créative" qui n'ont pour autre visée que de masquer le caractère syncrétique et comportementaliste de ces pratiques de la résistance à l'expérience créatrice. Ceci ne s'applique pas à mon pote WINNICOTT
L'activité créatrice primaire
Peut-être tu comprends mieux maintenant où je voulais en venir avec ma gymnastique linguistique : à préciser mon point de vue singulier comme quoi le mot français "créativité" repose sur des sables mouvants et qu'il n'est pas en mesure de rendre compte de ce que WINNICOOT et ses traducteurs français nomment (à tord) "la créativité" (le "creating").
"Être créatif" n'est pas nécessairement être "créateur" au sens Winnicottien (en tous cas, pas au mien). A preuve cette immense étendue de désolation esthétique que l'on a appelé "l'Art contemporain" (des années 1960 aux années 1990…art ex-contemporain qui traîne encore aujourd'hui ses casseroles). Cet art consumériste surmédiatisé et mercantile, lorsqu'il fait preuve de beaucoup de créativité, demeure bien souvent totalement dénué de ce travail intérieur de l'expérience créatrice. A preuve du contraire, la vitalité de l'extraordinaire aventure de l'Art BRUT conduite par le peintre Jean DUBUFFET, dont la marque majeure reste une fabuleuse inventivité, une totale et permanente singularité, et une incapacité aussi totale à assimiler le monde et à développer un Soi intégré dans le jeu de la création. Ceci s'applique bien évidemment à beaucoup d'artistes culturels, géniaux ou non, dont l'œuvre échoue à réaliser cette intégration du Moi dont l'expérience créatrice est le vecteur essentiel. Aussi, je propose de recourir à l'équivalent tonique de ce que serait le terme "creating" signifié dans son acception dynamique par le terme français "expérience créatrice", pour désigner ce dont il est question lorsque nous parlons des processus créateurs tels qu'ils se développent dans l'Atelier d'Expression Créatrice. De même je remplacerai systématiquement ici la traduction de "pulsion créative" par "pulsion créatrice" (je l'ai personnellement nommée " pulsion métamorphique". Je prétends ainsi marquer une fidélité sans faille à WINNICOTT (manière de pas fricoter avec les tentations syncrétiques de l'arthopédie).
Ceci dit, WINNICOTT utilise deux termes pour désigner cette zone particulière de l'expérience somato-psychique concernant le travail de la création subjective. Il utilise les termes d'activité créatrice primaire pour désigner la capacité de l'organisme du petit humain d'ouvrir dans sa propre expérience intérieure un monde de représentations des liens qu'il construit avec son environnement, et, en particulier, au début, avec le sein, puis avec sa mère comme personne entière et séparée, enfin avec l'environnement et l'expérience culturelle.
Pour WINNICOTT, l'expérience créatrice primaire est le processus lui-même du travail de construction psycho-affectif inhérent à la séparation réussie, c'est à dire à son acceptation constructive sans angoisse majeure invalidante.
La fondation de ce processus nous est donnée par cet évènement extraordinaire dont personne ne conteste la légitimité, qui est que, de manière ordinaire, quand le nourrisson se réveille en proie au besoin de recevoir de la nourriture, la mère est là qui lui donne le sein. Si bien que lorsque cette opération se renouvelle de façon satisfaisante, le bébé commence à former un sentiment comme quoi la tension orale (où toute l'énergie se concentre) donne forme au sein nourricier. Le bébé crée le sein là où existe un sein qui est trouvé. Cela tient évidemment à ce que le nouveau-né vient au monde sans aucune référence préconstruite. Il ne peut pas interpréter le monde tant qu'il n'a pas appris le code affectif qui le lie aux réponses de l'environnement. Il ne peut seulement qu'être traversé de sensations inconnues qui vont progressivement se constituer en un capital affectif associé à des formations psychiques encore inorganisées que l'on appelle phantasmes, de nature hallucinatoire. L'expérience psychique originaire (phantasme) est chaotique, insensée. Elle est le pur reflet des expériences somato-affectives pour lesquelles n'est pas encore constitué un logiciel organisateur de perception. Et la mère est là, à la place justement où le nouveau-né a exactement besoin qu'elle soit, porteuse, contenante (elle réactive le sentiment foetal par sa tendresse) et donc détoxicante des angoisses de mort originaires.
Pour expliquer ce processus, WINNICOTT nous dit que très tôt dans son développement " le petit enfant, dans un certain environnement fourni par la mère, est capable de concevoir l'idée de quelque chose qui rencontrerait le besoin croissant suscité par la tension instinctuelle ".
De ce "paradoxe" du "trouvé/créé", qui est fondamentalement acte de création, découle l'instauration de ce que WINNICOTT appelle le sentiment d'omnipotence, c'est à dire un processus d'illusionnement selon lequel le nourrisson expérimente que le désir crée et contrôle l'Objet de la satisfaction. " L'adaptation de la mère aux besoins du petit enfant donne à celui-ci l'illusion qu'une réalité extérieure existe qui correspond à sa propre capacité de créer ". WINNICOTT ajoute que subjectivement, " Il n'y a pas d'échange entre la mère et l'enfant. Psychologiquement, l'enfant prend au sein ce qui est partie de lui-même, et la mère donne du lait à un enfant qui est partie d'elle-même ". Il ajoute que cette expérience de l'omnipotence est nécessaire au nourrisson pour installer dans son expérience subjective un sentiment stable de la fiabilité de l'Objet (l'Objet = le sein = la mère).
Après l'installation du premier grand marqueur affectif qu'est l 'expérience de la naissance, se met en place ce second marqueur affectif qui doit permettre au nourrisson de se préparer à découvrir que le sein/bouche est un Objet instable, volatile, que l'Objet/mère a une vie indépendante, et qu'il va commencer à se ressentir lui-même comme être séparé.
@
A la différence de l'expérience créatrice primaire, qui est un processus psycho-affectif structurant, maturant, la créativity (l'expérience créatrice) est un concept servant chez WINNICOTT à désigner une disposition générale des organismes humains : " Il s'agit d'un mode créateur de perception qui donne à l'individu le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue".
Une des fonctions de la créativity est de "permettre à l'individu l'approche de la réalité extérieure", de passer de l'expérience subjective totale à l'expérience subjective/objective partielle. Cette fonction "est inhérente au fait de vivre". C'est cela qui intéresse fondamentalement WINNICOTT, ce travail qui permet de passer d'une totale subjectivité à la perception partiellement objective du monde. Ce qui s'oppose à la créativité, " c'est une relation de complaisance soumise enversla réalité extérieure : le monde et tous ses éléments sont alors reconnus, mais seulementcomme étant ce à quoi il faut s'ajuster et s'adapter. La soumission entraîne chez l'individuunsentiment de futilité associé à l'idée que rien n'a d'importance ". A cet endroit de sa réflexion WINNICOTT ouvre une question particulièrement intéressante pour nous concernant le processus de la perception. Il dit littéralement ceci sous forme de constat que : "Ce qui est objectivement perçu est, jusqu'à un certainpoint, subjectivement construit". En clair cela veut dire que ce que nous croyons être objectif dans notre rencontre avec la réalité est jusqu'à un certain point fondé sur une construction subjective, sur une illusion, maximale au départ de l'existence.
Pour conclure sur ces variations, je résumerai quelques autres incisions de la pensée de WINNICOTT sur la créativity en soulignant en particuliers celles-ci qui s'adressent plutôt à ses collègues, comme quoi les psychanalystes se sont trompés en abordant la question de la créativity sur son versant anamnétique, c'est à dire de la reconstruction historique poursuivie comme but. Il note, avec beaucoup de délicatesse, que FREUD, entraînant ses disciples à sa suite, se fourvoyait lorsqu'il axait son investigation sur l'œuvre d'artistes célèbres et sur l'anecdotique reconstitution de leur histoire infantile. Ce faisant, affirme WINNICOTT, c'est le processus lui-même de l'expérience créatrice qui est perverti, et sa fonction primaire d'intégration du Moi qui est manquée, parfois de façon tragique par les artistes. WINNICOTT pense et exprime clairement l'opinion selon laquelle la quête artistique est une impasse pour la constitution du sentiment de soi.
Processus de maturation : le Moi
La tendance innée à l'intégration du Moi
Ce que WINNICOTT appelle le Moi n'est pas une entité concrète. Selon moi, le Moi est un phénomène lié à la construction de ce processus qu'on appelle la perception : "être conscient de…". Le "Moi" est à proprement parler une expérience de rassemblement d'éléments hétérogènes d'évènement vécus, éprouvés/ressentis et progressivement intégrés en une unité dont se dégage et s'éprouve le sentiment d'être (" le narcissisme primaire ou primordial"). Le Moi est une qualité du sentiment d'être rapportée aux évènement vécus qui permet au bébé de commencer à se différencier d'un non-moi, de s'éprouver dans un continuum d'être hors de l'emprise de l'@utre/le sein/la mère. L'expérience du moi a trait à la conscience/perception d'un ensemble d'éprouvés et de représentés dans la réalité ou dans l'imaginaire.
A la théorie des psycho-analystes qui postulent que le Moi est en place dès le début de l'existence (Mélanie KLEIN) et qu'il a une fonction défensive contre les pulsions destructives, WINNICOTT oppose une thèse comme quoi le Moi n'est pas encore constitué à la naissance, qu'il est l'aboutissement d'un travail de maturation affective. Le Moi se forme progressivement comme instance intégratrice. Et il énonce ce paradoxe que " le début, c'est le moment où le Moi commence" [9]. Avant, il n'y a que le chaos. Il ajoute que la formation du Moi est tributaire de la qualité des soins maternels par où seulement le bébé peut devenir une personne distincte. C'est ce processus que WINNICOTT appelle "la personnalisation", par lequel le nouveau né devient une personne.
Comme Carl ROGERS, WINNICOTT a une vision positive du développement humain, appuyé sur un concept de la santé mentale corollaire d'un développement affectif normal. Mais il assortit cette orientation normale vers la santé d'une condition : que la relation dyadique entre la mère et l'enfant soit d'une bonne qualité. Le développement de l'intégration du bébé dépend de la qualité "suffisamment bonne" des soins corporels apportés par la mère. Dans le cas inverse, le bébé est plongé dans des expériences affectives qui peuvent compromettre gravement son processus de maturation et de développement. " La santé correspond à la maturité" nous dit WINNICOTT. Si l'on considère que le Moi est l'aboutissement de la capacité du bébé d'agréger l'expérience disparate en une unité subjective, et que cette unité résulte effectivement d'une interdépendance satisfaisante de la mère et du nouveau né, tout manquement pathologique de la mère au soutien du bébé compromettra le processus de sa maturation et provoquera une désagrégation du sentiment d'être une unité ("la dépersonnalisation"), inaugurant la mise en place de défenses puissantes contre les éprouvés "impensables" d'une "non-intégration" des fragments affectifs. WINNICOTT explique que dans cette situation de carence des soins maternels, le bébé recours à un mode de protection par la "désintégration".
Lorsque l'organisme du nouveau né ne rencontre pas des soins adéquats, il est traversé par des angoisses brutes, "inimaginables", sans signification. Inimaginables parce que le bébé ne dispose pas encore de la fonction imageante (imaginaire). Tout se passe alors comme si la programmation génétique de la dynamique pulsionnelle est invalidée par l'environnement et que l'organisme déclenche des signaux de détresse , manifeste d'une angoisse de mort. Contre ce sentiment originaire, le seul recours que l'organisme a à sa disposition pour se défendre est la "désintégration", c'est à dire la régression par désagrégation et dispersion des éléments constitutifs de l'expérience néo-natale.
WINNICOTT écrit ceci :
" Le terme de désintégration est utilisé pour décrire une défense qui est la production active du chaos pour se protéger contre la non-intégration en l'absence du soutien du Moi maternel, c'est à dire contre l'angoisse archaïque ou inimaginable qui résulte d'une carence dans la manière de porter le nourrisson au stade de la dépendance absolue ". WINNICOTT ajoute que " la production du chaos a l'avantage d'être produite par l'enfant et donc de ne pas dépendre de l'environnement. Il est dans la sphère de l'omnipotence du nourrisson. En termes de psychanalyse, il est analysable, alors que les angoisses inimaginables ne le sont pas." Bien que cela ne soit pas à ma connaissance indiqué, ce dont il est question dans ces angoisses inimaginables (littéralement qui ne peuvent pas être représentées en "images", qui ne peuvent donc pas être élaborées) ce sont des éprouvés de l'imminence de la mort.
La théorie du " self "
Le Soi et le faux Soi
Ce n'est pas très commode de comprendre la théorie du "self" et du faux self" telle que WINNICOTT l'enseigne. J'ai du mal à distinguer chez lui le concept du Soi de celui du Moi. Il m'est plus facile de comprendre le fonctionnement du faux-self que celui du self. C'est d'ailleurs dans cet ordre qu'il aborde ces deux concepts. Globalement, le faux self, négation du Soi, se met en place et se développe chez le nourrisson et le jeune enfant pour faire face à la carence des soins maternels. Dans la position de totale dépendance où il se trouve, le bébé qui fait l'expérience réitérée de l'arbitraire maternel dans les réponses que donne sa mère à la satisfaction pulsionnelle de ses besoins vitaux renonce à s'exprimer spontanément et développe un comportement mimétique de soumission et de passivité. Il s'identifie à cet Objet défaillant et instable. En quelque sorte, il s'adapte à sa mère pour tenter de conjurer les effets affectifs destructeurs de sa défaillance excessive pour protéger son vrai "self".
Cette pensée est très importante car elle est porteuse de la confiance selon laquelle non seulement le vrai self continue d'exister sous l'organisation défensive, mais encore qu'il est acteur (désespéré) dans cette stratégie de survie, recours de dernière instance pour être sujet. C'est même cela qui est porteur de l'espoir "thérapeutique", comme quoi la désincarcération du faux-self est possible si le sujet "as if " ("comme si") a la chance de pouvoir rencontrer et utiliser un cadre suffisamment contenant (holding) et symboliquement nourricier pour entreprendre cette aventure. A la condition qu'un cadre de cette nature puisse être "trouvé". Si nous sommes capables de concevoir un cadre analytique qui permette au sujet de régresser, c'est à dire de revenir dans l'état originaire contemporain des expériences pathogènes, ce sont les conditions du paradoxe inaugural du "trouvé/créé" qui pourront être réamorcées et donner lieu à tout le travail de représentation de l'impensable originaire et de son élaboration.
L'idée majeure et très simple de WINNICOTT est que le nouveau né développe un vrai "self" lorsqu'il est en mesure de donner libre cours à sa spontanéité, c'est à dire, au fond, aux comportements originaires tels qu'ils se développent dans leur confrontation à l'environnement néo natal, et de manière essentielle au comportement de soutien de la mère. C'est cette adaptation optimale de la mère au début de la vie du nouveau né qui va instauré en lui un sentiment de confiance dans l'expérience, et un sentiment d'omnipotence nécessaire pour qu'il puisse s'engager sans réticence majeure dans son travail de détachement de la mère vers l'autonomie. Le vrai "self" se développe lorsque "le bébé commence à exister et non à réagir".
" La mère suffisamment bonne répond à l'omnipotence du nourrisson et, dans une certain mesure, elle lui donne une signification, et ce, maintes et maintes fois. Par l'intermédiaire de la force que donne au moi faible du nourrisson l'accomplissement de ses expressions d'omnipotence, un vrai "self" commence à prendre vie ." …" A partir de ce moment là, le nourrisson commence à croire en la réalité extérieure qui apparaît et se comporte comme par magie"…"A partir de là, le nourrisson peut progressivement renoncer à l'omnipotence"…"La mère qui n'est pas suffisamment bonne n'est pas capable de rendre effective l'omnipotence du nourrisson et elle ne cesse donc de lui faire défaut au lieu de répondre à son geste. A la place, elle y substitue le sien propre, qui n'aura de sens que par la soumission du nourrisson. Cette soumission de sa part est le premier stade du faux "self" et elle relève de l'inaptitude de la mère à ressentir les besoin du nourrisson".…"Une partie essentielle de ma théorie repose sur l'idée que le vrai "self" ne devient réalité que s'il résulte de la réussite répétée de la mère lorsqu'elle répond au geste spontané ou a l'hallucination sensorielle du nourrisson"."Le vrai "self" est spontané, et les évènements se sont accordés à cettespontanéité. Le petit enfant peut commencer à jouir de l'illusion de la création et ducontrôle omnipotents. Par la suite, et peu à peu, il devient capable de reconnaîtrel'élément illusoire, le fait de jouer et d'imaginer. C'est là que réside le fondement du symbolequi, tout d'abord, est à la fois spontanéité ou hallucination de l'enfant, et aussi objet externe crééet, en fin de compte, investi"… " Dans le cas où l'adaptation de la mère aux hallucinations spontanées et aux pulsions spontanées du nourrisson est déficiente, n'est pas suffisamment bonne, le processus qui aboutit à la capacité d'utiliser des symboles ne débute pas (où il se rompt, ce qui entraîne un repli correspondant de la part du nourrisson vis à vis des acquis de l'expérience ".
"Le vrai "self" est la position théorique d'où provient le geste spontané et l'idée personnelle
Le vrai self provient de la vie des tissus corporels et du libre jeu des fonction du corps. Il est étroitement lié à l'idée du processus primaire…Le geste spontané est le vrai "self" en action. Seul le vrai self peut être créateur, et seul le vrai "self" peut être ressenti comme réel…Le vrai "self"' ne fait guère plus que rassembler dans ses détails l'expérience liée au fait de vivre ".
La transitionnalité
Les phénomènes transitionnels
De Télérama à Marie Claire en passant par "l'Humanité dimanche" et "Doudou sans frontière", le concept d'objet transitionnel est devenu un phénomène de foire. Si tu parles de bébémaman, il est de bon ton de faire état de la Chose. Bien entendu cette absorption sociologique du mot dans les savoirs médiatiques ne garantie pas du tout que l'on parle de la chose élaborée par WINNICOTT. Ce concept est soumis, depuis quelques années, à une utilisation syncrétique, abusive et inflationniste, qui a surtout pour effet une érosion théorique destinée à le vider de son potentiel subversif quant à la redéfinition d'un cadre analytique impliquant de la part du thérapeute un travail dans la communication symbiotique intertransférentielle. Comment le petit mammifère humain s'y prend-il pour réussir cette performance ordinaire ?
Le premier objet possédé
Comment le bébé passe t-il du sein (objet/moi) à l'objet possédé (le doudou) ? Comment d'effectuent les expériences progressives de passage/transfert du sein/bouche au non-sein, à la succion des doigts puis à l'investissement d'objet ?Comment se forment " la première possession et l'aire intermédiaire qui se situe entre le subjectif et ce qui est objectivement perçu" , moment où un objet de la réalité est associé à la mémoire de la mère satisfaisante ("suffisamment bonne") ?
L'aire intermédiaire d'expérience
Cet espace conceptuel "se situe entre le pouce et l'ours en peluche, entre l'érotisme oral et la véritable relation d'objet, entre l'activité créatrice primaire et la projection de ce qui a été introjecté ", en une zone de l'expérience vécue (un espace/temps concrètement occupé par l'activité de jouer) qui n'est ni franchement située à l'intérieur, ni franchement extérieure. Entre soi et non-soi. C'est un mode d'expérience (expériencing), un processus en cours de déroulement dont la visée dynamique est d'instaurer un espace interne où se représentent les objets externes comme condition de possible détachement/décollement de la sensation. Au début, le monde est ressenti/vécu au travers de sensations, d'émotions et d'affects. L'expérience vécue à l'origine est celle d'un continuum mère/nourrisson dans lequel l'objet et le sujet sont indifférenciés. A la fin du processus d'individuation, le monde existe à l'extérieur du sujet, qui est devenu capable de le percevoir comme extérieur aux sensations qu'il lui procure.
Comment le petit mammifère humain s'y prend-il pour réussir cette performance ordinaire qui va organiser et domestiquer sa capacité de penser le monde de telle manière qu'il surmonte les challenges affectifs entre l'épreuve violente de la naissance, le moment où il s'attache indéfectiblement au sein et le moment où il peut considérer sa mère comme une personne entière extérieure à ses besoins et à son désir ? Comment le bébé passe-t'il de l'objet/moi/sein indifférencié à l'objet possédé (le doudou) puis abandonné ?L'apport singulier et fondamental de Winnicott à la théorie du développement de lavie psychique (la psychogenèse) est d'avoir inventé la notion de transitionnalité et de la phénoménologie qui s'y attache.
L'aire des phénomènes transitionnels est cet espace/temps intermédiaire entre :
- d'une part, le moment où le nourrisson est assigné au jeu des pulsions primaires, en particulier lorsqu'il est soumis au jeu de la sensualité orale (siège privilégié de l'érotisation primaire), à celui des sensations liées au portage (holding) et à l'ensemble des manipulations (handling) liées aux soins corporels,
- et d'autre part, le moment où il est devenu capable de maîtriser le langage verbal,c'est à dire la pensée et la représentation de mot.
La "transitionnalité" c'est un ensemble de comportements liés aux tendances maturantes innées du bébé vers l'autonomisation, qui aboutissent à la formation d'une image interne stable de la mère en son absence et dissout ou neutralise les états d'angoisse . Dans cette négociation, l'image "transitionnelle" se constitue en représentant d'un ensemble de sensations coalescentes à la mère et au bébé, et ce, grâce à la médiation d'un objet, l'objet transitionnel, sorte d'interface affecté des qualités sensibles communes à la mère et au nourrisson, en particulier tactiles, olfactives et gustatives. La mère est représentée au travers d'une relation affective empreinte sur des sensations partielles incorporées à l'objet élu. Cet objet est donc pour le nourrisson un passeur de l'état où il est confondu avec le sein à un état où il est affectivement relié au sein par des images buco/tactiles/olfactives/sonores/visuelles incarnées dans l'objet nommé pour cette raison transitionnel. Cette image fonctionne parce que là où se cristallise une angoisse des perte, elle réinstaure un état de sécurité émotionnelle. L'objet
transitionnel est le premier objet affectif réellement extérieur. Il est contemporain d'un possible détachement du corps de la mère. Il ouvre un espace interstitiel entre elle et lui qui va favoriser le jeu de l'organisation psychique comme représentant de la relation charnelle en voie de désintégration. Ce truc là est une vraie merveille créée par le Dieu pour se faire pardonner toutes les saloperies qu'il a placé sur le chemin de la créature.
Image , donc, coalescente de la naissance à la vie psychique, à la formation des premières images psychiques dynamiques (dynamiques par rapport au processus de formation des phantasmes originaires, eux-mêmes syncrèse [10] d'images passives). Au terme du processus transitionnel, l'image de la mère va fonctionner comme représentation de la mère en son absence. C'est le processus de formation du symbole et de l'Imaginaire qui est ainsi mis en mouvement, et qui va conduire le jeune enfant (que l'on ne peut plus considérer alors comme un bébé) du statut dyadique à l'individuation.
Ce processus s'engage très tôt, à partir des décalages, des défaillances, des absences, des séparations avec la mère. Tout ce travail du désillusionnement et de l'acceptation de la séparation va conduire câlin-caca le petit enfant à détartrer sesadhérences mammifères pour accéder bientôt à l'ordre humain du langage et de la relation à la Loi ordinaire qui est de renoncer à la jouissance originaire (foetale/orale) comme mode exclusif de relation à l'Objet, dans le jeu de son élargissements aux modalités ultérieures de jouissance (anale/génitale/oedipienne). Ça veut pas dire que tu te coupes les couilles (la "castration" comme ils disent) mais que tu investis l'énergie originaire acquise pour toujours, dans les autres zones qu'ont pas encore été domestiquées. La conquête de chaque nouvelle modalité de maîtrise des organes de la satisfaction pulsionnelle (l'érogénéisation) supposant la renonciation à la fixation exclusive sur l'une ou l'autre de ses modalités antérieures. En gros, c'est comme quand tu construis une bicoque : tu construis d'abord les fondations, puis ton appart'. Quand t'es pas trop fauché tu aménages un grenier, et tu installes le Toi. Enfin, le Moi, qu'est l'instance abstraite (le logiciel) qui organise la gestion de l'ensemble. C'est u peu tordu comme métaphore !
On pourrait résumer les choses de la façon suivante : La transitionnalité est cette période fondatrice de l'individuation et de la subjectivité où le nourrisson humain passe du statut de mammifère au statut d'enfant humain en passant successivement par les étapes suivantes:
- Symbiose / indifférenciation du Sujet et de l'Objet (érotisme[11] foetal).
- Confusion du Soi et de l'Objet.
- Sensation/sensualité originaire (érotisme oral). Imago.
- illusionnement primaire.
- Expérience de l'omnipotence. Construction des fondements de la subjectivité.
- Premières expérience de désillusionnement et transfert affectif de la sensualité originaire lié à la satisfaction tactile/orale/ olfactive sur un objet chargé des qualités sensuelles du corps maternel et de celui du bébé, désillusionnement dont la fonction est transitionnelle.
- Jouissance d'Objet. Début du symbole.
- Première possession "non-moi". Transfert des propriétés de l'image transitionnelle sur une image interne stable (image psycho-affective) de la pérennité de la mère, d'un continuum d'être de la mère en son absence.
- Poursuite du travail du désillusionnement en appui sur l'espace potentiel etl'aire intermédiaire de jeu.
- Installation de l'image interne de l'Objet.
- Abandon/oubli de l'objet transitionnel.
- Développement de l'érotisme musculaire et du jeu symbolique.
- Capacité à jouer seul en présence de la mère.
- Accession à la parole, à l'autonomie motrice (analité), à la créativité et au jeu partagé.
- Accession à la génitalité et à l'érotisation œdipienne où se boucle le cycle par un retour vers l'Objet. C'est au cours de cette phase de développement que le père émergera comme fonction structurante d'étayage de la séparation dans le processus de renonciation affective à la jouissance de l'Objet maternel (la césure œdipienne) et dans l'orientation libidinale de l'enfant vers le monde intellectuel et social (l'école).
C'est ce processus, ce mouvement de constitution du travail psychique à son avènement, qui constitue pour Winnicott l'expérience créatrice primaire qui est au fondement de l'expérience culturelle. La façon dont l'enfant aura réussi cette épreuve de passage constituera pour lui la matrice de sa relation créatrice ou soumise au monde.
Du Sein(bol) au Symbole :
L'aire intermédiaire d'expérience
et l'espace potentiel
WINNICOTT examine les expériences primitives liées à la communication symbiotique entre la mère et le bébé qui ouvrent entre eux deux un espace interstitiel favorable à la formation et au maniement des premiers symboles, "l'aire intermédiaire d'expérience", encore définie comme "espace potentiel", qui va progressivement conduire le nourrisson du statut d' être biologique indifférencié au sein de " la dyade mère/nourrisson" à celui de petit humain. L'aire intermédiaire d'expérience " se situe entre le pouce et l'ours en peluche, entre l'érotisme oral et la véritable relation d'objet, entre l'activité créatrice primaire et la projection de ce qui a été introjecté ".
Cette aire intermédiaire d'expérience est à proprement parler un espace/temps concret occupé par l'activité spontanée du bébé qui commence à jouer, c'est à dire à ouvrir un commerce avec lui-même, avec ses propres sensations, ses tensions corporelles, émotionnelles et affectives, avec ses activités fantasmatiques; une sorte d'activité expérientielle au sein d'un espace/temps concrètement occupé par le "playing" de son propre organisme. Dans cette exploration, les évènements ne sont ni situés à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais dans un éprouvé immédiat qui va constituer le socle affectif où commencera de se structurer sa relation au monde et sa compétence subjective. C'estun mode d'expérience (expériencing), un processus en cours de déroulement dont la visée dynamique est d'instaurer un espace interne où se représenteront les objets externes comme condition du possible détachement/décollement de la sensation. Cet espace interne est à proprement la capacité de penser, c'est à dire de jouer avec des symboles :
- symboles de la Chose corporelle (sensations originaires, hallucinations)
- symboles imaginaires (début des images psychiques concrètes)
- symboles abstraits (les mots comme représentant des images concrètes et des images originaires).
Dans ce monde de ressenti/vécu, l'expérience est celle d'un continuum mère/nourrisson qui se scinde progressivement, dans lequel, à la fin du processus, le monde existe à l'extérieur du sujet, qui est devenu capable d'être en communication avec lui.
De la relation d'Objet
à l'utilisation de l'Objet
C'est un passage de la théorie de WINNICOTT qu'est pas très commode à assimiler. De quoi s'agit t'il ? Je vais essayer de t'expliquer ce que je comprends moi-même de ce passage d'un état où le nouveau né est en confusion avec l'Objet à un état où il est capable de l'utiliser, c'est à dire de s'en servir comme quelque chose appartenant à la réalité extérieure, c'est à dire de jouer. En fait c'était pas si difficile que ça.
Playing / Jouer
D'abord, j'ai besoin incoercible de te fourguer mon point de vue perso que voici, dont tu manqueras pas de t'apercevoir que c'est l'illustration authentique du fameux paradoxe du "trouvé/créé" de WINNICOTT: L'activité de jouer est une activité instinctive orientée vers les apprentissages maturants affectifs/cognitifs et langagiers. Elle est co-extensive aux dynamismes créateurs. Elle vise à la construction du monde interne des représentations, et à la dotation de l'organisme en équipements d'analyse et de synthèse destinés à lui assurer son développement optimal et son intégrité. Le jeu spontané est le lieu géométrique de la formation de la personnalité intégrée. C'est un mode d'expérience d'ouverture au monde aussi bien qu'aux potentialités créatrices internes. Par le Jeu, l'enfant s'approprie tout ce qui s'offre à son expérience comme problématique. Tout obstacle rencontré dans le cours de son éveil psychique et intellectuel devient stimulation et provocation à la pensée réflexive. L'organisme vivant cherche à résoudre chaque tension qui obstrue sa capacité à percevoir du sens. Cette tension vers la connaissance concerne tous les domaines de l'activité humaine. Les chapitres 3 et 4 de son livre "JEU ET RÉALITÉ" sont des outils extrêmement précieux pour tous ceux qui cherchent à comprendre la théorie du cadre mettant en œuvre l'expérience créatrice comme aire intermédiaire de jeu. Le langage en est suffisamment clair pour que je te laisse te débrouiller tout seul. Mon sentiment est que j'en ai assez fait avec les concepts clé pour que tu te déplaces dans le reste par tes propres moyens.
L'aire de jeu analytique
Une des choses probablement la plus intéressante élaborée par Winnicott dans sa tentative de relier et de mettre en synergie l'expérience de jouer ("playing") et l'espace du soin analytique, réside selon moi dans les conditions spécifiques de la construction du cadre analytique et des attitudes de l'animateur/analyste visant à permettre une réelle et profonde spontanéité de la part de son client (et de lui-même), ouvertes par la proposition du "playing".
De nouveau, sur ce plan, Winnicott développe une position singulière en regard de la position des psychanalystes d'enfants qui utilisent le jeu de manière, comme j'aime à le dire, pré-textuelle (c'est à dire comme prétexte et non comme texte), c'est à dire essentiellement orientée vers la production de matériaux interprétables par l'analyste, au détriment de l'acte créateur lui-même et de la dynamique créatrice qu'elle entraîne. Winnicott soutient le point de vue des dynamismes processuels du Libre Jeu, de l'authentique spontanéité. Il accorde à l'expérience de Jouer (playing) une valeur intrinsèque. Il soutient même la position comme quoi "Il ne faut jamais oublier que jouerest une thérapie en soi".
Et, à mon sens, la partie la plus subversive des thèses de Winnicott porte sur la nécessité, pour qu'il y ait psychothérapie, de créer les conditions d'une réelle spontanéité. " Jouer doit être un acte spontané, et non l'expression d'une soumission ou d'un acquiescement , s'il doit y avoir psychothérapie". De mon point de vue, il y a là une démarcation claire, décisive et irréductiblement conflictuelle entre la conception non-directive de l'animation des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques dans le modèle que j'élabore moi-même, d'avec certains modèles arthopédiques et comportementalistes qui se développent sous le nom d' "art-thérapie".
@
Agonie primitive
Crainte de l'effondrement
Un des trucs les plus géniaux que Donald a bricolés concerne un des processus majeurs à l'œuvre dans toute expérience analytique authentique, et particulièrement actif dans l'expérience créatrice, qui est l'émergence d'une "crainte d'effondrement". WINNICOTT postule sur la base de ses expériences cliniques que la crainte de l'effondrement , traversée à certains moments critiques de notre existence, est la réactivation d'un effondrement qui a déjà eu lieu dans la préhistoire mnésique ou dans l'histoire du sujet.
Qu'est ce que cette "agonie primitive" théorisé par WINNICOTT?
La façon dont je formulerai personnellement la chose est que l'évènement "agonique" originaire est l'expérience néo natale de traversée de l'imminence de la mort (à proprement parler l'angoisse), c'est à dire d'une douleur affective intense vécue par le nouveau né avant qu'ait pu se constituer une surface subjective stable (psychique) de l'existence d'un autre, d'un tiers, contenant fiable (détoxiquant) des états d'angoisse. Y'a pas de logiciel pour convertir/interpréter une douleur qui a franchi son seuil de tolérance biologique et sa capacité d'élaboration hallucinatoire (phantasmatique) pour la transformer une information (un in'form). Cela produit une "affectation" pure - un affect a-représentatif - sans accroche représentative ; un éprouvé organismique, non-médiat, de la proximité de la mort, pour lequel il n'y a pas encore de sujet percevant, pas de capacité de construire une représentation qui introduise du sens, qui s'estompe lorsque le sentiment s'atténue et disparaît grâce aux soins de l'environnement maternel. mais qui inscrit une trace blanche, irréductible autrement que par sa résurrection et son traitement dans le cadre analytique au sein duquel ce n'est pas l'expérience de la mort qui est présente, mais l'ombre de son fantôme.
C'est dire ici que le premier mode de subjectivité du nouveau-né est de nature hallucinatoire, c'est à dire qu'il ressent/éprouve des états sans discernement d'une origine externe ou interne. Il n'a pas encore de perception. C'est je crois une des trouvailles majeures de WINNICOTT d'avoir posé cette loi fondamentale de la construction subjective comme quoi ce qui est perçu est en réalité construit.
Créativity primaire et expérience culturelle
Winnicott souligne avec vigueur que " l'expérience culturelle n'a pas trouvé sa place véritable dans la théorie qu'utilisent les psychanalystes pour travailler et pour penser"(Ch.4). Et il indique, un peu plus loin la nécessité, pour les psychothérapeutes, de conduire " une étude séparée de la créativité en tant qu'elle est une particularité de la vie et de l'existence dans son ensemble".
Une fois encore, Winnicott échappe à deux pièges réducteurs étroitement culturels:
- celui de la créativité conçue comme compétence ou capacité, qui est le point de vue véhiculé par la pseudo culture consumériste, aussi bien par les établissements de l'art officiel que par l'idéologie comportementaliste de l'arthopédie, dont se servent les praticiens qui manœuvrent les participants au moyen de situations de jeux arthopédiques au gré de leur désir propre et de leur charisme projetés sur le groupe avec des exercices dits "de créativité" stéréotypés et standardisés .
- celui de l'expérience créatrice confondue avec le processus culturel de l'art, qui a conduit aux assimilations syncrétiques des pratiques de l' art-thérapie.
Winnicott pense et exprime clairement que la quête artistique est une impasse pour la constitution du sentiment de soi.
Pour Winnicott, la créativity primaire est une disposition et un processus lié aux tendances maturatives de l'organisme humain. C'est " la coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure."..." La créativité est quelque chose d'universel. Elle est inhérente au fait de vivre"..."Elle est ce qui permet l'approche de la réalité extérieure". .."Elle suppose un état de bonne santé"..."Elle est présente en chaque être humain" . En fait, pour Winnicott, la créativité, c' est la pulsion créatrice sous-jacente à l'exercice du jeu : " La pulsion créative peut être envisagée en elle-même" Et il note, avec beaucoup de délicatesse, que FREUD se fourvoyait, en entraînant ses disciples à sa suite , lorsqu'il axait son investigation sur l'œuvre d'artistes célèbres et sur l'anecdotique reconstitution de leur histoire infantile.
La créativité est donc, pour Winnicott une force centrale active à l'intérieur du Jeu. Elle est essentiellement " reliée à la qualité et à la quantité de l'apport offert par l'environnement lors des premières phases de la vie que connaît tout bébé"...Elle est ce par quoi "l'individu va pouvoir faire face au choc immense de la perte de l'omnipotence". Et c'est dans les modalités de déroulement des expériences transitionnelles et de la créativité primaire, condition de développement de base du processus de l'individuation et du développement de la fonction psychique de représentation, que se mettra en place la structure de l'expérience future du sujet dans son rapport au monde, et dans l'élaboration du patrimoine culturel.
Au fond, son intuition la plus géniale pour nous aider à comprendre la question de l'expérience créatrice repose sur cette idée que c'est de la façon dont le nourrisson aura vécu et résolu ou non ce passage de la relation symbiotique à la capacité de se représenter le monde et de jouer que dépendra sa capacité créatrice au cours de sa vie adulte. Comme t'as réussi avec ton doudou, comme tu seras équipé avec tes contemporains.
Jouer et apprendre
L'hypothèse fondamentale dont je me propose de nourrir cet article est la suivante :
Jouer est un acte instinctif orienté vers les apprentissages maturants affectifs/cognitifs et langagiers. Il est constituant des dynamismes créateurs. Il vise à la construction du monde interne des représentations, et à la dotation de l'organisme en équipements d'analyse et de synthèse destinés à lui assurer son développement optimal et son intégration.
"Instinctif" signifie que les conduites de jeu sont génétiquement inscrites dans l'organisme humain, comme elle le sont pour celui des animaux. A ce titre, le jeu est une activité structurale/structurante, et le moyen fondamental d'appropriation aussi bien du monde potentiel des compétences biologiques, affectives, émotionnelles et psychiques que des forces à l'œuvre dans l'environnement.
La fonction/jeu est constituante de toutes les opérations d'apprentissage significatif. L' inhibition de cette fonction, son altération souvent systématique dans le cadre scolaire, sont profondément préjudiciables à la construction d'un sujet sain c'est à dire créateur.
Primordial dans le processus d'intégration de la personnalité du jeune enfant, le jeu change de qualité lorsque cette intégration est normalement acquise. L'expérience créatrice æsthétique (créating) est pour la personnalité adulte la forme mature du jeu de l'enfant (playing)
@
Parti de préoccupations sur la question du Jeu et de la formation humaine de l'enfant (son humanisation pour reprendre les termes de Françoise DOLTO) , j'ai choisi d'orienter mon travail de réflexion dans deux directions :
- La première direction explore la problématique de l'apprentissage significatif en pédagogie, de la relation enseigner/apprendre.
- La seconde direction traite de la Psychothérapie comme Jeu et de l'espace psychothérapeutique considéré comme une aire intermédiaire de création entre le thérapeute et le sujet, dans la référence théorique aux travaux de Donald Winnicott.
Faites vos jeux ...
Les jeux sont faits
Le problème est donc double :
- Il concerne d'une part la compréhension des processus de formation de la connaissance comme jeu.
- Il concerne d'autre part la gestion du groupe/classe et de l'Institution éducative scolaire comme cadre et dispositifs organisés pour permettre à des êtres en développement de devenir autonomes et créateurs, de favoriser la réalisation de leurs potentialités physiques, intellectuelles, affectives et morales, de leur offrir des voies d'accès à l'appropriation significative des outils technologiques, économiques, politiques, philosophiques et artistiques de notre culture. Significatif, cela veut dire que le sujet sera capable, au terme du processus de socialisation scolaire, de désirer et de jouir, de maîtriser le fonctionnement des outils culturels et d'exercer un contrôle éthique sur les visées et les processus de la Culture.
CARL ROGERS, dans son livre "Le développement de la personne" (Dunod Ed.) soutenait ce point de vue comme quoi toute connaissance qui n'a pas un rapport significatif avec quelque chose qui est éprouvé par l'enfant comme un intérêt, ou comme un obstacle à sa croissance, ou comme un problème qui le concerne directement dans ses investissements du monde réel, physique, affectif ou social, est un matériau inerte, inassimilable, dommageable à sa curiosité spontanée pour la connaissance, et source de confusion de par les conditionnements répressifs/normatifs qui constituent le fondement même du gavage pédagogique.
Or jouer, c'est apprendre. Le jeu est le lieu géométrique de la formation de la personnalité intégrée. C'est un mode d'expérience d'ouverture au monde aussi bien qu'aux potentialités créatrices internes. Par le Jeu, l'enfant s'approprie tout ce qui s'offre à son expérience comme problématique. Tout obstacle rencontré dans le cours de son éveil intellectuel devient stimulation et provocation à la pensée réflexive. L'organisme vivant cherche à résoudre chaque tension qui obstrue sa capacité à percevoir du sens. Cette tension vers la connaissance concerne tous les domaines de l'enseignement.
Et, dans ce processus de rencontre entre la structure de personnalité en formation et l'inconnu qui se présente à son élaboration, quand l'enfant ne joue pas, quand il n'est pas sollicité dans ses dynamismes créateurs, quelle que soit la discipline enseignée, aussi sophistiquée soit-elle, et bien il s'emmerde. Et quand l'enfant s'emmerde, et que ça dure, et que c'est institutionnalisé en programmes et méthodes pédagogiques, et que ça se passe dans le 16ème arrondissement ou dans la banlieue parisienne ou marseillaise, cela provoque un processus de désinvestissement et de destruction de la pulsion à la connaissance, épistémophilique comme on dit. Et alors, l'enfant, celui vers lequel nous retournons tous aux épreuves cruciales de notre vie, il commence à vouloir se venger, et il a raison ! C'est un réflexe de survie que cette violence contre l'instituant. Le drame étant que l'enfant ne sait pas que sa rébellion va être méprisée et détruite.
Ce qui de nos pulsions créatrices est nié et invalidé se retourne en énergie de destruction. S'il y a quelque chose que nous ont appris FREUD et Mélanie KLEIN, et qui se vérifie auprès des adolescents des banlieues dites à risques, c'est bien cela.
La pulsion créatrice et le Jeu sont une seule et même chose.
L'espace analytique / thérapeutique
J'approfondirai la question de l'ouverture des espaces analytiques et psycho-thérapeutiques à l'expérience créatrice, dans des dimensions psycho-affectives où le jeu soit instauré pour sa valeur maturative intrinsèque. et non plus, seulement, comme cela est le cas dans lespsychothérapies classiques d'enfants d'inspiration psychanalytique, pré-textuelle au travailde l'interprétation. Je me centrerai sur cette forme particulière de jeu qu'est l'expérience créatrice (médiatisée) et me réfèrerai explicitement à l'ouvrage de Donald WINNICOTT :"JEU ET RÉALITÉ".
Dans son ouvrage fondamental "JEUX et RÉALITÉ", écrit en 1971, WINNICOTT reprend et développe sa formulation inaugurale de 1951 sur la Créativity et le Jeu, dont il a tiré les prémisses dans son expérience thérapeutique auprès de nourrissons et de jeunes enfants. Il examine en particulier les expériences primitives liées à la communication symbiotique entre la mère et le bébé qui ouvrent entre eux deux un espace interstitiel favorable à la formation et au maniement des premiers symboles, "l'aire intermédiaire d'expérience" définie comme "espace potentiel", qui va progressivement conduire le nourrisson du statut d' être biologique indifférencié au sein de "la dyade mère/nourrisson" à celui de petit humain.
Ce sont des conditions mêmes du processus de l'humanisation au travers de ce jeu inaugural de création et de déploiement du langage, de ses avatars et de ses modes de restauration dans le jeu psycho-thérapeutique dont WINNICOTT a traité de façon singulière, et apporté ses contributions les plus originales dans le champ des psycho-analyses.
Ce qui nous intéressera ici, c'est la création d'un mode opératoire fondé sur la transposition analogique des modalités d'une relation primitive mère nourrisson "suffisamment bonne" ("just good enough") au cadre analytique et à la constitution d'un modèle de relation analytique/thérapeutique qui concerne aussi les adultes , sur les modes d'échanges psycho-affectifs décrits par Donald WINNICOTT autour des concepts suivants : " Présentation d'Objet" ("Object-présenting"), "Portage"("holding") , "maniements" lors des soins corporels ("handling") ; définissant la création d'un "environnement facilitant" pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de processus allant de l'expérience symbiotique à l'individuation, via les "phénomènes transitionnels".
Je tenterai d' esquisser l'ébauche d'un cadre technique analytique/ thérapeutique pour le déploiement analytique du Jeu intertranférentiel qui tente de généraliser les hypothèses de WINNICOTT relatives à la thérapie des jeunes enfants, à la thérapie des adultes, et notamment à la thérapie des personnalités "de bordure" (j'ai créé ce terme pour en place du terme "états-limite") et des personnalités présentant des défenses psychotiques. WINNICOTT soutenant la thèse selon laquelle la psychose n'est pas le résultat d'un effondrement du Moi, mais bien une organisation défensive contre des expériences d' "agonies primitives".
@
L' EXPÉRIENCE ANALYTIQUE
AUX RISQUES DU JEU SPONTANÉ
J'avais été très frappé de la façon dont CARL ROGERS attirait l'attention des pédagogues sur la valeur des enseignements, observations et conclusions des recherches conduite dans le domaine de la psychothérapie comme source de connaissances d'un grande richesse pour la compréhension des lois qui gouvernent la croissance normale des êtres humains, et de leur application au domaine de la pédagogie et de l'enseignement. Mon observation personnelle confirme tout à fait ce point de vue
La psychothérapie est un modèle, en ce sens que le travail qui s'y réalise repose sur la construction d' un savoir progressivement élaboré au sein d'une expérience affective singulière, dans un mouvement de communication, et de mobilisation des ressources émotionnelles, affectives, psychiques, intellectuelles les plus profondes des deux personnes engagées dans ce travail, et sur la rencontre des obstacles, de même nature, qui entravent le libre mouvement de la personne dans la réalisation de Soi. La connaissance repose ici sur l'expérience de la mise en jeu des forces internes des deux partenaires au sein d'un cadre qui favorise le travail de leur révélation, de leur reconnaissance, de leur nomination, de leur appropriation et de leur détoxication par la parole analytique.
Simplement, dans l'Éducation cognitive du jeune enfant et de l'adulte, les forces vers la rencontre desquelles va se tendre l'intelligence sont externes pour partie, même si dans leur domestication, un certain nombre de forces internes opèrent.
Il était pour moi très excitant, dans ce travail sur le Jeu de tenter le pontage entre les deux domaines de l'enseignement et de la psychothérapie. Chacun en tirera les enseignements qu'il peut
@
Le sujet exploré maintenant est donc celui de l'articulation de l'expérience créatrice du Jeu sur la scène psycho-thérapeutique. J'ai hésité à laisser cette partie de ma réflexion dans la présente édition de ce livre, pour finalement considérer qu'elle lui est organiquement attachée, voir fondamentalement inspirée par elle. J'espère que le lecteur principalement préoccupé d'éducation y trouvera matière à méditation.
@
J'examinerai la question de l'ouverture des espaces analytiques à l'expérience créatrice, dans des dimensions psycho-affectives où le Jeu soit instauré pour sa valeur maturative intrinsèque et non plus, seulement, comme cela est le cas dans les psychothérapies classiques d'enfants d'inspiration psychanalytique, pré-textuelle au travail de l'interprétation. Je me centrerai sur cette forme particulière de jeu qu'est l'expérience créatrice (médiatisée) et me réfèrerai explicitement à l'ouvrage de Donald Winnicott : "JEU ET RÉALITÉ".
Je formulerai à nouveau mon hypothèse centrale comme quoi:
L'activité de jouer est une activité instinctive orientée vers les apprentissages maturants affectifs/cognitifs et langagiers. Elle est co-extensive aux dynamismes créateurs. Elle vise à la construction du monde interne des représentations, et à la dotation de l'organisme en équipements d'analyse et de synthèse destinés à lui assurer son développement optimal et son intégrité.
Je poursuis, depuis une vingtaine d'année un travail personnel d'élaboration autour de la question du Jeu, à partir des outils que j'ai construits, dans un premier temps au sein des Ateliers Thérapeutiques d'Expression que nous avons créés avec le Dr Jean BROUSTRA à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux (entre 1972 à 1984) puis dans mon Institut de formation des "Ateliers de l'Art CRU" auprès d'éducateurs spécialisés, d'infirmiers psychiatriques, de thérapeutes et de travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre l'exclusion. Cet outil, c'est l'Atelier d'Expression Créatrice. Sa structure et les modalités d'engagement analytique qui y sont instaurées sont fondées sur des principes analogiques à ceux dont Winnicott a forgé la théorie, en particulier autour des concepts de "L'espace potentiel", de "L'aire intermédiaire d'expérience", et des "Phénomènes transitionnels".
Dans son ouvrage fondamental "JEUX et RÉALITÉ", écrit en 1971, Winnicott reprend et développe sa formulation de 1951 sur la Créativité et le Jeu, dont il a tiré les prémisses dans son expérience thérapeutique auprès de nourrissons et de jeunes enfants. Il examine en particulier les expériences primitives liées à la communication symbiotique entre la mère et le bébé qui ouvrent entre eux deux un espace interstitiel favorable à la formation et au maniement des premiers symboles, "l'aire intermédiaire d'expérience" définie comme "espace potentiel", qui va progressivement conduire le nourrisson du statut d' être biologique indifférencié au sein de "la dyade mère/nourrisson" à celui de petit humain.
Ce sont des conditions mêmes du processus de l'humanisation au travers de ce jeu inaugural de création et de déploiement du langage, de ses avatars et de ses modes de restauration dans le jeu psycho-thérapeutique dont Winnicott a traité de façon singulière, et apporté ses contribution les plus originales dans le champ des psycho-analyses.
Ce qui nous intéressera ici, c'est la transposition analogique des modalités d'une relation primitive mère nourrisson "suffisamment bonne" ("just good enough") au cadre analytique et à la constitution d'un modèle de relation analytique/thérapeutique qui concerne aussi les adultes :
- fondé sur les modes d'échanges psycho-affectifs décrits par Donald Winnicott autour des concepts suivants : "Présentation d'Objet" ("Object-présenting"), portage ("holding") , "maniements" lors des soins corporels ("handling") ,
- définissant la création d'un "environnement facilitant" pour la mise en œuvre d'un certain nombre de processus allant de l'expérience symbiotique à l'individuation, via les "phénomènes transitionnels".
Ce dernier concept est soumis, depuis quelques années, à une utilisation syncrétique, abusive et inflationniste, qui a surtout pour effet une érosion théorique destinée à le vider de son potentiel subversif pour la redéfinition d'un cadre analytique impliquant de la part du thérapeute un travail dans la communication symbiotique contre-transferentielle.
Je tenterai d' esquisser l'ébauche d'un cadre technique analytique/ thérapeutique pour le déploiement analytique du Jeu transférentiel/contre-tranférentiel qui tente de généraliser les hypothèses de Winnicott, relatives à la thérapie des jeunes enfants, à la thérapie des adultes, et notamment à la thérapie des personnalités "de bordure" (j'ai créé ce terme pour pallier la dysharmonie du terme "états-limite") et des personnalités présentant des défenses psychotiques. Winnicott soutenant la thèse selon laquelle la psychose n'est pas le résultat d'un effondrement du Moi, mais bien une organisation défensive contre des expériences d' "agonies primitives".
@
Trois ou quatre Choses fondamentales
créées par Donald Winnicott
Un des mérites incontestables de Winnicott tient à ce qu'il a déplacé l'axe du regard des analystes/thérapeutes de la zone oedipienne où l'avait calée FREUD, vers les moments de la formation du Moi, à partir des relations inaugurales au monde, c'est à dire à partir de la mise en place d' un socle d'expériences heureuses ou douloureuses fondées sur les premiers modes de satisfaction ou de détresse des nouveaux-nés.
1) La différenciation d'un inconscient non psychique
Selon Winnicott, il y a un inconscient originaire, distinct de l'inconscient désigné par FREUD comme étant en aval du refoulement ( et j' ajouterais, de mon propre chef, distinct de celui imaginé par LACAN, à savoir , a - psychique et a-langagier). Selon Winnicott le nourrisson n'est pas encore en mesure de rassembler, d'organiser et d'intégrer les expériences qui surviennent dans cette période en une représentation maîtrisable, opération qui dépend de la mise en place d'une "aire de contrôle omnipotent" fondée sur un paradoxe, fondateur de la subjectivité, comme quoi le sein existe à l'endroit et au moment où le bébé en a le besoin. De ce mouvement syncrétique originaire de conjonction entre l'éprouvé de son besoin et la présence du premier Objet à l'endroit où il est attendu, va naître et se déployer un sentiment illusoire de créer l'Objet (qui est en réalité trouvé) et permettre au bébé de faire une expérience de toute puissance qui va lui assurer les conditions de base du développement narcissique au sein de la dyade mère nourrisson.
Dans cet intervalle entre l'état inorganisé, fragmentaire et immature, du Moi , et le moment où le bébé est devenu capable d'appréhender du sens, se met en place la structure affective, qui est le socle par définition impensable ("unthinkable") à partir de quoi se forme le pensable, en ce sens que l'acte de penser se réfère à la maîtrise symbolique, c'est à dire au libre jeu avec la représentation de mots. De ce premier enseignement de Winnicott, je formulerai pour ma part ce théorème comme quoi la structure peut penser ses Objets, mais elle ne peut se penser elle-même. Là réside l'évidence fondatrice d'une expérience échappant à la perception consciente.
@
2) La sphère de la "transitionnalité"
La deuxième création conceptuelle, singulière et fondamentale de Winnicott nommée "transitionnalité" concerne la théorie de la genèse de la vie psychique entre l'hallucination et la pensée en mots.
L'aire des phénomènes transitionnels est cet espace/temps intermédiaire entre:
- d'une part, le moment où le nourrisson est assigné au jeu des pulsions primaires, en particulier lorsqu'il est soumis au jeu de la sensualité orale (siège privilégié de l'érotisation primaire), à celui des sensations liées au portage (holding) et à l'ensemble des manipulations (handling) liées aux soins corporels et au contact de peau à peau,
- et d'autre part, le moment où il est devenu capable de maîtriser la représentation de mot.
La "transitionnalité" c'est un ensemble de mouvements liés aux tendances maturantes innées du bébé vers l'autonomisation, qui aboutissent à la formation d'une image interne stable de la mère en son absence. Dans cette négociation, l'image se constitue en représentant d'un ensemble de sensations coalescentes à la mère et au bébé, et ce, grâce à la médiation d'un objet, l'objet transitionnel, sorte d'interface chargé des qualités sensibles communes à la mère et au nourrisson, en particulier contact de peau (doudou) olfactives et gustatives, où la mère est représentée au travers d'une relation affectivement investie déplacée sur des sensations partielles incorporées à l'objet dit "transitionnel" . Image , donc, constituante de la naissance à la vie psychique, à la formation des premières images psychiques dynamiques ( dynamiques par rapport au processus de formation des phantasmes originaires, eux-mêmes syncrèse d'images passives). Au terme du processus transitionnel, l'image de la mère va fonctionner comme représentation de la mère en son absence. C'est le processus de formation de l'Imaginaire qui est ainsi mis en mouvement, et qui va conduire le jeune enfant (que l'on ne peut plus considérer alors comme un bébé) du statut dyadique à l'individuation.
Ce processus s'engage à partir des écarts, des absences, des séparations avec la mère. Le travail de désillusionnement et de l'acceptation de la séparation va conduire le petit enfant au seuil de la problématique oedipienne via l'accession à l'ordre humain du langage et de la relation à la loi.
On pourrait résumer les choses de la façon suivante:
La transitionnalité est cette période fondatrice où le nourrisson humain passe du statut de bébé au statut d'enfant en passant successivement par les étapes suivantes:
Sensation/sensualité primaire -----> Illusionnement primaire => transfert affectif des sensations et de la sensualité lié à la satisfaction orale/olfactive sur un objet halluciné chargé des qualités sensuelles du corps maternel ---> transfert des propriétés de l'image transitionnelle sur une image interne stable de la pérennité de la mère, d'un continuum d'être de la mère en son absence => Travail du désillusionnement en appui sur l'espace potentiel abandon/oubli de l'objet transitionnel ---> Développement de l'érotisme musculaire et du jeu symbolique ---> Accession à l'autonomie motrice, à la parole, à l'expérience créatrice et au jeu.
C'est ce processus, ce mouvement de constitution du travail psychique à son avènement, qui constituent pour Winnicott la créativité primaire et qui est au fondement de l'expérience culturelle.
@
4) Jouer.
Une des choses probablement la plus intéressante élaborée par Winnicott dans sa tentative de relier et de mettre en synergie l'expérience de Jouer ("playing") et l'espace du soin analytique, réside selon moi dans les conditions spécifiques de la construction du cadre analytique et des attitudes de l'analyste/thérapeute visant à permettre une réelle et profonde spontanéité de la part de son client (et de lui-même) , ouvertes par la proposition du "playing".
De nouveau, sur ce plan, Winnicott développe une position singulière en regard de la position des psychanalystes d'enfants qui utilisent le jeu de manière, comme j'aime à le dire, pré-textuelle, c'est à dire essentiellement orientée vers la production de matériaux interprétables par l'analyste, au détriment de l'acte créateur lui-même et de la dynamique créatrice qu'elle entraîne. Winnicott soutient le point de vue des dynamismes processuels du Jeu Libre. Il accorde à l'expérience de Jouer (playing) une valeur intrinsèque. Il soutient même la position comme quoi "Il ne faut jamais oublier que jouer est une thérapie en soi".
Et, à mon sens, la partie la plus subversive des thèses de Winnicott porte sur la nécessité, pour qu'il y ait psychothérapie, de créer les conditions d'une réelle spontanéité. " Jouer doit être un acte spontané, et non l'expression d'une soumission ou d'un acquiescement , s'il doit y avoir psychothérapie".
De mon point de vue, il y a là une démarcation claire, décisive, et irréductiblement conflictuelle entre la conception non-directive de l'animation des Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques dans le modèle que j'élabore moi-même, d'avec les modèles arthopédiques et comportementalistes qui se développent sous le nom d' "art-thérapie".
J'espère avoir suffisamment excité la curiosité du lecteur qui ne connaîtrait pas encore la contribution capitale de Winnicott, et le désir de le relire pour les autres, à la définition de structures psychothérapeutiques ouvertes à l'expression créatrice, à la communication contre-transferentielle et au Libre Jeu.
Il me reste maintenant à décrire les modalités de création d'un cadre de profil Winnicottien pour la psychothérapie ou pour la formation thérapeutique des praticiens d'Ateliers d'Expression à visée thérapeutique.
@
Les Ateliers d'Expression
Créatrice Analytiques
J'ai progressivement créé et développé à partir de 1973, sous le nom d'Atelier d'Expression Polyvalent, un outil singulier pour le travail analytique. Cette structure est née de la confrontation confluente entre :
- d'une part ma formation de base à la méthode de "la dynamique de groupe" et à la conduite" non-directive" Rogerienne dans la relation d'aide individuelle et dans l'animation des groupes restreints;
- d'autre part, la traversée vitale que j'ai faite de l'engagement dans des expériences successives de création ayant joué pour moi une évidente fonction thérapeutique et analytique;
- Enfin, ma collision avec Max PAGÈS, qui a été mon référent institutionnel tout au long de ma formation psycho-sociologique, et dont j'ai ensuite été un des collaborateurs au sein du Laboratoire de Changement Social (Université Paris-Dauphine). C'est dans notre invention commune d'un séminaire (pour moi, une sorte d'objet transitionnel qui m'a conduit à l'autonomie professionnelle) où lui apportait sa compétence éprouvée d'animateur/analyste hors-normes, et où moi j'apportais ma liberté créatrice et ma capacité d'ouvrir des espaces d'expression non verbale dans l'expérience de la dynamique des groupes.
J'ai, dans un premier temps, appliqué cette structure dont nous avions expérimenté le prototype ensemble, dans l'Hôpital psychiatrique de jour où j'ai débuté mon expérience professionnelle, puis à l'asile psychiatrique de Bordeaux. Dans un second temps, au travers de l'Institut de Formation que j'ai créé - les Ateliers de l'ART CRU - j'ai inventé un certain nombre d'extensions fondées sur les même principes de base de la non-directivité, dans des Ateliers centrés sur un seul médiateur: l'argile, la peinture (en appui dissident sur le modèle de l'Atelier d'Education Créatrice inventé par Arno Stern), le papier, le tissu, la sculpture, l'écriture, le corps; où au travers d'Ateliers expérientiels et didactiques comme celui que j'anime pour les thérapeutes sur les concepts opératoires de Winnicott. Cette structure est la suivante :
L'Atelier d'Expression Polyvalent
comme espace potentiel
Cet Atelier est une sorte de jouet sophistiqué à l'intérieur duquel les participants trouvent tout ce qui est nécessaire pour s'engager dans le paradoxe du trouvé/créé Winnicottien, c'est à dire pour se livrer à une expérience créatrice personnelle au sein d'un groupe restreint où ils sont invités à "jouer librement". C'est un espace riche en médiateurs d'expression, à "manœuvrer", à modifier ; c'est un lieu de déplacement, d'errance ou de promenade dans un monde d'objets et de médiateurs expressionnels en attente d'investissement et de sens ; c'est un lieu où la créativité s'engage des variations de pressions ouvertes par l'animateur.
La "loi" qui régit l'activité est celle du "libre jeu".
L'animateur/analyste n'y exerce pas d'injonctions, ni de direction magistrale autoritaire. Il est là : dans sa singularité de personne, dans son statut d'instituant du lieu, de garant du cadre physique et temporel ; et dans son rôle d'animateur/analyste entrant dans des interactions de toutes natures (psychiques, émotionnelles, physiques et analytiques) avec les participants.
L'animateur/analyste inaugure l'activité (atelier intensif, ou séances régulières étalées dans le temps) en décrivant le cadre (le contenant) de l'expérience ; en définissant quels objets et quels langages sont privilégiés ("objects presenting"). En annonçant que l'ensemble du cadre (contenant, médias expressionnels) a pour visée de favoriser une activité d'investissement du jeu de création, sur les effets affectifs, émotionnels, psychiques duquel les participants seront invités à donner communication, dans le second temps d'élaboration verbale de l'expérience vécue qui ponctue chaque séance.
Dans ce dispositif, les participants sont donc placés dans une situation favorisant le développement d'un processus associatif aesthétique (de æsthésie, Étym. = sensible), invités à l'énonciation manifeste dans un "travail" de mise en représentation ludique, corporelle, verbale ou esthétique, des ressentis/pensés/pulsés. L'invitation est celle d'un "agir-dans-la-représentation" (playing) qui s'engage dans l'élaboration psychique des conflits affectifs, des phantasmes originaires et des expériences mnésiques "impensables" ("unthinkable").
La démarche proposée dans ce dispositif "potentiel" est donc au sens littéral du terme, "psycho-dynamique" : en ce sens qu'elle vise à mettre en effervescence, en tension productive , la fonction d'élaboration psychique des affects et des mnésies originaires. Elle réalise ceci au moyen du libre jeu de l'expression ludique et créatrice, dans un espace conçu à la fois pour favoriser et accueillir les effectuations psychiques, affectives et émotionnelles ; et pour engager une métacommunication profonde à leur sujet. Il peut être désigné du terme de transitionnel en ce sens que la production s'y inaugure du jeu des projections et introjections communes au Sujet et à l'Objet instigateur du lien, l'animateur/analyste.
Ce dispositif psycho dynamique peut être ajusté à trois objectifs connexes, ce que personnellement je désigne comme étant le cadre : l'évolution personnelle, la psychothérapie, la formation au travail analytique/ thérapeutique :
- Dans une visée d'évolution personnelle, l'expérience est axée de façon privilégiée sur la sollicitation centrale de l'impulsion aesthétique et de son expression dans les langages de création proposés. Le temps de parole y est aménagé comme temps de régulation de l'expérience vécue. Aucun travail centré sur l'élaboration des signifiants affectifs n'est poursuivi intentionnellement par l'animateur, comme cela est le cas dans le cadre thérapeutique. L'analyse susceptible de s'y produire est incidente aux effets de surgissement, et entre dans le champ de ce que nous appellerons la translaboration qui est un mouvement d'intégration spontanée des éléments de sens révélés par l'engagement du sujet dans le jeu de la Parole aesthétique et/ou symbolique.
- Dans une visée thérapeutique, c'est à dire lorsque la demande du sujet est une demande de soin et de « traitement » des causes de sa souffrance, le travail de la mise en œuvre (de l'effectuation créatrice) est explicitement centré sur l'articulation de l'intention productive à l'expérience non consciente dans le but de son émergence, de son élaboration psychique et de son appropriation par le sujet. La régulation y est instituée et appliquée de façon rigoureuse. L'intention analytique vis à vis des signifiants affectifs y est organisatrice du champ. Et la part de construction de l'analyste et son intégration par le client y est déterminante, et productrice de ce que nous appellerons ici le travail de la perlaboration.
- Dans une visée de formation (à l'animation d'Ateliers d'Expression à visée thérapeutique par exemple) l'enjeu paradoxal proposé aux apprentis est de se soumettre à l'expérience d'un engagement personnel dans le processus d'expression individuel et groupal avec l'objectif de constituer un capital d'observations "in vivo" qui seront élaborées en un savoir immédiat sur l'expérience actuelle, puis référées à des savoirs constitués limitrophes. Dans ces groupes, la fécondité du paradoxe tient à ce que les participants ne peuvent réellement détourner les visées didactiques de l'expérience à leur profit thérapeutique privé ; et que l'efficience formative de l'expérience proposée amène malgré tout ceux d'entre eux dont la demande implicite n'est pas de formation mais de thérapie, d'en prendre la mesure et de se donner les moyens de la satisfaire par ailleurs. Dans ces cas où la demande de formation est une forme de résistance à la formulation d'une demande de thérapie personnelle, l'expérience m'a montré que ce dispositif d'évolution était particulièrement opérant.
@
Depuis 1985 j'ai mis au point un dispositif de séminaire de formation et de recherche directement centré sur l'expérimentation des concepts opératoires de Winnicott. J'y applique un dispositif à trois entrées :
- expérimentation d'une aire de jeu spontané multimédia (Atelier d'expression polyvalent),
- traitement des données psychiques affectives et émotionnelles de l'expérience vécue en séance de régulation (translaboration),
- expérimentation d'un dispositif de confrontation entre les élaborations tirées de l'expérience vécue et les élaborations faites par Winnicott, dont l'œuvre est "exposée" dans l'Atelier à la manière d'une exposition artistique.
L'expérience montre que ce dispositif est particulièrement opérant pour saisir de façon non médiate le bien-fondé et la finesse de tous ces concepts cliniques : holding, handling, object-presenting, fear of breakdown, objet transitionnel, aire intermédiaire d'expérience, créativité, playing/game, paradoxe, self/faux-self, illusion /désillusionnement ... etc.
L'objectif de ce va-et-vient entre : expérience vécue / élaboration théorique / référence aux concepts-clés de Winnicott / retour à l'expérience immédiate, restant de permettre aux praticiens concernés par cette pensée vigoureuse de Winnicott de pouvoir en effectuer le transfert éclairé dans leur propre situation de travail.
@
Le moment est venu de conclure.
Le Jeu est le dénominateur commun qui relie mes deux modes fondamentaux d'expérience : le travail analytique/thérapeutique et la formation des adultes dans le domaine de l' Æsthétique Appliquée aux préoccupations des praticiens du Soin , de l'Éducation, du Travail Social et de la thérapie individuelle ou en groupe.
[1] cherches pas, chez moi, la métaphore me vient comme une érection dès que j'empare le clavier. Tu verras, tu t'y feras ! Tu remarqueras vite qu'entre signe et signifiant, entre sinus et sens, le signification n'est pas toujours la bienvenue, et que quand je pense, je suis pas toujours…. Comme disait Descartes, le sens c'est, la margarine sur le cholestérol…si tu vois c'que j'veux dire).
[2] Vérity J GAVIN est anglaise, play-thérapeute, exerce en Avignon / Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
http://www.therapie-jeu-creativite.com/therapie-jeu-creativite.html
[3] Quand j'écris le mot "analytique" il est clair que tu dois entendre "élaboration de l'expérience vécue dans la parole", et éradiquer de ta conscience cette confusion entretenue depuis Freud par les psychanalystes entre les termes "analytique" et "psychanalytique", Le terme "analytique" appartient au vocabulaire général des sciences qui se préoccupent de la croissance et du changement dynamique de la personne, et non au domaine réservé et circonscrit des pratiques qui existent dans le champ, dont la pratique psychanalytique.
[4] En écriture, c'est comme dans la relation érotique, faut pas se précipiter sur l'Objet. Faut d'abord préliminer les interstices du désir.
[5] Cette écriture tordue veut dire qu'il y a deux qualités de phénomènes psychiques que tu peux considérer comme des productions affectives pures :
- Les "phantasmes" qui désignent des phénomènes psychiques archaïques, originaires, d'avant la pensée, qui sont des " hallucinations" primordiales, en prise directe avec les angoisses originaires.
- Et des "fantasmes" qu'on appellera "primaires", qui sont des scénarios structurés par le môme - autour des questions existentielles qui le préoccupent, de comment on fait les bébés, de se marier avec maman, de la quiquette - et structurés par toi quand tu dragues la femme de ma vie. WINNICOTT distingue le symbole (objet externe décollé de l'affect qui permet de jouer) et le fantasme (objet interne collé à l'affect) (voir ci-après).
[6] A l'instant, ya un truc qui vient me sauter à la gueule : on est en 2013 et je te raconte des trucs qui se sont passés y'a plus d'un siècle ! C'est bidonnant !
[7] Mélanie KLEIN
[8] Je te causerai un jour, à ma façon, de papi Lacan, qu'a introduit cette petite révolution anecdotique dans la psychanalyse de balancer le "Ça-Moi-Surmoi" de pépé Freud à la poubelle (Lacan était un homme contemporain de la modernité : Impressionnisme, Cubisme, Surréalisme) et de les remplacer par le Réel/Imaginaire/Symbolique…
[9] Les éléments de réflexion de ce chapitre sont tirés du livre "Les processus de maturation de l'enfant"(ch.1)
[10] Syncrétisme, syncrèse = processus de constitution d'une image construite par assemblage de sensations hétérogènes et de pensées éparses, sans aucun lien de continuité naturelle entre elles. La pensée syncrétique est contemporaine de la formation de l'expérience psychique (l'expérience poétique)
[11] Le terme érotisme expliqué comme jouissance, et celui d'érotisation comme processus et lieu du corps investi par la jouissance, manque à dire son soubassement qui est d'ordre affectif. La jouissance et la souffrance sont fondamentalement des affects, c'est à dire la trace stable d'une inscription émotionnelle originaire.
Les vieilles culottes ont la bretelle freudienne (Julie Guénédel)
Les vieilles culottes ont la bretelle freudienne (Julie Guénédel)
Entretien avec Guy LAFARGUE
sur l'expérience créatrice et l'Art CRU
conduit par
JULIE GUENEDEL
pour son mémoire de Sciences de l'Éducation
Julie : Quand on s'exprime, surtout à travers l'art, c'est qu'on ressent un désir de créer. Pour moi, cela rejoint une envie. Ce que je trouve ambivalent dans cette expérience, c'est que quand on crée, on se trouve dans un état tellement second, que lorsqu'on a terminé notre création, ou ce qu'on voulait faire, il y a un sentiment de manque...ou, à la limite, de déprime...qui passe vite...
Guy : Vous parlez de votre expérience personnelle ?
Julie : Oui... mais... c'est aussi ce que j'ai lu dans un certain nombre de livres.
Guy : Pas dans mes écrits !
Julie : Peut-être. Pas chez vous !...
En fait je lis beaucoup de choses. Je m'intéresse à l'expression dans une perspective de développement personnel. C'est à dire, de l'expression permettant de redécouvrir son corps, ses sens ; d'être à l'écoute de ses attentes et, peut-être, de découvrir des choses sur soi.
Guy : C'est un bon programme...
Julie : Donc, j'aimerais bien savoir....vous, dans quelle optique vous voyez ces ateliers...les ateliers que vous faites ?
GL : Quand vous entamez la chose en disant : "s'exprimer à travers l'art", je dois vous dire qu'ici on ne s'exprime ni par l'art, ni "à travers". Ici, dans l'institution de l'Art CRU, on exclut tout simplement la notion d'art. On n'est pas dans la dimension artistique. Les artistes sont des gens qui ont besoin de l'art pour s'exprimer. C'est à dire qu'ils ont besoin de situer leurs créations par rapport à une institution, à des institutions qu'on appelle l'Art, dont le fondement est constitué par le public, par l'@utre, par le système médiatique, commercial... par l'autre dans la réalité ou dans l'imaginaire...
L'artiste ne peut sans doute pas s'exprimer s'il n'est pas subjectivement situé dans cette dimension de l'emprise du regard de l'autre...le regard et l'estime et l'amour que cela peut lui procurer ; ou le travail de formation de l'image de lui-même dans le miroir que le public va lui renvoyer...
Donc ici on se désintéresse totalement de ça. Les gens, quand ils viennent dans les Ateliers d'Expression Créatrice, ils viennent pour s'occuper d'eux mêmes...de leur personne.
Julie : Selon moi, il y a une différence entre expression et création...
Guy : Vous en faites une...
Julie : Oui j'en fais une...c'est à dire en lien avec ce que je lis de manière théorique...
Guy : Quelle différence faites-vous ?
Julie : Selon moi, l'expression serait quelque chose qui serait plus accessible à tout le monde... c'est difficile à dire... la création, elle, suppose une rigueur, un travail, comme cela est le cas pour les artistes. Ce qui fait la différence entre ceux qui veulent s'exprimer purement et les artistes - comme certaines personnes que je connais qui sont aux "Beaux Arts" - qui doivent acquérir une technique...où il y a certaine normes...où ça va être assez normatif finalement...du coup, la création pour moi, comme disait x..., c'est la rigueur. Créer c'est être rigoureux. Alors que l'expression serait quelque chose de plus accessible à tout le monde.
Est ce que tout le monde peut-être créateur ? Ça, je ne le sais pas, mais en tous cas, tout le monde est capable de s'exprimer. Après, je sais...il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui ont du mal... qui vont être très... comment dire... je ne trouve pas mes mots.... très réticents à se dévoiler devant les autres.
Donc, ce qui m'intéresserait d'explorer, c'est la façon d'amener des personnes à s'exprimer et à créer à l'intérieur d'un cadre ? Parce que, selon moi, l'environnement dans lequel on veut s'exprimer est primordial, puisque que ce sont nos sens qui perçoivent tout et qui font que ça va permettre de débloquer tout ça.
Selon vous, quel cadre doit être mis en place pour permettre à des personnes de pouvoir s'exprimer, de s'oublier ?...de se lâcher ?...
Guy : Est ce que s'exprimer, c'est s'oublier... ?
Julie : Ah ! Moi, au point de vue vocabulaire...je ne suis pas très rigoureuse justement.
Guy : Ce n'est pas une histoire de rigueur. C'est une histoire de représentations culturelles standard !
Il y a des pensées que l'on croit être des pensées et qui ne sont que des reconstitutions des lieux communs de la culture dominante autour de la création, de l'art. Je ne partage pas votre point de vue. Je pense que la création, c'est un événement absolument accessible à tout le monde...Ma définition de la création : c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un réussit à relier sa vie inconsciente - la vie affective - au langage...aux langages de la création.
La vie affective, c'est quelque chose qui nous structure, dont nous sommes construits, dont nous sommes habités, mais qui échappe à notre perception. On en sent, on en éprouve les manifestations, mais on n'y a pas un accès direct. La seule chose qui donne accès à la vie affective - à la vie inconsciente - c'est la création justement.
Le process de la création est le fruit d'une sorte de tension entre notre aptitude langagière et notre capacité d'expression affective. C'est quand les deux se condensent dans leur rencontre que se déclenche le processus de la création... de façon quasi nécessaire... Et, au fond l'évènement, le mouvement qui rend ça possible, c'est le travail de l'expression. L'expression, c'est quand ce process de tension de l'un vers l'autre est engagé, c'est à dire de la tension d'une impulsion affective vers la structure langagière. L'inconscient est structuré dans le langage... L'expression, c'est ce travail là.
J'ai consacré toute ma vie à comprendre ça, à l'expérimenter pour moi et à créer un cadre, une praxis... vous comprenez le terme praxis ?
Julie : Je le situerai plutôt du côté de la pratique.
Guy : C'est une pratique soumise à une critique régulière et exigeante. La praxis, c'est une pratique qu'on interroge, à l'écoute des théories existantes, ou à la lumière des observations que l'on tire de sa propre pratique...J'ai consacré toute mon existence à ça, et maintenant, je commence à avoir jouissance d'une somme de connaissances et d'un ensemble de savoirs constitués sur ce travail de l'expérience créatrice et de l'expression ; et sur la façon de créer un cadre dans lequel je place les gens pour que ce processus de la création se déclenche en eux de manière inéluctable, de façon quasi automatique.
Julie : Alors, dans ce cadre, qu'est ce qui est opérant ? Qu'est-ce qui fait que ça va déclencher le travail de l'expression ?
Guy : Dès l'instant où les gens rentrent dans ce cadre, ça met en ébullition le Désir... Le Désir, c'est à dire, la faim de résoudre toutes ces tensions toniques ou "pathiques" dont nous sommes habités.
Julie : Est-ce que chacun a besoin d'un cadre spécifique qui va lui permettre de...de vouloir se développer... de s'exprimer ? Ou est ce qu'on peut dire qu'il y a un cadre type ?
Guy : Le cadre, est aussi une construction imaginaire. C'est à dire que...vous êtes ici en cet instant parce que vous avez vu/trouvé quelque chose. Vous avez été séduite par un discours que vous avez vu sur Internet, où dont on vous a parlé.... Vous êtes mobilisée du côté du Désir justement. Vous êtes prête à cueillir... Par cueillir, je veux dire que vous êtes tenaillée par le Désir de comprendre ce que c'est un cadre d'atelier, pour éventuellement en faire une profession, un métier... pas une profession, mais un métier.
Le cadre est quelque chose qui est valable de manière universelle. C'est un invariant. Il n'y a pas de cadre spécifique d'Atelier pour telle ou telle catégorie de personnes. C'est le même pour tout le monde, que les personnes soient perçues par le groupe social comme "normales", désignées comme handicapées, schizophrènes, névrosées, en bonne santé affective, enfant ou adultes...c'est le même cadre pour tout le monde. Ce désir là...cette activation là... c'est le fruit d'un travail d'activation puissant créé par le cadre proposé.
L'Atelier est construit. Il est pensé. Ce n'est pas seulement des outils, des établis posés comme ça, des matières. C'est un ensemble qui est construit pour déclencher le désir de créer, c'est à dire le désir de se faire du bien. Le désir de se transformer de façon satisfaisante lorsqu'on est tordu, lorsque notre existence, notre vie, sont mal foutues et que c'est intolérable.
Et bien dans ce lieu-là, on va inaugurer un nouveau mode de relation au monde, dans ce cadre très particulier de la rencontre avec des matières. Des matières qui sont en même temps des langages : l'argile, le modelage, l'expérience picturale avec les "pâtes picturales" - l'huile, la gouache, n'importe quoi - la sculpture, l'écriture... Ce sont des matières et des langages. Il y a un mode d'expérience immédiate de ce cadre par les personnes qui va opérer de telle sorte qu'elles ne vont pas pouvoir échapper à ce travail de liaison, de connexion entre l'affectivité - l'inconscient - et le langage. Voilà, c'est ça qui se passe. Personne n'est indemne d'affect. Du moment que les gens sont là, qu'ils sont venus, ils vont inéluctablement être mis en travail. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est une aire de jeu. Mais "Jeu" n'est pas toujours du côté du plaisir. C'est ludique, mais du côté de l'exploration active de cette rencontre là. C'est à dire que l'objet de l'atelier d'expression, ce ne sont pas les matières et leur maîtrise technique, ce n'est pas le langage, c'est cet évènement étincelant de la rencontre, de la percussion de l'affect et du langage. Il faut donc que les gens acceptent de se mettre au monde, de laisser surgir leur monde interne. Mais c'est toujours dans le langage que l'avènement de l'expression est sollicité. Ce n'est pas de l'expression à l'état brut comme ça. Il ne s'agit pas d'exprimer ses émotions. Il s'agit d'exprimer ses émotions dans le langage, dans l'expression créatrice.
Julie : Donc ça implique une construction ? Enfin... je veux dire... le langage, c'est quelque chose de construit ?...
Guy - Le langage de la création, c'est le langage des mains. C'est penser/parler avec les mains. Ce n'est pas le langage des mots. Au fond, il s'agit de laisser les impulsions imaginaires, les émotions, les affects...diriger le mouvement. Et puis tout à coup on va s'apercevoir que la forme nous devance, devance notre pensée. La création, c'est un mode de pensée archaïque.
J'ai un point de vue un peu inverse à celui de la culture. A savoir que ce n'est pas nous qui pensons la création, c'est la création qui nous pense. Tout projet, toute pensée préalable à une création avorte nécessairement.
Julie : Ça va me faire beaucoup réfléchir tout ce que vous me dites ...
Guy - Eh !.... j'en profite ! Je profite de cet entretien aussi pour moi...
Paradoxalement, j'ai, me semble-t-il avec vous, une façon de dire les choses qui est naïve, neuve. Je crois que je vous ai dit des choses qui peuvent être intéressantes pour moi à reprendre dans une écriture théorique.
GL : Vous aurez un travail à faire à partir de ça ?
Julie : Oui, après je ne sais pas trop où je vais...Au départ, je m'intéressais à l'art-thérapie. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler. Ça a toujours été présent dans ma famille à des moments critiques de notre vie... c'était comme ça.
Donc pour moi, j'ai toujours eu le pressentiment, l'intuition que l'expression peut permettre d'explorer des choses dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles avaient pu arriver. J'en ai eu l'expérience personnelle... Forcément c'était toujours dans des moments très précis, avec une musique spéciale... D'ailleurs, je me demande si vous faites aussi d'autres "arts". Je mets des guillemets avec le mot "art"...
Guy : Oui, oui...
JULIE : Je veux dire... dans ce cadre là, que vous proposez, la musique par exemple... Est ce que le fait de créer quand on écoute une certaine musique va mettre dans un état assez spécial pour créer ?
Guy : C'est exclu ici.
Julie : C'est exclu ici ?
Guy : Oui. On ne se sert pas d'adjuvant pour s'exprimer, pas de béquilles sonores. On peut faire ça chez soi quand on travaille, pour distraire l'affect. Ici, la source de création est l'affect. La musique est un art à part entière. C'est une expression. Donc je ne vois pas pourquoi on favoriserait la distraction (le détournement) de ce dont on a besoin pour pouvoir s'exprimer à savoir, justement de l'affect. Cela revient à neutraliser les forces affectives par l'expression d'une autre personne qui se substitue à notre propre travail de transformation dans le langage. La musique est un langage. Entendre de la musique enregistrée pendant que l'on s'exprime dévoie l'expérience affective, source de toute création. C'est comme, fumer une cigarette pendant qu'on crée c'est stérilisant. Les ateliers, c'est la plupart du temps dans le silence total. Les gens sont presque tous seuls dans une bulle, en fait. Chacun est dans son monde intime. Il n'y a pas de distraction possible. Cela se fait naturellement.
Julie : Concentré sur son objectif ?... Alors ça, c'est drôle. Votre vision me fait penser justement à certaines philosophies, en relation avec la question de l'instant présent et du temps ; et de se concentrer sur les moindres gestes. Comme, par exemple, la cérémonie du thé en Chine... C'est très codifié... Mais je veux dire...juste le fait de...
Guy : ...d'être là !
Julie : De prendre conscience des gestes que l'on fait.
GL – C'est exactement cela dont il est question. Etre dans une présence entière à soi, sans filtre. Cela favorise l'émergence. On ne met pas de filtre non plus à l'émergence contrairement à beaucoup de disciplines spirituelles dans lesquelles il s'agit, au fond, de neutraliser les présumées mauvaises parties du soi. Ici, les mauvaises parties du soi, ce sont celles qui vont justement venir au devant de la scène. Quelques fois, quoi... Dans l'optique de l'Art CRU l'animateur n'induit pas dans le filtrage affectif. Nous ne sommes pas là pour inviter à maitriser. Nous sommes au contraire là pour favoriser le relâchement de toute contention morale, spirituelle, psychique qui viendrait perturber le libre flux de la création ...La spiritualité dont il est question ici, c'est ce travail de transformation de l'affect en langage...Et cela est possible à l'intérieur d'un cadre construit pour favoriser et accueillir les puissants effets de sens qui s'y développent. Ça c'est une loi intangible de l'expérience créatrice.
Julie : L'affect ! Je vais retenir !
Guy : La création, c'est transformer l'affect en langage. Ça veut dire que l'affect, il est bien là et qu'il ne va pas être évacué par des méthodes d'auto suggestion ou par des conditionnements.
, par des méthodes comportementales.
Julie : J'aimerai créer mon propre atelier... plus tard, bien entendu, quand j'aurais bien réfléchi à la chose... Mais ce qui m'a toujours intéressée c'était de travailler dans ce domaine notamment avec des personnes en situation de handicap mental. Est-ce que ?... Je ne sais même pas comment poser cette question...Y a-t-il une différence entre la manière dont ça va se passer chez une personne "avec un handicap mental" - on va dire - et une personne réputée "saine" ? Je mets des pincettes, n'est ce pas ?
Guy : Oui, vous avez bien raison parce que...
Julie : Ce n'est pas ce que je pense forcément...
GL :Pourquoi dites-vous autre chose que ce que vous pensez ? Qu'est ce que vous pensez ?
Julie : Mais...pour essayer de voir... Je ne vais pas vous dire ce que je pense directement. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi je veux faire ce métier là. Il n'y a pas de différences profondes non plus entre une personne en situation de handicap mental ou une autre. Pour moi, c'est une autre manière de voir le monde, de ressentir le monde.
Guy : He bien voilà ! Vous avez donné la réponse.
Julie : Je doute de moi. Mais c'est vrai qu'après je n'essaie pas...Je vous pose des questions assez naïves, aussi en fonction des choses que j'entends et un peu...
GL – Pas si naïves que ça.
Julie : Oui peut-être. Et je veux dire justement que c'est vrai aussi au niveau des enfants...dans le développement de la personne... C'est ça ce qui m'intéresse. Qu'est ce que selon vous ça apporte dans sa vie de tous les jours de participer à des ateliers comme ça ?
Guy : Là aussi vous avez la réponse, je pense.
Julie : Ben oui !
Guy : Pour répondre à votre préoccupation, je voudrai d'abord dire que ça n'existe pas un handicap mental. La maladie mentale n'existe pas. C'est un préjugé culturel puissant véhiculé par la psychiatrie, par les laboratoires pharmaceutiques et par la presse audio visuelle. C'est le business chimio-psychiatrique qui a imposé à la culture cette dénomination de "la maladie mentale".
Les gens, nous, nous avons un rapport structuré au monde. Notre rapport au monde, il s'est construit au travers des évènements de notre vie originelle, de notre prime enfance, des traumas rencontrés au cours de notre développement. Et, en fonction de ça, nous établissons une certaine qualité de rapport avec le monde, avec tout le monde Cela est la même chose pour les gens qui ont des déficiences neurologiques. Il n'y a pas de trouble à proprement parler mental. Ce que l'on appelle le mental c'est l'activité psychique, et le psychisme est toujours le reflet de notre rapport au monde qui est manifeste dans notre expérience affective. Toujours. Le psychisme, c'est comme les gaz d'échappement d'une bagnole, ça parle de la qualité du moteur. Si le moteur est de bonne qualité, les gaz d'échappement ne sont pas polluants (pas trop). Si le moteur est foutu, le delco ou n'importe quoi, ça dégage du gaz carbonique et d'autres merdes, et ça pollue. La qualité du gaz à la sortie du tuyau d'échappement, ce n'est pas de la maladie. La maladie est dans certaines parties du moteur... la maladie ou la torsion, plutôt la distorsion dans notre rapport au monde. Donc, ceci est très important ici, dans ces Ateliers, parce que nous ne sommes pas du tout centrés sur le psychisme. Le psychisme c'est un épiphénomène.
Vous comprenez le mot "épiphénomène" ?
Julie : Non pas trop.
Guy : Un épiphénomène c'est un mouvement périphérique, ce n'est pas un centre causal. La vie psychique n'est cause de rien du tout. Je me fais regarder de travers quand je dis ça dans mon milieu professionnel. La vie psychique n'est qu'un effet de la façon dont nous rencontrons le monde, les personnes, les situations sociales... Et donc, les gens qui ont des déficiences neurologiques ont peut-être une vie psychique différente de la votre et de la mienne, mais qui n'est ni plus ni moins une manifestation psychique que l'on n'a ni à mesurer, ni à juger...Ici nous nous intéressons à la personne. C'est ça le point de vue développé dans les ateliers d'expression créatrice analytiques. Quand ici nous recevons quelqu'un, ou un groupe, ce sont des personnes que nous accueillons, quelles que soient leurs différences et la relation qualitative au monde que cette différence là, neurologique par exemple, entraîne. Les enfants mongoliens ont une vie affective très, très riche. Ils ont une vie mentale limitée à des trucs élémentaires. Mais dans un atelier de peinture, une personne trisomique qui peint, elle peint peut-être de façon beaucoup plus libre qu'un éducateur spécialisé hyper adapté. Enfant, adulte, c'est pareil...L'enfant est beaucoup plus libre que l'adulte, beaucoup plus créateur spontanément. Et à partir du CP, ou de je ne sais quoi, l'école détruit méthodiquement l'impulsion créatrice spontanée des enfants. L'école est construite pour démolir les compétences innées au moyen des apprentissages sociaux/mentaux ; pour neutraliser l'aptitude à l'expérience créatrice potentielle des enfants. Le potentiel créateur des enfants est systématiquement éradiqué par l'éducation artistique et le comportementalisme créativiste des anglo-saxons. Un véritable meurtre symbolique.
Julie : Ce que vous me dites, ça me fait penser à cet auteur que j'ai découvert, Arno Stern...
Guy : Que je connais bien !
Julie : Moi je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert, et justement en parlant du Closlieu et de la formulation... Il disait que l'activité créatrice était complètement annihilée par les adultes, que c'était un langage donc ! Du coup, même si l'enfant dessine un pot de fleur, ce qui est important, c'est le jaillissement par exemple... Ce que je trouve intéressant, c'est la dénonciation de cet aspect là... normatif, en fait, de l'éducation où on va dire à l'enfant : "non" à sa spontanéité... où on va prendre pour de l'imagination et corriger le fait que l'enfant va faire une table, des pieds n'importe où, des choses comme ça...et on va lui dire : "non, une table c'est comme ça..."
Guy : L'enseignement artistique promu par l'Education nationale est profondément indigent et destructeur des compétences spontanées de l'enfant. Connaitre est un processus naturel et nécessaire chez tous les êtres vivants, en particulier chez les êtres humains. L'école fait le contraire de ce qu'elle devrait faire. Cela donne une école qui produit 30 à 40% d'échecs scolaires, de déchets scolaires, échecs..... déchets, c'est presque un anagramme...
Julie : Justement, je vais aller y voir. Je vais faire un stage dans une école primaire où, apparemment, la création des enfants a l'air d'être quelque chose d'important pour les enseignants. Dans l'école, il y a plein de petits dessins partout. Ça m'intéresse pas mal cet aspect là. Je n'ai pas encore circonscrit la problématique que je vais traiter ? Mais c'est vrai que, pour des enfants, qu'est ça leur apporterait de ne pas leur imposer cette chose normative, en tous cas dans le champ des arts plastiques ? Toutes ces normes qu'on nous impose. L'école, d'une certaine façon c'est la normalisation sociale. Mais, du coup, est ce que les arts plastiques, à l'école, qui font bien souvent défaut...
Guy : ...qui n'existent pas vraiment, ou qui sont abandonnés très vite, après avoir mis en pièces les bases naturelles de l'expérience créatrice.
Julie : Parce que l'école, qu'est ce qu'elle recherche à travers les arts plastiques ? Est ce qu'elle vise une éducation artistique ?
Guy : Oui. C'est ça le programme de l'Education Nationale : l'éducation artistique. Quelle aberration pédagogique que de prétendre amener des enfants à s'identifier à la démarche d'un artiste. Faire imiter des œuvres de DUBUFFET à des jeunes enfants est à hurler de rire. Surtout lorsqu'on sait que l'expérience artistique est la plupart du temps une expérience liée à un échec de la relation au monde.
Ça paraît un peu bizarre de le dire ainsi, mais, l'art nait d'une distorsion du lien inaugural au monde. L'art nait de l'expérience de destruction et d'insurrection de la personne. L'art, c'est une subversion. Ça ne peut être qu'une subversion. Et l'expérience artistique ne peut réussir que si le créateur, justement, trouve cette issue à sa souffrance, à cette souffrance ontologique basique dans sa relation au monde. On devient artiste parce qu'on échoue à quelque chose de fondamental. L'expérience artistique est liée, chez la plupart des gens qui échouent à y trouver leur réalisation, à un déficit d'être... Certes, il y a des êtres privilégiés...Quand on regarde comme ça, à la loupe la vie de gens comme celle de Picasso...Ce sont des gens qui ont eu des vies absolument désastreuses. Ils ont fait du pognon, certes. Ils ont souvent eu une vie sexuelle débridée. Ils avaient un talent fou pour certains, mais...
Ça, cette attitude-là en face du monde, c'est de toutes façons quelque chose qui ne peut absolument pas s'enseigner. Vouloir enseigner ça aux enfants, c'est mettre la charrue avant les bœufs. On n'apprend pas aux jeunes enfants à parler en leur faisant des cours de grammaire ou d'orthographe, ni de phonétique. Ils baignent dans un flux affectif où ils entendent des sons, des phonèmes, qui vont devenir progressivement du sens. On ne leur apprend pas la technique de la marche. L'enfant normal se met à crapahuter pour suivre sa mère. Et après, il se lève parce qu'il a son père devant lui qui lui tend les bras. Il se met debout.
Julie : Donc, il y aurait une part d'inné ?
Guy : La compétence créatrice est innée. Marcher et parler, sont des expériences créatrices pour l'enfant, qui procèdent de son capital génétique.
Julie : Après, c'est trouver le bon support, comme vous dites, de la mère qui va tendre les bras.
Guy : Voilà ! C'est ça l'Atelier d'Expression Créatrice ! L'animateur y remplit plusieurs fonctions. Il remplit, d'une part, la fonction de la mère qui tend les bras et puis qui donne aussi les matières. Le sein, c'est la table palette, ce sont les palettes d'argile, de papiers, de tissus. En ce moment, ici, fonctionne un groupe de formation qualifiante à la fonction d'animateurs d'Ateliers d'Expression Créatrice. Tous les mois, pendant une année et demie, ils viennent passer une semaine à se confronter à un langage différent. Là ils arrivent en fin de formation, ils travaillent sur les marionnettes. Quand ils arrivent dans l'Atelier, le lundi matin, il trouvent des grandes boites plastiques remplies de tissus, des laines, des ficelles, des matériaux composites, des outils des ciseaux, des cutters, des colles... Dès qu'on rentre dans l'atelier, on est ébloui. Le désir est immédiatement allumé.
Julie : On va s'amuser ?
Guy : S'amuser...disons qu'on va pouvoir jouer.
Julie : Oui, c'est ça.
Guy : On va pouvoir jouer. L'atelier est une aire de jeu quels que soient les langages qui y sont proposés.
Julie : Là j'aurai plein de questions à vous poser.
Guy : Le matin, ils commencent un personnage. Ils ont une heure et demie d'atelier. Ils ont ensuite une heure de jeu avec les marionnettes, dans l'état où elles se trouvent. Ils vont devant le castelet ou derrière et ils commencent à jouer avec/devant le groupe. Et puis, l'après-midi, ils recommencent l'atelier, puis à nouveau un temps de jeu, puis un temps de parole.
Une des caractéristique du cadre, c'est qu' après chaque atelier, le groupe a une heure à sa disposition au cours de laquelle chacun est invité à dire ce qui se passe à l'intérieur de son expérience pendant le temps de création; à parler de son expérience vécue. Qu'est ce qui se passe au plan affectif, émotionnel...au plan psychique aussi. Et puis il y a des retours de mémoire. Il y a un imaginaire qui se met en état d'effervescence, de fermentation. Et quand une personne a restitué son expérience, des fois, il y a des choses assez bouleversantes qui remontent à la surface et dont la personne, avec le concours de l'animateur va prendre soin. Ce n'est pas une thérapie, c'est un soin à la personne. On prend soin de soi. L'animateur prend soin des personnes et du groupe.
Julie : Oui parce que la thérapie ça peut supposer aussi le fait que la personne soit en état de besoin et attend de l'aide de quelqu'un au dessus...
Guy : Ce n'est pas quelqu'un "au-dessus". La thérapie, c'est seulement un contrat explicite passé entre une personne qui considère que sa vie est foireuse, que ça ne va pas, qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule pour être vivante et normalement heureuse... et donc, elle fait appel à quelqu'un dont c'est le métier d'écouter et de participer à ce travail de reconstruction d'une histoire...et donc, la thérapie c'est un contrat. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça parce qu'on fait des marionnettes. Une thérapie, c'est un contrat.
Ici ce ne sont pas des ateliers de thérapie. Ce sont des ateliers de formation. Les mêmes événements affectifs s'y produisent, mais ils ne sont pas "traités" par le formateur comme dans un contrat "thérapeutique".
Julie : J'ai perdu le fil de ma pensée... Le fait de passer de ce langage corporel, de ce langage de la matière et de tout... le fait ensuite de passer au langage parlé. Est ce que ça conscientise ce qu'on a senti par le corps ? Est ce que, du coup, c'est une démarche nécessaire, pour pouvoir se conscientiser ?
Guy : Le mot "conscientiser", je le trouve un peu bizarre mais...
Le travail, au fond, lorsqu'on l'examine d'un point de vue professionnel, c'est de comprendre comment se développe la perception ? C'est un problème aussi que l'on rencontre dans toutes les philosophies spirituelles, dans les spiritualités orientales.
Au fond, le véritable travail c'est d'ouvrir notre perception à l'expérience immédiate. Quelle expérience fait-on, tout de suite, de ce qui est là, à travers ces moments de création qui nous donnent beaucoup de matière(s) à penser.
Donc, la parole, le fait de faire cet effort de communiquer à d'autres humains qui sont les membres du groupe - et à l'animateur en particulier - de dire à ces autres humains ce qui se passe en soi, la façon dont l'acte créateur se développe, ça ouvre la personne à reconnaître ce qui est là, en soi. Reconnaître et admettre ce qui est là, dont une partie est perceptible au travers de l'objet créé. Donc il y a là, devant soi, une argile, là, qui est porteuse d'éprouvés, de sentiments... On s'aperçoit, en en parlant, de choses que l'on n'avait pas perçues. Et puis, les autres en face nous écoutent sans nous juger. Cette attitude-là, essentielle, fondamentalement opérante, se met très rapidement en place ... nous nous sentons écouté, nous nous sentons considérés comme une personne. Et quand on ressent réellement ça, cela ouvre le champ de la perception. C'est automatique. On devient de plus en plus conscient, c'est à dire qu'on perçoit ce qui constitue notre expérience inconsciente qui reste inconsciente pour autant qu'elle n'a pas pu accéder au langage.
Dans l'expérience créatrice, il y a un premier niveau de langage qui est très archaïque, qui est un langage d'avant les mots. Le fait d'ouvrir l'espace des mots, d'ouvrir cette expérience de la prononciation de ce qui est là, à fleur de pensée, c'est faire le mouvement inverse de celui que fait par exemple la technique psychanalytique où on essaie d'amener le langage vers l'inconscient. Là, c'est l'affect inconscient qui va tout seul, de son propre chef mobiliser le langage. Et le langage humain, le langage de la communication inter humaine, c'est les mots. C'est à dire que quand on arrive à dire les choses qui sont là, on peut être intégré à une communauté qui s'appelle la communauté humaine. Être humain, ce n'est pas donné d'emblée. Quand on peint, quand on manipule de l'argile ou n'importe quoi, on se déplace dans des zones affectives, on n'est pas dans des zones humaines. L'affectivité est non humaine. C'est pour ça que l'inconscient est inconscient de ça. Parce que l'inconscient c'est le "non humain". Ce qui rend l'inconscient proprement humain, c'est cette ouverture de la parole quand elle est reliée à l'expérience vécue. Quand on peint, quand on manipule de l'argile on ne perçoit pas ce qu'on éprouve. On laisse circuler l'éprouvé dans le langage mais on ne le voit pas. On ne peut pas être dedans et à l'extérieur. Il y faut de l'@utre.
Et ce temps de parole que nous ouvrons ici après chaque Atelier, c'est un temps où on arrive à introduire cette extériorité à travers l'écoute des autres. C'est quelque chose d'important ça.
Julie : Il y a tellement de choses importantes... J'aurai tellement de questions...
Guy : (souriant) Nous allons écrire un livre...
Julie : Ça m'a toujours intrigué tout ça... Attendez...que je n'oublie pas des choses... Si vous voulez, ce sont des choses... Comme je lis de tout et n'importe quoi
Guy : Vous avez lu Arno Stern ?
Julie : Oui ! J'ai découvert ça... Je suis allée sur son site et j'ai rendez-vous demain avec une personne qui a été formée par lui. Je vais découvrir leur vision des choses. Après ce que nous venons de dire, je me demande si ça ne va pas être directif, du coup ?
Guy : Non.
Julie : C'est dans la non directivité ?
Guy : Chez les praticiens de l'approche sternienne, il n'y a aucune direction des jeux ou de la formulation. La formulation est quelque chose d'essentiellement libre.
Julie : Et pensez-vous que ce travail là...dans le cadre de l'école, de ce qui est fait avec les arts plastiques...qu'un tel travail serait possible, dans la situation scolaire ?... Est ce que les enfants, si on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire...Non... je suis sûre qu'ils trouvent le chemin par eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Ça serait assez drôle de voir ce qui se passerait. Est ce qu'après, les enfants vont en parler entre eux ? Est ce qu'on peut les faire parler justement de ce qu'ils ont ressenti ?
Guy : Les enfants n'ont pas besoin de ça. Je parlais des adultes, de personnes complètement déformées, kidnappées par la culture. Les enfants, ils parlent spontanément dans l'atelier. Et puis, il y a des moments où on peut parler avec eux, autour d'un petit goûter, ou n'importe.
Julie : Donc il faut quand même à la base un désir. Ceux qui viennent ici, il faut qu'ils aient quand même le désir de...
GL – Il faut qu'ils aient le Désir d'être vivants ! Ou qu'ils le découvrent. La condensation du Désir constitue le cœur de l'expérience créatrice.
Julie : "Être vivant", ça , ça me fait totalement penser à Jim Morrison qui disait ça. Je suis une grande fan. Les artistes qui m'intéressent sont des personnes comme Morrison. Et ce qui me plait, c'est justement ça : ouvrir les portes de la perception. Il y en a qui vont faire ça par d'autres biais comme les drogues ou des choses comme ça... autre chose.
Guy : Comme écouter de la musique en peignant ?
Julie : Voilà, c'est un substitut.
GL – C'est une voie fermée. C'est une fermeture.
Julie : Tout à fait ! Je suis d'accord.
Actuellement je m'intéresse à une chose qui apparemment n'a rien à voir, avec ces questions. Je m'intéresse aux expériences de mort imminente. J'ai vu un très bon documentaire sur Arte. C'était un professeur américain qui étudiait le cerveau, justement, et qui se rendait compte qu'on était en train de découvrir quelque chose d'encore plus profond. Si vous voulez, vous auriez l'esprit - je ne sais pas trop comment représenter çà - la matière, et il y aurait encore quelque chose de beaucoup plus profond d'où viendraient aussi les rêves lucides.
Guy : Les rêves lucides ?
Julie : Les rêves lucides. Ce sont des personnes qui font des rêves éveillés, ou, comme dans des cas de mort imminente justement, où les personnes sont conscientes que ce n'est...enfin bref... pas que c'est réel, mais qu'elles sont réveillées. Elles sont mortes quand même...
Ce qui m'intéressait, c'est que, même la science est en train de se poser des questions sur le fait que notre cerveau est capable d'accéder à une autre réalité.
Ce dont j'ai l'impression, c'est que la création, l'expression, quand on se met en condition...on va rentrer dans l'atelier, on va sentir une sorte d'énergie - je dirais - parce que je n'ai pas les termes exacts. Mais tout est là pour... Ça vous met dans un état personnel, vous allez être dans votre bulle et j'ai l'impression que c'est un peu ça, accéder à une autre réalité, à d'autres perceptions.
Guy : Oui, pour reprendre votre induction, moi je dirai que c'est une expérience de vie imminente. Dans la création, on fait une expérience de vie imminente. C'est à dire qu'on pressent que ça va être puissant du côté de la libido et des résistances de mort.
Julie : La pulsion de mort ?
Guy : Non, ça n'existe pas la pulsion de mort.
Julie : Chez Freud ?
Guy : Chez Freud, oui...mais c'est du bidon. C'est un truc freudien. La pulsion de mort, ça n'a aucun sens. La totalité de la vie organique est concentrée sur le vivant, sur "être vivant". La pulsion de mort est un fantasme de théoricien addictif. Il ne sert à rien. Personne n'y a jamais cru.
Julie : Mais enfin ! Au point de vue universitaire, ils y tiennent bien.
Guy : Oui, oui. Les vieux...les vieilles culottes ont la bretelle freudienne.
Julie : Oh ! Même les jeunes !
Guy : Les lacaniens, vous croyez ?...Ça les discréditerait complètement s'ils y croient.
[La séquence suivante de l'entretien portant sur l'intérêt de Julie pour certains phénomènes relevant de la parapsychologie a été retirée du texte.]
Guy : En vous écoutant parler de ces phénomènes "extrasensoriels", moi, je pense aux phénomènes affectifs. Les phénomènes affectifs, c'est tout ce dont vous parler là, les histoires de mort imminente, d'aura...En termes psy on parlerait beaucoup de phénomènes de transfert - moi, je dis de phénomènes intertransférentiels.
Dans un article que j'ai nommé : "La relation intertransférentielle" [1], j'ai mis en évidence le fait que beaucoup d'événements relationnels, dans notre vie quotidienne et, à plus forte raison, dans notre vie professionnelle, sont développées autour de ces liens affectifs. Si on choisit de vivre un métier de cette nature là, on est aux prises en permanence avec cette question là : "Qu'est ce qui se passe au plan affectif lorsque deux êtres sont mis en présence l'un de l'autre ?". Cela me renvoie de nouveau à la question de la perception.
La perception n'est pas quelque chose qui nous est donné. La perception est une construction. La perception n'a rien à voir avec la sensation. Les chats, les chiens, les serpents, les souris vivent à partir de la sensation et des expériences de conditionnement de la sensation. Nous, nous avons perdu cette relation directe, non médiate, avec la sensation, qui soit à elle même sa propre signification. Malheureusement ! C'est à dire que nous sommes des déficients de l'instinct, des handicapés de la vie instinctuelle. Nous ne pouvons pas nous fier à nos sensations justement parce que notre cerveau s'est développé autrement. Nous sommes des déficients instinctuels dans notre relation au monde - notre être-au-monde - et donc obligés de reconstruire une pensée de notre relation au monde, à partir de la représentation et non de la sensation. C'est ça qui nous distingue des chiens, des chats et de mon bougainvillier. Nous sommes colonisés par un monde de représentations, par une vie psychique qui est, à l'intérieur de nous, la transposition du monde extérieur (vécu comme objet dans notre monde interne). Et nous sommes, sans interruption, en train de réorganiser notre construction intérieure du lien que nous entretenons avec le monde. Sans arrêt ! C'est toujours en remaniement perpétuel.
C'est ce travail de fermentation qui constitue la base de notre développement culturel et de la communication sociale et scientifique. Mais tout ça se développe en aval de l'expérience d'être au monde. Ça, c'est mon point de vue phénoménologique, qui part non pas du savoir, mais de l'expérience de mon être au monde de la création, élaborée, analysée, qui n'existe pas en dehors de la pensée.
Julie : Je vais avoir de quoi penser...
Guy : Voilà !
Julie : Pour repartir sur ça... Est ce que ça peut arriver, par exemple, de vous retrouver face à quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui ne passe pas. Et des fois, juste le fait de dire un mot, ou l'intention qu'on va mettre dans notre phrase va changer complètement la relation que nous avons avec cette personne. Ceci m'est déjà arrivé, face à quelqu'un qui était complètement énervé... quand j'étais caissière... c'est assez drôle...
En tant que caissière au début, c'était comme si les gens sentaient que je commençais. Que je n'étais pas sûre de moi. Donc toutes les personnes que j'attirais à ma caisse, c'était des râleurs, des gens qui commençaient à m'insulter, à me dire de tout. Moi, je me suis dit "Mais, qu'est ce qui se passe ?" Sauf qu'après, comme mes études durent, durent, durent, au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il suffit qu'il y ait une personne qui commence à râler... que cette personne a eu un sale coup juste avant...Ça vient de sa vie, de sa manière de voir les choses. Là, elle n'a pas pris le bon paquet de pommes de terre, et c'est tout un drame. Elle va s'énerver sur moi, pour se lâcher. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas sur ma personne ! Mais, juste le fait de faire un sourire et de lui montrer que "Ce n'est pas grave"...Juste des mots, une intention... vont changer le comportement de la personne. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors, est ce que c'est de la manipulation ?
Guy : Non, c'est de la bonne hygiène sociale; c'est être attentif à la personne, à ce qu'elle éprouve plutôt qu'à ce que l'on voit, dans l'apparence, de son agressivité. Ça se passe de la même façon dans les ateliers, des fois... pour en revenir aux ateliers...
Julie : Comment ça se passe ?
Guy : L'animateur dans un atelier, il est comme la caissière dont vous parlez. Il est l'objet de projections de la part des personnes, de tous leurs états affectifs du moment. De façon plus explicite, sans doute. Et des fois, ça se développe...ça se développe mais c'est plus profond que le sac de patates. En l'occurrence, c'est la façon dont elle a été tenue dans les bras par sa mère quand elle était un bébé ; où le fait qu'elle a été violé par son papa ; ou qu'elle a fait un avortement dramatique. C'est ça qui remonte à la surface et qu'on vient déposer sur le comptoir de l'Atelier. L'animateur, il est une sorte de récipient de quelques uns de ces mouvements ambivalents entre le désir de sortir ces choses là, de les digérer, de les assimiler, de les dégager de la scène affective, et de la frayeur rétroactive que ça provoque. Ça bouleverse d'être confrontée sans crier gare à un truc qu'on a fait à dix-huit ans, parce qu'on ne pouvait pas garder ce bébé, auquel on n'a jamais vraiment réagi émotionnellement, auquel on n'a jamais réellement donné un prénom et une sépulture. Alors c'est ça qui revient dans l'argile.
Julie : Et donc l'animateur...
Guy : L'animateur, il fait travailler ça. Notre boulot, c'est ça. C'est d'écouter ça, d'aider à l'élaboration de toutes ces éruptions affectives résiduelles, pour que ça puisse s'énoncer complètement ; et d'accueillir les émotions que ça déclenche. Parce que, quand on reévoque certaines choses, un parent qui est mort auquel on était complètement fixé, le fait de s'être fait tabasser par son père, les viols, les avortements, ou n'importe. Tout arrive quoi. Donc notre boulot c'est d'offrir cette aire de jeu, cet espace de liberté et d'accompagner et d'écouter. C'est d'être écoutant, accueillant, contenant, et d'inviter les personnes, à chaque fois, une fois engagé le travail de l'élaboration, à repartir vers la création. Donc la création, ça n'a rien à voir avec un objet culturel, artistique. La création, ça a à voir avec un objet interne qui va trouver sa formulation dans la matière et sa résolution dans la vie affective actuelle de la personne.
Julie : Sans prétention artistique.
Guy : Sans intention. L'intention artistique, c'est un truc désastreux pour la création !
Julie : Ça fait du bien d'entendre ça.
@
[1] Guy Lafargue " De l'affect à la représentation" (ART CRU Ed.)
Théorie mon amour
Théorie mon amour
Les fleurs, c'est une invention de la terre pour faire croire qu'elle est féconde
(Guy Lafargue - Le sommeil fertile - 1967)
Guy Lafargue
@
Depuis les origines de la vie sociale, les êtres humains ont créé une culture dont la fonction a toujours été, au travers d'une imagerie poétique, à la fois de représenter symboliquement les forces de la vie, et de s'en assurer, au moins imaginairement, le contrôle. Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour considérer la formation des mythes, de la religion et de la science, comme les fruits spirituels d'une tension visant à l'explication et à la maîtrise subjective du Réel, ce qui est la visée majeure de la fonction psychique.
De tous temps, la maîtrise de la connaissance a conféré à ses détenteurs un statut singulier au sein des institutions collectives et un rôle de pouvoir sur la destinée des individus et des groupes sociaux : magiciens, prêtres, savants sont à cette place de créateurs et de dépositaires du savoir qui leur conférait l'autorité qui fonde la croyance. Ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui.
La contribution du vingtième siècle englouti à cette édification aura été de pouvoir porter toute l'acuité de ce besoin d'assujettissement du Réel simultanément :
- sur la maîtrise technologique des forces du travail humain : dans ce domaine notre culture est passée d'un état de contrôle imaginaire à un état de relative maîtrise des forces ergonomiques, biologiques et technologiques.
- sur l'analyse des processus psychiques de la formation des croyances et de la connaissance ainsi que des mécanismes de leurs échanges.
- sur les processus psychosociologiques de la formation de la culture, des idéologies, de la communication et des institutions.
- enfin, sur la connaissance de l'organisation cérébrale, de la physiologie du système nerveux dans les domaines de l'apprentissage, de la mémoire, des émotions, de la vie affective.
Au siècle dernier, les comportements humains sont devenus le centre et la cible de cette visée omnipotente qui anime le travail de la connaissance scientifique depuis ses origines. Les "sciences humaines" se sont constituées comme ce lieu d'élaboration des lois régissant le fonctionnement des forces affectives, de l'économie psychique et de l'économie sociale, dont la finalité mythique reste toujours aussi virulente et ambiguë : réduire la part de l'irrationnel et du chaos originaires, soumettre les forces occultes de la vie au contrôle souverain de la connaissance et à leur exploitation économique.
Il appartenait à cette logique idéïque, fondée sur l'impulsion subjective et phantasmatique omnipotente, de forger des représentations/croyances qui en légitiment le fonctionnement et qui verrouillent toute tentative d'en souligner les ambiguïtés et le surdéterminations anthropomorphiques, ce qui est la caractéristique fondatrice de toute idéologie, que celle ci soit en rupture ou en synergie avec les forces vivantes et les visées génétiques de l'organisme humain par où elles se divisent en idéologies instrumentales ou humanistes.
@
Ainsi, le discours des sciences humaines et technologiques nous a conditionnés à nous représenter la complexification de l'évolution humaine, de la connaissance, et des lois de leur déploiement, comme une progression qualitative linéaire ; et la maîtrise des déterminants biologiques, psychiques et technologiques comme un bien, comme un but désirable, possible et nécessaire. C'est précisément par là que le discours scientifique verse dans l'idéologie instrumentalisante, c'est-à-dire dans un système de croyances qui prétend échapper à l'acuité et aux exigences de ses propres surdéterminations fondatrices. L'utopie a changé de forme, elle a pris les couleurs du temps, mais, dans sa prétention à l'exemption analytique de ses propres déterminants phantasmatiques, elle reste foncièrement de mauvaise foi.
La pulsion créatrice - qui est le mode anthropomorphe de la pulsion - s'est diluée dans la complexité et la sophistication de ses propres outils analytiques au point de la prétendre inanalysable. Paradoxalement elle est aussi ce par quoi le scandale arrive, car il est dans la nature même de la pulsion créatrice de se dérober à toute tentative d'assujettissement. Elle est fondamentalement rebelle, et d'autant plus incisive qu'elle est soumise aux injonctions de conformité. La pulsion créatrice - Dieu merci - est insurrectionnelle.
@
L'image que j'ai placée en exergue de la réflexion que j'entame ici :
"Les fleurs, c'est une invention de la terre pour faire croire qu'elle est féconde", est une condensation poétique et philosophique qui traduit intuitivement cette idée explicative de l'évolution humaine qui nous est culturellement inculquée comme étant de nature progressive. Je veux dire par là que j'appréhende cet immense travail biologique de la complexification du cerveau humain, non comme une supériorité qualitative de l'homme sur l'animal, mais comme un processus de dégénérescence adaptative, comme l'effet d'une détérioration des schémas instinctuels et comme le fruit d'une faillite biologique dans les dispositifs d'adaptation de l'espèce humaine à son environnement. C'est une vision philosophique qui a pour moi une raisonnance concrète dans ma façon d'envisager mon lien avec mes semblables, en particulier dans mon engagement professionnel.
Rupture de la répétition onaniste des textes sacrés devant le mur des lamentations métapsychiques.
Dans ce renversement de point de vue, dans cette fracture du regard hypnotique, notre indécrottable narcissisme culturel qui place l'homme au sommet de la spirale évolutive devient un simple objet culturel fossile, témoin du modèle philosophique nombriliste esquissé par Freud dans son "Malaise dans la civilisation", réédition de cet effort stérile et insensé pour conjurer les aspérités friables de la mort. A classer sur les étagères du musée anthropologique.
Autrement dit, si ma vision du monde est sensée, ce qui fonde la singularité humaine, c'est l'apparition dans la chaîne vivante d'une faille des dispositifs instinctuels, dont le fonctionnement a été compromis, pour des raisons qui m'échappent, ce qui n'a pas grande importance. Pour le peu que j'en ai perception, ce renversement épistémologique s'applique bien entendu à l'évolution de la matière vivante. Il me conduit, en dernière analyse, à récuser le dualisme établi entre matière et vie, et à considérer le vivant comme une dégénérescence de la matière. Ce qui nous entraîne dans un débat philosophique que je me garderai bien d'entreprendre ici.
L'enjeu théorique et méthodologique de ce débat par contre est intéressant. Et, sur lui, nous avons une prise. Il s'agit tout simplement de savoir si la vision élaborée par Freud, du développement de la civilisation étroitement fondé sur la célébration de la castration, devenue la norme culturelle du siècle dernier (dans lequel on trempe encore les pieds), ne s'est pas constitué en pierre angulaire du vieux credo scientiste qui fait retour en force avec le néo-comportementalisme. Et qu'en faisant de la renonciation au primat instinctuel et du travail de la sublimation les nouvelles visées comportementales assignées à l'éducation, Freud ne nous ait rendu le très mauvais service de relayer dans la psyché contemporaine, les vieilles fripes d'une religion sado-masochique qui n'en finit pas de distiller sa morbidité et ses prétentions normatives dans la psyché collective.
En quittant le terrain de la cure analytique et de l'exploration des processus psychiques (où il a fait réellement œuvre féconde de pionnier), pour reprendre le froc élimé du moraliste et du guide spirituel, Freud s'est exilé de sa propre incertitude créatrice. En troquant l'investigation phénoménologique pour la supputation explicative totalitaire, on prend toujours le risque d'une généralisation qui n'a pour autre nécessité que celle de bercer les phantasmes omnipotents du théoricien. La métapsychologie, pour cette part de dérive poétique, qu'elle met en œuvre est le tribut payé par Freud à la culpabilité et aux ancêtres. En définitive, cela est rassurant. Le processus de pensée et de conceptualisation de Freud comme illustration de la phénoménologie psychique mérite à cet égard la belle estime due aux œuvres créatrices authentiques. On ne peut pas toujours en dire autant de ses clones. Cela nous amène à remettre en chantier, sur la base de l'observation clinique, les interrogations qu'il nous a transmises ; et nous enseigne aussi que le libre exercice de la pensée dont il a fait preuve face à ses contemporains, n'a pu avoir raison de la totalité des scories culturelles contre lesquelles il a conduit une guérilla intransigeante.
Destin de la théorie psychiste
de Sigmund FREUD
Mon propos est simple, direct et définitif : la psychologie, sur laquelle reposent toutes les croyances du siècle (le 20°)est une science sans objet. Je suis moi-même étonné de la force affective, de la constance et de l'insistance, de l'insistance psychique, de ce propos dans mes élaborations personnelles depuis le début de mon travail de penser le champ analytique/thérapeutique.
La notion de causalité psychique a la peau dure. Elle n'est pas prête de rendre l'âme. Bien entendu, parmi les caciques, personnes n'y croit vraiment. Mais tout le monde fait comme si.
Ma conviction intime est que le psychisme ne joue dans le destin humain aucune force causale parce qu'il n'existe pas (cela ne manquera pas de réveiller un instant les vieux démons roublards de leur sieste). Ce qui existe c'est la production d'images mentales, à proprement parler psychiques. C'est le process de production lui-même. La notion d'appareil à penser dont se gargarisent les psy branchés est un concept/écran, anthropomorphe, une pure invention psychique destinée à leurrer l'ego, à combler le vide des incertitudes et pour finir, à bloquer le travail de la pensée créatrice. Recouvrement des émanations émergeant d'une activité neurologique par un concept.
La fonction psychique, créatrice des formes phantasmatiques, imaginaires et symboliques (représentations d'éprouvés affectifs hallucinatoires , représentations fantasmatiques et représentations de mots) est essentiellement une fonction de composition de formes mentales visant à informer (des "informs") l'organisme du sujet humain sur son état de réalisation ou de carence, ou de détérioration du potentiel d'accomplissement de son destin d'être humain . Cette pensée est pour l'instant une incongruité culturelle, mais, comme je l'ai déjà dis, elle insiste.
La fin de la métapsychologie
Si, comme je le pense, la psychologie est bien une science sans objet, il va de soi que la métapsychologie freudienne, qui s'en veut la quintessence, et ses dérivés lacaniens, reichiens, junguiens se révèlent bardés de postulats et de dogmes visant à maintenir la cohésion des adeptes dans leur système de croyances, et notamment dans celui qui assure la pérennité de ses outils opérationnels qu'on appelle la technique.
Que l'on m'entende bien : l'antipsychanalyse ne me concerne pas en tant qu'elle a pour but la disqualification de la psychanalyse qui est à mes yeux la discipline de soin analytique fondamentale et fondatrice du champ de la psychothérapie. La destruction de son corpus théorico-technique n'entre en aucune façon dans mon projet. Je considère qu'un certain nombre de ses concepts opératoires constitue le bagage solide et incontournable de tout professionnel de l'analyse engagé dans le champ thérapeutique et dans le champ social. Je revendique même avec fermeté le droit d'adopter, de remanier et de me servir de ceux de ces concepts dont j'ai éprouvé la valeur opérante dans mon propre champ d'expérience de la situation analytique. Cependant, n'en déplaise aux puritains et aux intégristes, j'estime qu'une fois hommage rendu à leurs créateurs, les outils appartiennent à ceux qui s'en servent.
Par contre, le psychanalysme comme doctrine hégémonique et dogmatique, comme instance explicative de dernier recours dans le champ de la phénoménologie affective et psychique, ne trouve aucune grâce à mes yeux. Les dérives spéculatives qui trament son histoire [1] et leurs instrumentalisation syncrétique dans le colonialisme de la psychanalyse appliquée, ne méritent aucune complaisance.
Il serait intéressant de savoir pourquoi au début du 20° siècle, en passant de Vienne à Paris, la psycho-analyse comme praxis inventive, comme tentative de compréhension et de réponse apportée à la détresse affective de la personne et comme dynamique du lien analytique est devenue LaPsychanalyse comme doctrine spéculative à prétention explicative universelle : la technique de soin recouverte et phagocytée par la doctrine psychologique.
Il n'y a que dans la langue et la culture française que cet escamotage du o en a s'est opéré. Dans les pays de langue germanique, latine, anglophone, hispanophone, le terme originel psycho-analyse est resté sans modification, et avec lui, peut-être, le soucis de préserver le primat de l'expérience clinique et de l'analyse phénoménologique sur la spéculation et les enjeux de pouvoir dont elle est le masque.
Dans ce tour de passe-passe ortho-graphique, dans cet escamotage de salon (celui de Marie Bonaparte), c'est tout l'enjeu qui est posé du passage d'une praxis de la thérapie à une doctrine abstraite, parfois totalement décontextualisée de la préoccupation primaire qui la fonde, comme chez Jacques Lacan vers la triste fin de sa vie, si j'en crois ce qu'en écrit Elisabeth Roudinesco (qui le dit également de Freud) [2].
@
LES MOTS NE SOUFFRENT PAS
L'ensemble de l'hypothèse autour de laquelle s'organise ma réflexion pose comme point de départ l'affirmation selon laquelle les évènements psychiques ne sont saisissables qu'en tant que "morphes" c'est à dire que productions circonstancielles et éphémères; qu'en tant qu'idéations.
Les événements psychiques sont des condensations électroniques d'opérations biochimiques de l'organe neurologique ; condensations sporadiques, fluentes, dont la structure reste stable dans la mesure où elle persiste dans le tissu cortical sous la forme de traces, d'engrammes stables, déterminés par des inscriptions mnésiques originaires immuables.
Ce point de vue fait obligation de reconsidérer deux termes sacrés usuels du vocabulaire psy : celui de "psycho-pathologie" et celui de "psychothérapie" :
- Le terme "psycho-pathologie", dans cette perspective, n'a pas de sens. Dans sa définition usuelle, ce terme est pris dans le pré-supposé de l'existence d'une psyché autonome constitutionnellement existante, d'un "appareil" psychique. Et dans cet autre pré-supposé d'un dysfonctionnements, d'une défectuosité de cet organe immatériel. C'est le point de vu des biologistes de la psychiatrie organiciste dans le champ psychanalytique.
Pris à son sens étymologique, "psychopathologie" signifie "souffrance psychique". Si l'on accepte de considérer le point de vue dont je tente sans grande illusion de frayer une voie, on est obligé de considérer qu'il n'existe pas à proprement parler, de souffrance psychique. Pas plus qu'il n'existe de souffrance dans le mot. Tout comme le mot, dont il est l'une des efférences sensori-motrices, le phénomène psychique, est lui-même traduction d'un état affectif dans une forme mentale. La souffrance, comme la jouissance, sont les constituants de l'affect. Et s'il y a conflit, ce n'est pas entre des entités psychiques (qui n'ont pas plus de consistance que celle des mots), mais au cœur même de la visée pulsionnelle qui échoue dans sa réalisation. La souffrance est de nature organique ; son origine en est affective, et certaines de ses manifestations sensibles en sont psychiques .
La vie psychique, dans cette représentation épistémologique, a essentiellement une fonction informative sur les distorsions infligées au dispositif instinctuel lui-même .
Il me semble donc entièrement fondé de renoncer au terme de "psychopathologie" non seulement à cause de la connotation médicale qui tend à accréditer l'idée d'une maladie psychique qui fonctionnerait indépendamment de ses sources affectives ; mais parce qu'elle n'a pas de fondement. L'approche des évènements psychiques doit être poursuivie dans le cadre d'une épiphénoménologie du système affectif.
- Quant au terme de "psycho-thérapie" (soin psychique ou soin du système psychique), son sens usuel est pris dans le présupposé précédent : à savoir que l'on soignerait une fonction psychique qui serait malade ce qui est proprement insensé. C'est, d'une certaine façon, le point de vue solidaire de la psychanalyse traditionaliste et de la psychiatrie contemporaine dans leurs formulations.
@
Si l'on reprend cette question sous l'angle de vue que je propose, on ne peut à proprement parler de "psycho - thérapie" que lorsqu'on met en place un dispositif visant à "traiter" la souffrance affective du sujet par l'utilisation privilégiée de la fonction psychique , au moyen d'un travail psychodynamique qui utilise la fonction de transit de la fonction psychique entre soma et environnement, dont le psychique est imprégné et façonné. Dans cette création heuristique, la psychanalyse est inaugurale. Mais cela ne doit pas nous distraire du fait que la matière à traiter (par le sujet lui-même) reste la souffrance affective et ses composantes émotionnelles. Quand au caractère judicieux du choix d'utiliser la fonction psy pour traiter des souffrances affectives, il n'est plus à démontrer, même si elle ne constitue qu'un des processus utilisables parmi d'autres : l'expression émotionnelle, l'expression affective, l'expression æsthétique....
Si la production psychique a bien cette visée épistémologique qu'il est légitime de lui prêter (dans le sens soma > morphes psychiques > perception) elle possède en retour un potentiel d'ébranlement et de transformation des stases et des rigidités émotionnelles et affectives. C'est là, à proprement parler, sa fonction psycho-dynamique.
En dernière analyse, ce qui est opérant dans la situation analytique n'est pas d'abord le travail cognitif appuyé sur la mécanique associative, mais bien la régression et l'érotisation soudaine (ou progressive) de la communication affective invitée à se déployer librement dans l'expérience de l'analyse . Autorisée à s'y manifester dans un climat de levée de la censure et de la répression morale et affective, l'intensification de l'activité psychique va ouvrir des voies de frayage aux affects, aux émotions réprimées et aux souvenirs inhibés. C'est cela qui est le moteur de la fermentation pulsionnelle au sein du lien analytique et de sa réintégration dans le champ de la perception subjective.
C'est à la lumière de ce renversement de perspective que je suis amené à modeler une théorie singulière de la pratique analytique, qui, avant d'être théorie aura d'abord été intuition, mise en acte et transformation de la pratique (praxis).
DE LA THEORIE COMME
OBJET TRANSITIONNEL
Nous entretenons avec les théories des rapports ambigus de type conjugal : nous les choyons quand elles nous satisfont ; nous en convoitons de plus séduisantes lorsque nous avons épuisé leur mystère. Certaines d'entre elles sont rebelles à nos changements d'humeur, qui n'hésitent pas à faire leurs griffes sur notre narcissisme, ce qui est quelquefois bien rassurant.
Dans le domaine qui est examiné ici - celui de la conduite de la relation et de l'expression d'autrui en vue de sa croissance et de sa santé affective - nous disposons d'un ensemble de théories explicatives des processus affectifs, émotionnels et psychiques; et des dispositifs censés produire ces effets dynamiques au moyen desquels nous engageons notre intentionnalité de soin apportée à la personne. Depuis bien longtemps (depuis ma rencontre avec les travaux de Winnicott dans les années 1980), j'ai choisi la nuance du terme anglais : "to care" = prendre soin pour situer clairement ma praxis expressionnelle; de la privilégier par rapport à l'autre acception - "to cure" qui est la version médicale du soin en référence à la maladie, à la "maladie psychique" qui constitue le credo du DMS 4.
@
Pour avoir moi-même produit beaucoup de théorie dans le domaine de l'Expression Créatrice Analytique, je me suis souvent interrogé sur mes mobiles, et aussi sur cette forme particulière de jouissance qu'il y a à mettre de l'ordre dans les phénomènes et à élaborer des hypothèses explicatives qui rendent compte de leur fonctionnement.
Ma réponse à cette curiosité est simple : la jubilation que j'éprouve à écrire sur les processus à l'œuvre dans la relation analytique est pour moi le signe d'un engagement de nature "æsthétique" dans une activité de création. Pour moi élaborer la théorie de mon expérience est acte de création au même titre que mon activité de production poétique, sculpturale ou picturale. Et elles remplissent la même fonction d'objet intermédiaire entre mon expérience intime et la négociation avec mon environnement social. Mon effort d'écriture et d'élaboration sert doublement à m'éprouver moi-même dans l'écoute de l'autre et à asseoir mon identité dans le champ social. Je crois qu'il en est de même pour tous les théoriciens.
Ce dont je prends en outre de mieux en mieux conscience aujourd'hui c'est que la mise-en-forme théorique est une des manifestations de la vie psychique, un produit psychique. En tant que tel, elle s'articule aux phantasmes originaires du théoricien. Que celui-ci s'appelle Freud ou Winnicott ne change rien à l'affaire ; son élaboration est inéluctablement subjective, à la mesure des impulsions phantasmatiques qui en sont à l'origine ; le problème épistémologique que cela pose restant de comprendre comment un manifeste de la subjectivité est capable de rendre compte des lois du fonctionnement de la subjectivité.
Si l'on accepte de considérer le problème sous cet angle, la question reste pour le théoricien de pouvoir rendre compte, au travers de la théorie, c'est-à-dire de l'explication que nous donnons du fonctionnement des phénomènes et des structures de notre praxis, du fonctionnement de la réalité. Il semble utile que la théorie soit créatrice plutôt que délirante (est-elle jamais autrement que délirante?) ; qu'elle soit référée à une épreuve de réalité plutôt que soumise aux surinvestissements projectifs du théoricien. Si, comme l'exprime judicieusement Winnicott "ce qui est objectivement perçu est, jusqu'à un certain point subjectivement conçu", c'est bien dans la dialectique de la confrontation phantasme/réalité que l'élaboration théorique joue ses scénarios
L'élaboration théorique est en partie destinée à soulager la pression inconsciente des phantasmes originaires. C'est probablement et paradoxalement grâce à cela qu'elle possède le ressort décisif qui permettra de rendre compte du fonctionnement des phénomènes psychiques. Autrement dit, c'est au travers de sa propre économie libidinale que le théoricien a accès au travail de la formulation. Cela suppose chez lui une capacité d'investissement libidinal de son propre fonctionnement psychique articulé à son activité de pensée. Tout comme l'œuvre d'art, la théorie advient au point d'articulation de l'imaginaire et du symbolique : c'est un processus narcissique.
Ce qui est susceptible de faire problème dans ce mouvement, et l'enrayer en tant que processus créateur, c'est la fixation perverse sur le processus narcissique lui-même. Cela a immanquablement pour effet de dériver l'énergie affective sur des voies de garage para-délirantes, et de refermer l'écluse entre la capacité imageante et son intégration symbolique. Cela refermerait l'activité psychique sur des modalités schizoïdes ou obsessionnelles. Pour rompre cette inclination, il y faut du miroir. Il y faut une instance réfléchissante, un lieu analyseur susceptible de permettre d'articuler l'énonciation théorique à ses racines phantasmatiques.
Autrement dit : l'exercice théorique, qui trouve son combustible dans la pression persécutrice originaire (et notamment dans le phantasme d'omnipotence) joue paradoxalement pour le thérapeute la double fonction d'organisateur psychique de ses phantasmes et de guide fiable pour son engagement dans une praxis référée au réel. C'est là la deuxième fonction de la théorie pour le théoricien comme pour les praticiens engagés dans le métier analytique dont la vocation est déterminé à l'origine par des phantasmes originaires que l'analyste “soigne“ dans le lien qu'il institue avec son client.
La fonction de la théorie pour le praticien joue donc partiellement un rôle d'étayage dans sa relation avec son client. Elle lui permet en particulier de pouvoir agir avec détermination dans les situations crisiques où le place sa communication avec le client. Mais, cette deuxième fonction est ambiguë pour le thérapeute, dans la mesure où elle peut aussi jouer le rôle d'écran, de pare-excitation, face à ses propres émergences pulsionnelles dans le lieu thérapeutique, face aux exigences tyranniques du contre-transfert. Dans ce cas-là, le savoir constitué opère de manière défensive, comme résistance.
Enfin, la théorie que l'on forme, ou à laquelle on adhère, infléchit à la fois notre perception des phénomènes, et les modes d'organisation de notre pratique. Selon la théorie de référence pour laquelle nous optons, nous n'agirons pas de la même façon qu'un autre thérapeute qui travaille avec une autre explication du fonctionnement des processus. L'essentiel, en dernière analyse, étant que nous acceptions de laisser notre théorie au vestiaire pour nous livrer à mains nues au combat singulier avec le non-connu auquel le client nous invite. Car le lieu du réel, pour la théorie, c'est dans l'expérience clinique elle-même qu'il nous est donné.
D'UNE THEORIE
"SUFFISAMMENT BONNE"
Parler à l'ombre de Winnicott d'une théorie "suffisamment bonne" signifie pour moi que la théorisation ne doit être ni au-delà, ni en-deçà de ses potentialités à rendre compte du fonctionnement des phénomènes. Elle doit accepter de laisser l'impulsion inquisitrice en suspension devant l'opacité de certaines questions de l'ombre. Mais elle doit aussi rendre compte à minima des connaissances sur le fonc- tionnement réel des processus, clairement assimilées au travers du savoir constitué.
Entre les émissions psychiques générées par l'affect et le fonctionnement de la pensée actuelle, le "Je" - instance percevante - est pris dans un processus dialectique entre imaginaire et réel. Et, à ce niveau, si je puis me permettre, il en va de l'élaboration psychique dans le travail de la théorie, comme dans la formation de la psyché du nourrisson : à un moment donné il faudra que le théoricien renonce à la compulsion qui vise à la maîtrise omnipotente de l'objet pour se soumettre à l'angoisse du vide où peut seulement se former une pensée nouvelle liée aux exigences de la réalité actuelle . A cet égard, l'attitude intellectuelle de Winnicott ici invoquée est exemplaire.
DE LA NÉCESSITE D'UNE
THÉORIE DE L'AFFECTIVITÉ
A mon sens, l'exercice du travail analytique exige du praticien une représentation claire des lois de la formation et de la dynamique de la vie psychique. Il a besoin pour cela d'une théorie du développement affectif qui rende compte, autant que faire se peut, des déterminants de la fonction psychique dans ses rapports avec l'organisme global : d'une part avec la fonction somatique ; d'autre part avec la fonction de la pensée ; enfin avec les déterminants environnementaux. Une telle théorie doit donc s'articuler autour de trois matrices :
- la matrice neuro-biologique, nourrie des travaux sur la physiologie corticale dans le domaine des apprentissages et de la mémoire [3], ainsi que des recherches éthologiques sur les compétences comportementales innées des bébés et des jeunes enfants. C'est dans cette aire que s'élabore la compréhension des phénomènes pulsionnels.
- La matrice psycho-affective, pour laquelle la psychanalyse reste un cadre théorique majeur, et pour l'étude de laquelle il existe une place pour des approches théoriques non-psychanalytiques. C'est dans cette matrice que peuvent se mettre en représentations les questions concernant la façon dont les expériences de douleur et de satisfaction primitives configurent le rapport à la jouissance et à la souffrance affectives qui sont fondateurs de l'économie du Désir. Le Désir est la modalité affective terminale à laquelle accède le sujet face à ses enjeux pulsionnels. C'est dans cette aire que l'on peut travailler à tenter de comprendre la scénographie f(ph)antasmatique.
- La matrice psycho-sociale enfin, qui tente de cerner la question des facteurs environnementaux et de leur influence hautement significative à la fois dans l'organisation psycho-affective endogène, et dans la gestion des investissements objectaux dans la réalité.
La réticence ou le rejet de l'un ou l'autre de ces trois pôles - neurobiologique, psycho-affectif et psycho-social - par le théoricien, signe la présence d'une résistance épistémologique que l'on est fondé à mettre en relation avec des phantasmes non reconnus par le praticien (ou inavouables) :
- Le désaveu des facteurs neuro-biologiques renvoie probablement à des résistances à l'immersion dans la problématique de la régression affective.
- La dénonciation ou la mésestimation des facteurs psycho-affectifs (comme cela est le cas dans les théories comportementalistes) renvoie probablement à de puissantes résistances à l'immersion dans la sphère phantasmatique originaire.
- Le désaveu des facteurs environnementaux renvoie probablement à un déni du rôle des imagos parentales dans la constitution des fantasmes de la sphère œdipienne et des incidences que cela aurait sur la pratique thérapeutique elle-même, notamment par rapport à la problématique de la communication contre-transférentielle.
DE LA QUESTION DES PHANTASMES
Il ressort, en ce point de mon exposé, que c'est la question de la formation des phantasmes qui vient au devant de la scène. Cela est lié, je pense, à ce qui se dessine pour moi avec de plus en plus de netteté dans mon travail clinique de psychothérapeute.
Je me suis aperçu au travers du livre de Piera Aulagnier (dans "La violence de l'interprétation") que j'avais jusqu'alors commis un contresens sur le qualificatif "originaire" associé au vocable de "fantasme". Il n'y avait probablement pas de hasard dans la persistance de ce point-aveugle. J'avais des circonstances atténuantes à cette "cécité" théorique.
Ce à quoi je résistais, à juste titre je crois, c'était à cette idée saugrenue de Freud (d'un point de vue neuro-biologique) d'une transmission phylogénétique de fantasmes-archétypes qui seraient la trace résiduelle du passé socio-familial de l'humanité. J'en étais naïvement resté au catéchisme de Laplanche/Pontalis qui écrivent ceci dans le "Vocabulaire de la psychanalyse" : (les fantasmes) " appelleraient une explication phylogénétique où la réalité retrouverait son droit : la castration, par exemple, aurait été effectivement pratiquée dans le passé archaïque de l'humanité "... Ce qui aurait été réalité dans la préhistoire serait devenu réalité dans la constitution psychique ! J'en étais resté là, au niveau du tour de passe-passe chromosomique. Et je protestais. Aujourd'hui je trouve cela tellement anecdotique et imbécile, comme beaucoup de digressions socio-psychologiques commises par Freud et relayés comme articles de foi par ses épigones.
Je protestais aussi sur la circonscription freudienne des fantasmes originaires à l'organisation œdipienne : " scène originaire ", "castration", "séduction". Depuis le début, mon observation clinique, tant comme thérapeute que comme animateur d'Ateliers d'Expression, me renvoyait à des configurations phantasmatiques beaucoup plus archaïques. Cela me rangeait, de facto, dans les rangs Kleiniens. Dans ma conception, les phantasmes campaient sur les rivages péri-nataux : "fusion", "persécution", "incorporation/dévoration", "clivage", "omnipotence". Et ma théorisation s'orientait naturellement vers la distinction de phantasmes originaires à partir desquels se forment les fantasmes primaires de la sphère oedipienne et de l'activité fantasmatique consciente adulte.
Je vois donc aujourd'hui la question des f(ph)antasmes de la façon suivante :
- La formation des phantasmes (ph) est bien originaire en ce sens qu'elle est le terreau constituant de la vie psychique. L'universalité de leurs formes est liée à la structure neuro-biologique qui singularise l'animal humain par rapport à l'animal non-humain, c'est-à-dire par le développement du néo-cortex et du cortex préfrontal (responsable des processus d'inhibition de l'action, de rétention de la motilité) et du cortex associatif, déterminant dans les processus imaginaires et dans la fonction de symbolisation. C'est l'identité commune universelle des processus de la relation originelle au monde et la communauté structurale de l'organisation corticale de l'espèce qui constituent le fond narratif universel de l'activité psychique que l'on appelle phantasme.
- L'idée d'une trace d'événements préhistoriques progressivement inscrite dans la chaîne génétique ou culturelle est une absurdité. Le bébé humain forme dès sa venue au monde (probablement déjà dans l'univers placentaire) une activité "phantasmatique" en accompagnement de son activité instinctuelle. Ceci est indiscutable. La vie psychique qui en est issue se déploie en liaison avec la désadaptation de la motilité instinctuelle.
- S'il y a bien corrélation entre l'inhibition de l'action et la formation de la vie psychique, cela ne justifie en rien la renonciation, culturelle, au primat de la résolution motrice des pulsions, comme Freud le donne à entendre dans son "Malaise dans la civilisation". Cela ne justifie en aucune façon qu'il faille renoncer à l'exercice instinctuel qui devra trouver, dans ses nouveaux équipements corticaux, une façon différente d'en exprimer les potentialités. Cette tentation d'une morale de la renonciation au primat instinctuel/pulsionnel procède plutôt des effets d'un fantasme de castration non résolu que d'une nécessité de civilisation.
- Le destin des phantasmes originaires inhérents à l'expérience affective du nouveau né de persécution, d' incorporation/ dévoration et d'omnipotence restent, quant à leur configuration et à leur intensité et à leur possible dissolution, dépendants des réponses de l'environnement néo-natal.
- Les phantasmes originaires constituent la matrice narrative des fantasmes primaires relatifs aux théories infantiles de la sexualité (scène primitive, castration, séduction). Ceux-ci sont par ailleurs infléchis de façon significative par des facteurs culturels, notamment par les normes régissant les rapports corporels au sein de la cellule familiale primitive et leur organisation culturelle. Les fantasmes primaires sont des élaborations psychiques alors que les phantasmes originaires sont des productions somato-psychiques spontanées de nature hallucinatoire. Les fantasmes primaires prennent partiellement appui sur la perception du monde objectal alors que les phantasmes originaires sont produits dans un état d'indifférenciation objectale .
- La dernière hypothèse qui vient en incidence de mon expérience clinique, c'est que les f(ph)antasmes, qu'ils soient originaires ou primaires, ne sont pas, comme l'énonce la théorie psycho-analytique, sous la loi de l'amnésie. Mon expérience thérapeutique, abondamment fournie en mnésies (les traces des expériences affectives et émotionnelles originaires) et en phantasmes corporels, me le prouve de façon indiscutable.
Je propose de comprendre la question de l'amnésie originelle dans la situation et dans la théorie psycho-analytique comme liée à une inadéquation des procédures de la mobilisation des mnésies par la technique psychanalytique. Puisque l'observation montre que les mnésies originelles sont rebelles à l'injonction associative, cela veut dire que le processus associatif tel qu'il est proposé dans la cure psycho-analytique, est inadéquat à permettre la connexion du phantasme originaire aux mnésies qu'il représente, et avec l'opération de la perception que l'on nomme prise de conscience . Il est inadéquat, parce que ce niveau des mnésies n'existe ni dans l'aire de représentation psychique, ni dans l'aire de la pensée-en-mots. Il existe seulement dans le phantasme. C'est là le sens de la remarque de Pontalis (introduction du livre de Winnicott "Jeu et réalité") selon laquelle "quelque chose a eu lieu qui n'a pas de lieu". Ce quelque chose a laissé une trace - la mnésie, qui n'est pas un souvenir - qui n'avait pas d'aire de représentation à sa disposition pour articuler une pensée mémorisable, tout simplement parce que la fonction de représentation est une acquisition relativement tardive du développement du petit humain.
Ce que doit offrir le cadre analytique/thérapeutique, c'est précisément de procurer au sujet ce lieu adéquat où le phantasme originaire et les mnésies corporelles vont pouvoir s'élaborer dans le jeu de leurs rapports rendu possible dans l'expression æsthétique des affects. Cela revient à dire que le phantasme originaire constitue la première modalité de représentation des mnésies non représentables psychiquement, par absence du dispositif fonctionnel de la représentation psychique. Le phantasme est une production narrative originaire inscrite à la frontière du somatique et de la fonction psychique. C'est en cela qu'il constitue la matrice de la formation du corpus psychique (les "enveloppes pré-narratives" décrites par David Stern [4]).
Il est donc nécessaire, pour travailler à ces niveaux dans le cadre analytique/thérapeutique, de trouver des modalités d'expression, de communication et de relation qui favorisent la connexion du phantasme aux mnésies qui en constituent la matrice. Cela veut dire que l'analyste, pour pouvoir travailler dans les zones originaires de l'expérience, va être mis en demeure de sortir des positions rigides de la neutralité, de l'abstinence du contact et de la rétention du contre-transfert. Ce qui s'articule de la psyché au corps ne peut être re-évoqué si le thérapeute n'accepte pas d'aller au corps. En quelque sorte, la position analytique doit faire offre au transfert de pouvoir se jouer et se déployer sur les lieux originaires de la formation des mnésies et des phantasmes qui en rendent compte.
L'ATELIER D'EXPRESSION
COMME AIRE POTENTIELLE
Si mon hypothèse concernant l'articulation du phantasme aux mnésies originaires est fondée (elle est d'évidence fondée pour moi dans mon expérience clinique), la réflexion méthodologique sur les modalités de mobilisation du phantasme et des mnésies originaires mettra l'accent sur les moyens favorisant leur mise-en-représentation. Puisque, dans un premier temps elle n'est pas élaborable psychiquement, elle devra être mise-en-œuvre au niveau où elle se situe, c'est-à-dire au niveau de l'expression corporelle médiate (langagière) ou non-médiate (affective).
Cela veut dire implicitement que le processus expressif est un phénomène distinct du processus d'élaboration psychique dont il conditionne la formation. Le processus d'expression créatrice est dicté à la fois par des déterminants mnésiques (affectifs) et par des formations psychiques ou par des agrégats psychiques.
L'aboutissement, dans une théorie de la praxis, de cette théorie des articulations entre mnésies originaires et représentation, peut être formulé autour du concept de "mise-en-œuvre" (la "gestaltung" de Prinzhorn). L'œuvre, en tant qu'elle exige l'agir corporel pour s'incarner et faire trace, peut être engagée dans le processus associatif créateur, dans le jeu (Winnicott), dans l'œuvre créatrice, ou, comme cela est le cas avec des personnes profondément régressées, dans la symbolisation corporelle .
Dans mon expérience clinique, à partir du cadre que j'ai institué autour du concept d'Expression CréatriceAnalytique c'est précisément de la création (de la "mise-en-forme") d'une "aire intermédiaire" entre mnésie corporelle et phantasme qu'il est question. D'un lieu où puisse se mettre en scène ce qui n'avait pas de lieu approprié de représentation, et qui était resté en l'état originaire, en termes de forclusion, dans le développement ultérieur du sujet.
Mon vieux projet d'élaborer une psychothérapie "transitionnelle" (termes que j'avais créé en 1983 bien avant d'avoir connaissance de son utilisation par Didier Anzieu) s'inscrivait au cœur même de la théorie Winnicottienne en ce sens que l'espace de travail analytique que je proposais visait à fournir au client la possibilité de constituer, entre lui et moi, des "objets" (des " surfaces objectales") propres à représenter "transitivement" les moments de l'articulation entre l'expérience phantasmatique (et les mnésies dont elle rend compte) et celui de l'élaboration psychique qui assure à terme la permanence des objets dans l'expérience subjective . Lorsque cela fonctionne ainsi, je permets au sujet de se constituer un "patrimoine psychique", et donc, de pouvoir accéder à un réel travail d'analyse qui se trouvait jusque là littéralement sans objet" et non-avenu.
Dans mon travail de thérapeute, jusqu'à aujourd'hui ce que j'ai dans le fond permis à mes clients, c'est de se constituer une histoire analysable (avec moi, ou avec un autre analyste). Je pense à posteriori que ces personnes (psychotiques et borderline) n'auraient pas su utiliser un cadre psycho-analytique classique. Je fais en outre l'hypothèse que pour les personnes névrotiques dont la névrose prend ses racines dans les couches archaïques de la formation de la personnalité, le dispositif transitionnel est également opératoire.
Lorsque j'utilise, à propos de visée thérapeutique, le concept d'Expression créatrice, c'est donc dans cette radicalité opératoire organisée autour du travail d'articulation entre mnésies, phantasmes originaires et représentation. C'est aussi à partir de cette exigence que je m'autorise à dénoncer des pratiques arthopédiques qui édulcorent tout ce que la pratique expressionnelle contient précisément d'analytique (de psychothérapeutique), parce qu'elle fonctionne, dans ses effets de vérité, comme analyseur des pressions anti-thérapeutiques et des chronicisations défensives des institutions de soin.
D'UNE THEORIE "CONCLUANTE"
En dernier ressort que ce soit au travers des identifications intempestives qu'elle génère chez les "adeptes" incomplètement analysés, que ce soit dans la jubilation omnipotente de la création, les fascinations de la théorie sont irrémédiablement inscrites dans l'ambiguïté. Le thérapeute, qui est d'abord un clinicien, est à leur égard aux prises avec des impulsions contradictoires. La soumission passive aux diktats d'une théorie ne peut produire qu'un fonctionnement stéréotypé, et ne générer dans l'espace de séance que les événements attendus et fantasmatiquement maîtrisés par le thérapeute.
Par ailleurs, la mise à l'index du savoir constitué n'est que le reflet d'une contre-dépendance rebelle qui prétend n'être redevable en rien d'un corps constitué de connaissances qui ont fait leurs preuves.
Dans ces deux tensions à l'égard de la théorie jouent de puissantes défenses dont la fonction est de conjurer les émergences angoissantes susceptibles de se manifester dans l'aventure singulière de la relation intertransférentielle.
Aussi n'est-ce ni dans le fonctionnement de la théorie comme tutelle, ni dans une ségrégation bornée à son égard, que l'analyste/thérapeute peut placer ses enjeux personnels. Dans un texte particulièrement critique à l'égard des thérapies "dites d'Expression" (colloque IRAE, "Expressions, Symptômes, Créations" 1984) Jean Marie Robine - alors compagnon de route - dénonçait ce qu'il jugeait être les incohérences dont il créditait à l'époque la pratique expressionnelle (dont j'étais le fer de lance) de son point de vue électif de Gestalt/thérapeute. Il écrivait en substance ceci :" Lorsqu'on veut situer une pratique d'Expression dans le champ de la psychothérapie il convient de construire un modèle opératoire qui soit cohérent en regard de ce que nous savons du processus psychothérapique ". L'intention était louable, mais elle ne rendait pas compte du fonctionnement de ses propres savoir comme jeu de croyances, ni de la supercherie inconsciente qui consiste à analyser des phénomènes étrangers à son propre espace de représentation théorique/praxique du point de vue exclusif de sa propre théorie de référence.
Ce que je veux dire concrètement par là, c'est que les théories servent souvent d'écran défensif pour récuser l'existence d'un champ d'expérience et d'une dynamique structurante qui leur est hétérogène. Par exemple, la théorie de la Gestalt que m'opposait alors Robine, considère à priori le processus expressif non comme un phénomène non-médiat, mais "comme une médiation qui empêche la présence immédiate du sens" [5]. De même, pour lui, la fonction expressive est une "fonction/contact", posée comme événement qui fait sens dans la relation à l'environnement et non comme un phénomène constituant de l'idéïté et de l'identité comme je le pense. Pour lui, " la démarche dite d'Expression, c'est-à-dire de découvrement, en réalité recouvre. Au lieu de favoriser la croissance du sujet, elle favorise l'élaboration d'excroissances, c'est-à-dire d'un donné-à-voir qui cache, c'est-à-dire d'un symptôme "[6]. Nous sommes là dans une pseudo-analyse exemplaire, où la théorie fonctionne comme idéologie recouvrante. Dés l'instant où est posée à priori dans la théorie l'idée que le fait expressif est, par nature, symptôme, Robine et sa meute se considèrent exemptés d'en faire une autre lecture, la mienne par exemple, qui ai mis en lumière dans mon expérience clinique que c'est contre l'expérience expressive elle-même que les clients avec lesquels je travaille dressent une symptomatologie riche et aiguë, dictée par le transfert, qui, justement, n'est pas expression (mais qui peut en déclencher le flux).
Donc, si je suis bien d'accord pour construire un modèle opératoire cohérent, ce n'est pas à partir de ce qu'énonce la théorie de la gestalt-thérapie ou de toute autre théorie (qui sont propres à rendre compte surtout des phénomènes circonscrits à leur propre champ opératoire et aux phantasmes qui le constituent), mais à partir d'une phénoménologie articulée à mon propre cadre, aux intuitions et aux prises de risque où m'a conduit mon exercice d'analyste/thérapeute et de formateur. Cela ne veut pas dire que je récuse tout savoir constitué, mais seulement, que j'accorde une importance centrale au savoir construit dans la situation thérapeutique singulière que j'ai élaborée. Pour moi, le savoir sur le processus thérapeutique est celui que nous faisons advenir, mon client et moi. Celui-là est un savoir singulier, signifiant, que je peux soumettre ensuite à l'épreuve des savoirs constitués et reconnaître ainsi que j'appartiens à une famille (Rogers, Winnicott, Searles).
Pour moi, si les termes de théorie scientifique peuvent être appliqués au champ de la psychothérapie, c'est avant tout grâce à la rupture avec les savoirs constitués que cela est possible : en aval et non en amont de l'expérience, puisque, de toute façon, quels que soient les itinéraires d'accès choisis, ils reposent toujours à l'origine sur un choix phantasmatique non-conscient
L'acte créateur est précisément ce qui advient lorsque le sujet accepte la destruction de la psyché résiduelle qui l'imprègne, dont les théories sont les leurres.
[1] "La guerre de 100 ans" Roudinesco.
[2] "Histoire de la psychanalyse en France" et "LACAN"
[3] Ceci n'est en aucune façon une marque d'allégeance envers le "cognitivisme" et son âne bâté le "comportementalisme". Les science cognitives , sciences des processus de la connaissance, constituent une approche incontournable en tant qu'elles étudient les relations existant entre le fonctionnement des structures nerveuses dans leur rapport à la mémoire et au langage, au sommeil et à la vigilance, au système émotionnel.
[4] N° 14 de la revue de"La psychanalyse de l'enfant" Colloque de Monaco consacré à "La naissance de la pensée"
[5] Dans le n° 43 de la revue "Thérapie-psycho-motrice", 1979, intitulé "Expression, liberté d'impression" que notre équipe de l'IRAE avait composé en commun.
[6] Ce qui ne l'a pas empêché en Janvier 2006 d'organiser à Bordeaux un congrès européens de gestalt thérapeutes centré sur l'expression créatrice.
Le péché originaire (Honoré Grissë)
Le péché originaire (Honoré Grissë)
sur la fondation du concept et de la pratique de
L'EXPRESSION CREATRICE ANALYTIQUE
Entretien conduit par Honoré Grissë
présenté au congrès annuel de l'Association
THERAPIE PSYCHO-MOTRICE
Juan les Pins Juin 1993
Repris et enrichi à l'occasion des rencontres annuelles
de l'Association d'Analyse Psycho-Organique
Toulouse 1994
Avertissement
Ce texte a été créé pour les journées nationales de la revue "Thérapie Psycho-Motrice en 1993. Il a été remanié pour le congrés de l'Association Française d'Analyse Psycho-Organique (1994) , à la suite de l'invitation qui m'a été faite par Claire Weill et Pierre Carasso de venir parler de mon expérience clinique d'analyste auprès des psychothérapeutes praticiens de cette école.
J'ai accepté de m'exprimer sans réserve , parce que j'ai l'intime conviction du caractère opératoire d'une démarche a-typique dans laquelle j'ai été entraîné avec mon plein consentement, et avec le taux élevé d'inconscience nécessaire à toute personne qui met les pieds dans la gamelle analytique.
Après réflexion, j'ai jugé qu'il était difficile de livrer des éléments concrets de mon expérience sans fournir à mes auditeurs un ensemble de matériaux qui pourraient éclairer, initier ou prolonger une réflexion sur ma théorie de ces phénomènes concernant la croissance affective et émotionnelle au sein de la relation analytique/thérapeutique telle que je la mets en travail aujourd'hui. Et notamment par rapport à cette question fondamentale de ce qui lie la communication corporelle entre client et thérapeute.
Cette réflexion, circonstancielle est probablement sujette à discussion. Elle est la théorie de mon expérience, le fruit d'une praxis déjà confrontée à la critique intérieure et au débat.
Ces pensées, ces analyses constituent, au fond, la matrice psychique et affective de mon engagement comme analyste. Je suis préoccupé - c'est la moindre des choses - par une somme de questions au sujet de la mémoire, du rêve, de la compréhension des processus intertransferentiels dans une autre optique que celle de la psycho-analyse freudienne. J'ai commis une transgression irréversible envers l'autorité tutellaire. J'ai commis le péché originaire qui a été d'accepter, sous la nécessité où je me suis trouvé placé, d'engager avec mes clients une communication au corps à corps qui n'a par ailleurs rien à voir avec la recherche d'une satisfaction érotique, ni avec des modalités de contacts instrumentalisantes, avec des techniques du toucher ou de la provocation émotionnelle telles qu'elles se sont développées dans les années 80 sous l'influence de la bio-énergie reichienne, de la gestalt-thérapie et de leurs dérives d'obédience comportementaliste regroupées pêle-mêle à l'époque sous le vocable de psychologie humaniste, qui constituait un univers réactionnel à l'hégémonie et la pression culturelle de conformité qu'exerçaient les psychanalystes à l'apogée de leurs querelles de pouvoir.
Mes provisions de voyage, ce sont Carl Rogers, matiné de Winnicott, de Mélanie Klein et de leurs géniture (Searles, Tustin). Ma phase initiatique, ce fut Max Pagès, la dynamique de groupe, et l'expérience esthétique nourrie au surréalisme. Ça me suffit. Actuellement, je me mets à lire Freud, ce que je n'avais jamais fait depuis ma naissance, et Lacan. Cela me paraît riche et utile.
Mon point de mire, il semble que ce soient ce que l'on appelle les états limites, que je préfère pour ma part appeler personnalités de bordure. De tout ceci, il sera concrètement question dans mon exposé. Pour l'instant, je vous propose de regarder cet entretien que j'ai eu , pour la circonstance, avec un ami très proche.
MONTETON le 1° Mai 1994
@
LE PÉCHÉ ORIGINAIRE
sur la fondation du concept et de la pratique de
L'EXPRESSION CREATRICE ANALYTIQUE
Entretien conduit par Honoré Grissë
Honoré Grissë
En manière d'introduction à ces entretiens, je voudrais reévoquer le film que vous avez présenté pour l'ouverture officielle du Congrès de Thérapie Psychomotrice consacré à : "L'IMAGE DU CORPS" ( Juan-les-pins, 1993).
Ces œuvres, suscitées dans vos Ateliers d'Expression Créatrice, sont, dans leur nudité et dans la force de leur expression, d'une grande intensité dramatique et d'une rare qualité esthésique. La confluence de cette pictographie avec votre propre œuvre artistique est étonnante. Cela m'a poussé à réexaminer les thèses que vous défendez dans l'édition de 1988 de votre ouvrage : "DE L'AFFECT A LA REPRESENTATION : L'ART CRU.
Dans sa préface de 1988 à votre livre, le Dr Jean Broustra dit de vous que vous êtes "un créateur qui a rencontré la psychothérapie". N'y a-t-il pas un certain déchirement entre ces modalités de votre expression, comme créateur, comme analyste, comme psychologue plasticien, comme formateur et comme théoricien ? Comment avez-vous pu, pouvez-vous intégrer ces multiples activités : écriture, sculpture, modelage, céramique, dessin, peinture, composition théâtrale, interprétation et mise en scène, formation, édition, et, pour finir, vous exercez la fonction de thérapeute !..
Guy Lafargue
Cette manière dont vous dites les choses les choses peut donner l'illusion d'une conduite frontale de toutes ces activités. Ce n'est bien entendu pas le cas. Aujourd'hui je peux mobiliser toutes ces ressources de création selon mes besoins ou selon l'opportunité des provocations individuelles ou sociales qui s'ouvrent à moi. J'en conduis tout de même plusieurs simultanément : la formation, le travail analytique , la sculpture, l'écriture...ma vie quotidienne, mon environnement vital.
C'est vrai que nous sommes habitués par le pilonnage des médias, dans la vie culturelle comme dans la vie professionnelle, à rencontrer des ergumènes qui sont entraînés à ne faire qu'une seule chose, et de préférence sur un mode de compétition, d'exhibitionnisme et de collusion sociale poussés aux limites des capacités de la mécanique. Ça donne des robots, des technos, des gens qui ne sont que peintre, ou que footballeurs, ou que psy, ou que n'importe quoi d'hypertrophié d'un organe et d'atrophié du reste de leurs ressources créatrices. Et, en face de ces mirages, des consommateurs bâillonnés dans une illusion qui les oblige à subir l'expérience relationnelle et culturelle de façon passive. Moi, je n'ai jamais réussi à stationner dans cette ornière. J'ai pris le parti de travailler à être un vivant entier, capable de jouir de ses dix doigts et de son cortex, et de jouir aussi de ses autres organes.
Je crois que ce que dit Jean Broustra est juste. Cette image unifiée et prévalente de créateur qu'il désigne chez moi rend compte de la pluralité des langages de mon expression personnelle et sociale. A cette nuance près qu'être "créateur" n'est pas un état, mais le fruit d'un engagement tenace et permanent d'énergie et d'indépendance. Ceci n'est pas donné au départ. C'est quelque chose qui se conquiert de haute lutte contre la toute-puissante normativité institutionnelle.
En fait, je crois que je suis simplement devenu quelqu'un : dans mon existence, dans ma création, et dans mon art. Quant à l'exercice du travail analytique et de la thérapie, c'est quelque chose qui a surgi dans mon existence sans que j'y ai été rationnellement préparé par une formation universitaire (bien indigente sur ces plans essentiels), très abstraite, très prothétique, et tellement éloignée de toute préoccupation expérientielle. Je suis devenu un analyste singulier au prix de beaucoup d'angoisse, de souffrance, de joie, d'amour et de haine, qui sont les outils affectifs avec lesquels je travaille comme analyste / thérapeute. Ce que je ressens, c'est que la tension créatrice innerve tous les actes essentiels de mon existence. J'ai le sentiment que ma vie est faite d'actes essentiels. Quasiment en permanence. Et je passe de l'un à l'autre de mes langages selon mes besoins ou selon la nécessité où je me trouve placé par les effets de mes actes, dont je peux dire que je me sens réellement l'auteur. Pour moi, la création, c'est le manifeste du vivant. Être créateur, c'est parler en son nom propre avec une Parole pleine.
De l'originaire
Honoré Grissë
Dans sa préface, Jean Broustra évoquait également votre prédilection pour ce territoire problématique de la formation de la vie. Il dit ceci, que je cite:
- "La passion personnelle de l'auteur vise ce qui serait la meilleure élucidation possible de l'archaïque infantile. C'est-à-dire les traces (posons provisoirement ce terme vague) laissées au profond de nous-mêmes par nos premiers investissements, dès le moment où nous sommes biologiquement vivants. Guy Lafargue est à l'affût de tout ce qui a suscité des recherches dans cette période nommée "péri-natale". Cet intérêt s'appuie évidemment sur l'hypothèse qu'il s'agit d'une zone à haut risque qui serait la matrice, soit de la création (et de ses risques), soit de la maladie mentale".
Guy Lafargue
Cette perception que Jean Broustra donnait de moi, il la fondait sur vingt ans d'une pratique d'amitié professionnelle que je n'hésitais pas à mettre à l'épreuve, parce que je ne formais pas ma pensée comme il l'aurait souhaité par voie d'école ou d'identification, mais plutôt par voie intuitive, réactive et poétique, en prise directe sur l'expérience dont je prenais le risque, souvent dans la mise en tension d'une critique amicale certes, mais non dénuée de rivalité.
Pour ma part, je ne sens pas un homme passionnel. Je me sens plutôt comme un homme déterminé dans l'itinéraire que j'ai choisi de suivre, et cohérent avec un idéal très concret qui a été soumis à l'épreuve de la lutte, de l'échec, de la solitude et de satisfactions éblouissantes. Par contre, dans le territoire spécifique qu'il m'attribue – de ion analytique, la vie archaïque des humains où se forme le Désir vivant - je me sens bien "chasseur". Cet affût, et les rencontres fauves que j'y nourris, impliquent toute mon existence; et pas seulement mon intérêt pour les recherches théoriques et cliniques autour de la naissance, qui reste pour moi beaucoup plus un point de curiosité (peut-être aussi de souffrance affective résiduelle), qu'une vraie passion.
Par contre, ce qui mobilise avec acuité la totalité de mon énergie et de ma recherche intellectuelle, c'est la situation maïeutique où je me trouve placé dans mon travail avec les hommes et les femmes qui viennent dans mes Ateliers vivre l'expérience significative de l'Expression Créatrice; et les changements de plans qui opèrent chez une personne en train de s'abandonner ou de résister à la pulsion créatrice. C'est cette espèce de glissade sur la planche du Réel, dans un plan d'expérience ignoré du sujet (et imprévisible) qui s'appelle l'Archaïque... qui constitue le cœur de ma fascination. Cette translation est génératrice d'une grande luxuriance æsthétique, et d'une générosité sans limite dans l'exploration structurante des images du corps.
Il semble que cette zone de la vie affective originaire, particulièrement angoissante et problématique pour d'autres, est mon lieu privilégié d'investissement. Probablement que je trouve dans ces lieux illimités de la jouissance et de la souffrance de l'@utre une liberté paradoxalement pacificatrice et structurante pour moi.
Pourtant, comme cela apparaît avec une certaine violence dans le film que j'ai présenté, les lieux de l'Originaire sont habités de monstres dangereux et de souffrances affectives non symbolisées, donc non ressenties. Je le sais, pas seulement par ouï-dire, mais parce que j'ai fait l'expérience personnelle de la mise en œuvre de ce théâtre halluciné des ombres menaçantes, et destructives seulement de n'être pas admises à la représentation. Dans le jeu de la représentation créatrice, les éléments persécuteurs se vident de leur charge affective meurtrière et le Moi du sujet s'élargit de cette nouvelle et constructive expérience.
En ce sens, le travail de la création remplit une partie de la fonction du rêve, mais avec un bénéfice refusé à celui-ci du fait de son asservissement au sommeil. Le rêve n'est pas le gardien du sommeil comme aimait à le dire Freud, il en est le paillasson.
@
La création/le rêve
Le travail de la création accomplit quelque chose que n'accomplit pas le travail du rêve : il suppose l'implication du sujet dans un agir potentiellement porteur de résolution. La création remplit simultanément les trois fonctions : de la formation du rêve, du récit du rêve et de la saisie non-médiate des affects sous-jacents au rêve. L'acte de création suppose l'ouverture de modes de conscience paradoxaux qui existent aussi dans le moment subjectif du rêve nocturne. Mais dans le rêve nocturne le sujet ne peut en tirer un bénéfice immédiat parce que l'expérience de la vigilance y est provisoirement dissoute.
Par rapport au travail du rêve, je pense que l'on doit essentiellement en cadrer la fonction sur le travail de détoxication de l'organe cérébral. On ne peut absolument pas aborder la question du rêve en dehors d'une approche de son substrat neurologique. Physiologiquement, l'activité onirique se déclenche après la mise hors circuit d'un sous-système de l'archéo-cortex appelé système "réticulaire" ( ou encore "système activateur ascendant" ou S.A.A.). C'est cet organe qui créé et soutien l'activité électro-corticale du temps de veille appelée vigilance. L'interruption de son fonctionnement est le déclencheur de la mise en route du travail actif de la détoxication cérébrale que l'on appelle "rêver". Ce système fonctionne un peu comme un téléphone portable qui nécessiterait 8 heures de recharge en K (potassium) pour pouvoir à nouveau soutenir l'activation du système néo-cortical qui inaugure l'état de veille. Le système réticulaire peut être considéré comme une sorte de coupe-circuit qui entraîne l'extinction de la tension cérébrale nommée vigilance et perception; et qui coupe la circulation de l'influx nerveux le long du tronc cérébral et interrompt l'activité musculaire. C'est dans cette suspension que s'ouvre le travail de la purge corticale des stases, des tensions, accumulées dans l'organe cérébral à l'état de veille, dont les rêves sont les produits de décomposition. Le rêve est un sous-produit de la détoxication du cerveau.
La théorie freudienne du rêve est largement obsolète. Freud a créé une théorie psychologique du phénomène du rêve qui, au moment historique où se trouvait la psychiatrie de son époque, a opéré une véritable révolution. Mais, si les formes et scenari oniriques sont bien ce que l'on peut appeler des faits psychiques, l'explication de ce processus en termes psychologiques de "réalisation de désir" ne me paraît pas vraiment défendable aujourd'hui en regard de ce que nous savons d'une part du fonctionnement cérébral, et d'autre part des progrès accomplis par certains continuateurs de la quête freudienne - Winnicott, Mélanie Klein, Searles et bien d'autres - sur la compréhension de l'expérience affective.
Honoré Grissë
Si j'ai bien compris votre position par rapport à la préoccupation originelle qui a fortement orienté le développement de la technique psychanalytique - celle du rêve - vous semblez opérer un déplacement de causalité de l'expérience du rêve et du travail associatif sur l'expérience de l'affect..
Guy Lafargue
Oui. Ce qui travaille pendant l'expérience du sommeil (qui n'est autre que la cessation de cet effort biologique et de cette tension soutenue qu'est la vigilance), se passe dà partir du champ affectif. Une partie seulement des effets en est psychique. Nous avons été conditionnés à nous représenter le sommeil comme une régression, Cela est une vision partiellement anthropomorphique Le sommeil ouvre au contraire à un moment d'intense travail métabolique de reconstitution des ressources biologiques nécessaires à la lutte vigile pour la poursuite de la vie.
Le vivant n'est jamais au repos. Il tend toujours vers la satisfaction des besoins dont le sentiment de repos est un des effets. La notion d'homéostasie est, me semble-t-il, une notion inadéquate à définir la visée de l'action ou de la pulsion, comme le postulait Freud. De tout ce travail du vivant, le rêve est le déchet. Il n'est pas que cela, mais il est tout de même cela. Enfin, c'est mon point de vue.
Honoré Grissë
Toute une partie de la théorie et de la technique de la psychanalyse s'est développée autour de l'analyse des rêves. Vous semblez en faire bien peu de cas !
Guy Lafargue
La fascination exercée par le rêve sur Freud est saisissante. Mais lorsque je lis la "Traumdeutung", je ne peux m'empêcher de constater qu'il y a quelque chose qui préoccupait aussi beaucoup Freud, qui était sa carrière universitaire, son grand et angoissant souci d'être reconnu, et porté au sommet du cénacle de l'Académie C'est incroyable le nombre de rêves d'honorabilité, d'ambition, et de déni de culpabilité, qu'il nous livre avec une candeur bien étrange, et certains dénis d'interprétation auxquels il se livre.... Et ensuite, la fascination narcissique exercée par sa propre activité créatrice, comme tout créateur....
Ce que je découvre et retiens de cette pensée luxuriante, c'est que le génie de Freud réside dans cette invention d'un dispositif et d'une stratégie de Parole en rupture avec les modèles culturels de l'éducation et de la médecine ; et dans la transgression qu'il a commise pour engager sa création (effet du Réel) dans la réalité, qui est ce par quoi le fantasme se dissout en tant que tel , pour devenir une œuvre. Mais le processus d'élaboration théorique lui-même (création de la métapsychologie) doit être considéré comme la litière de ce processus d'invention de la scène psychothérapique. Celle-là se développe dans le champ de l'action et non d'abord dans celui de la pensée, qui vient en étayage du Désir.
Un point aveugle de Freud, me semble-t-il, réside dans la distinction des deux plans de la pensée et de la psyché (de la même façon, me semble-t-il, qu'il séparait le phénomène de la conscience de celui de la perception). La pensée est elle-même un processus psychique. Elle ne peut en être distinguée, comme les écrits psychanalytiques le donnent à entendre à profusion. L'élaboration théorique n'est qu'un processus psychique parmi d'autres, destiné à étayer la réalisation du désir dans la réalité.
Pensée et psyché
La théorie a partiellement la même fonction que le rêve, celle d'une rêverie diurne destinée à étayer le sujet contre la culpabilité qu'il éprouve dans l'accomplissement de son désir inconscient dans la réalité, qui est ce par quoi se marque une authentique expérience de création.
J'ai le sentiment qu'il est arrivé à Freud, ce qui arrive à certains moments à tous les créateurs : il franchit un seuil fascinatoire où son propre fonctionnement psychique est investi comme Objet de jouissance. Ce mode de fonctionnement sporadique - narcissique et sublimatoire - qui aliène provisoirement le sujet créateur, est probablement le prix à payer aux autorités tutélaires (tant que celles-ci sont encore actives dans l'expérience affective) pour pouvoir avancer dans l'action. C'est en ce sens que l'on peut admettre le mensonge lexical commis par Lacan dans le Livre II lorsqu'il donne comme traduction étymologique de "théorie" le mot "intuition". Gros LAROUSSE, lui, nous donne pour traduction du mot grec "theorein" le mot français "observer". La théorie comme intuition, c'est de la poétique nourrie par le fonctionnement psychique. En soi, ça ne vaut pas pipette.
La théorie comme praxis de l'observation, c'est de pouvoir regarder avec une inquiétude créatrice les effets de Désir , c'est à dire ce qui se passe dans le Réel dont on a modifié les conditions d'émergence et de représentation.
Dans les faits, le primat du Désir sur la Pensée est au cœur même de l'expérience créatrice. On appelle cela l'invention. Freud est un inventeur. Là où le bât blesse, c'est lorsque l'espace culturel ainsi ouvert est ensuite occupé, pré-occupé par des épigones satisfaits du rôle de fonctionnaires d'un ordre psychique mort, soumis à la répétition du même. Le processus créateur qui est ce par quoi l'action opère, est sinon absent, du moins largement inféodé à la doctrine. Les adeptes travaillent et pensent conformément au modèle. Ça peut avoir des incidences thérapeutiques chez des gens acculturés à ce modèle-là, qui auront le sentiment d'avoir réussi à terminer leur analyse parce qu'il auront incorporé le Moi de leur analyste. Il me semble que c'est un peu cela que jubilait à dire Lacan à ceux qui fréquentaient ses palabres.
Pour en revenir à la théorie comme rêverie, et à la dissociation opérée par Freud entre pensée et activité psychique, je trouve que c'est une bonne méthode critique que d'appliquer au théoricien les arcanes de ses découvertes majeures (qui sont généralement le contrepoint de ses résistances les plus profondes). Tout à sa fébrilité d'inventeur d'une structure pour l'action, il ne prend pas écart de sa propre activité épistémophilique comme processus psychique. Cela a une grande importance pour comprendre pourquoi il a attaché une place aussi importante à l'idée d'analyser les rêves dans l'injonction de la cure analytique.
Mon point de vue c'est que le postulat qui sous-tend la technique de la psycho-analyse des rêves n'est à aucun moment interrogé Ce postulat, c'est celui de la pensée latente du rêve (explicitement articulé à la croyance en l'existence de faits psychiques inconscients), et au terme de la chaîne associative, de l'apparition du Désir, tel le Dragon terrassant Saint Michel. Est-ce que ce postulat sert à quelque chose d'autre qu'à fixer l'attention sur un leurre ? Autant l'analyse des rêves me paraît un outil utile pour l'élaboration d'une psychologie, c'est à dire la reconstitution d'une logique formelle dans le processus de formation des formes psychiques, autant il me paraît discutable de la fixer comme processus central dans la situation de travail thérapeutique.
Le travail thérapeutique va bien au-delà de cette soi-disant révélation du contenu latent du rêve, qui n'est qu'un os jeté au chien. Une question que je pose à toute forme d'analyse est celle de savoir avec quels clients la technique fonctionne. Moi, il me semble que cette place majeure accordée par la psychanalyse à l'analyse des rêves est une résistance manifeste à la confrontation affective directe avec le sujet. La fétichisation du rêve, comme toute fétichisation, vient faire écran à la manifestation de l'affect.
Honoré Grissé
Est-ce à dire que vous évacuez l'ensemble de la science des rêves élaborée par Freud ?
Guy Lafargue
Tout d'abord, je voudrais dire que le livre de Freud que j'ai lu ne s'intitule pas "La science des rêves", mais "L'interprétation des rêves". Ce titre fixe explicitement le propos sur la dimension du maniement du rêve dans l'espace de séance. Et c'est bien sur cette question de l'élection du rêve au rang de facteur analytique essentiel, que portent mes interrogations et mes thèses. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rétablir dans son intégrité la citation de Freud qui ne dit pas que "le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient" comme je l'ai toujours entendu dire, mais bien celle-ci : "l'interprétation du rêve est la voie royale qui permet l'accès à l'inconscient".
Certes, en tant que la question du rêve relève partiellement d'une Psychologie, on doit à Freud une contribution fondamentale. Mais cette contribution est périmée. Quelques formulations de base en sont solides, tirées de l'observation du fonctionnement psychique des analysants, d'autres, tirées de la spéculation, sont devenues entièrement caduques.
Deux raisons essentielles à cela:
- Depuis la mort de Freud les connaissances sur la physiologie du cerveau, dont le rêve est une émission, ont considérablement évolué.
- Freud n'a pas pu analyser le processus du rêve indépendamment de la fascination quasi hypnotique qu'il exerçait sur lui. Je veux dire, qu'il ne se donnait pas le rêve comme objet de connaissance, mais comme moyen d'emprise sur le sujet de l'expérience psycho-analytique, à savoir l'inconscient. Cela crée un point aveugle (ce point de la rétine, non innervé, d'où s'extrait le faisceau de neurones qui transmet l'excitation des terminaisons sensibles au cortex visuel). Ce point métaphorique que Freud appelle lui-même l'ombilic du rêve, est le rejeton des pratiques d'hypnose auquel il renoncera au profit de la transe associative et de l'interprétation, qui est aussi un acte d'influence. Ce qui fascine Freud, c'est le mythe de la puissance curative de la connaissance rationnelle pour laquelle il dresse un lit mythologique. Tout son travail d'élaboration théorique est surdéterminé par ce pouvoir médiumnique qui le fascine, et qui fera de lui ce géant culturel qu'il avait ambitionné d'être.
Honoré Grissë
En quelque sorte, vous poursuivez votre hypothèse selon laquelle l'élaboration théorique n'est pas en amont de la prise de risque dans l'expérience , mais en aval. En contrepoint expérientiel et en étayage ?
Guy Lafargue
Oui. Il en va de la théorie comme du rêve Ce qui est mon propre point d'acuité, c'est de mettre à jour les fondements idéels de l'articulation entre ce que Freud apprend de ses propres rêves et de ceux de ses patients, et la fixation dans une théorie d'un ensemble de suppositions qui en viennent finalement à prendre pour les épigones le statut d'un savoir et d'une croyance; et d'impératifs pour l'action prenant forme dans une technique qui va, très rapidement, se mettre à fonctionner sur un mode ecclésial, à la manière d'un système religieux.
Selon moi, le surinvestissement par Freud de l'analyse des rêves est un des éléments qui a contribué contradictoirement:
- d'une part, à soutenir la transgression que représentait l'invention de la psychanalyse à l'encontre de la science médicale, et ce, au travers de l'engagement d'un nouveau mode de relation thérapeutique désaliéné ;
- et d'autre part, à circonscrire les potentialités formelles inhérentes à l'invention de l'outil analytique dans une forme qui en limitait par avance les potentialités ludiques.
Une vraie question, selon moi, porte sur les déterminants affectifs structurant la théorie freudienne du rêve, et surtout, de la théorisation de la pratique de son maniement, sous-jacents à son énonciation manifeste : son arrière-pensée.
Je suis convaincu qu'il existe une corrélation puissante entre la technique analytique que nous choisissons (où que nous créons) et l'économie affective dont nous préservons les stratégies inconscientes pour ne pas être trop profondément ébranlés par ce que nous déclenchons dans cet espace analytique qui nous expose à de violentes offensives intérieures.
La théorie est un objet psychique dont nous nous servons pour nous étayer dans le passage-à-l'acte initialisateur de la mise en scène thérapeutique. Ceci s'applique, bien entendu, à tous les dispositifs analytiques, y compris au mien.
La démarche de pensée de Freud utilise les structures de pensée de son temps. Et la structure de pensée dominante à son époque, c'est la science en tant que démarche hypothético-déductive pour laquelle il y avait nécessité à trouver une explication rationnelle aux phénomènes dont la compréhension échappait à l'observation. C'est ce que fait Freud en imaginant la première et la deuxième topique. Tout part d'une confusion originelle, de nature syncrétique, comme quoi ce qui se révèle dans le rêve préexiste dans un lieu psychique retranché, qu'il baptise l'inconscient, et sur lequel le siècle va se précipiter comme un seul homme.
Il y a deux sortes de faits psychiques:
- la production d'images, de tous ordres : des images de qualité sensorielle qui constituent à proprement parler l'expérience créatrice corticale, nous pourrions aussi dire mentale; ou bien des images intellectuelles (la pensée elle-même - abstract de l'image sensorielle - devant être considérée comme un production psychique sous-tendue par une intentionnalité résolutoire) qui utilisent les sensations/excitations de la vie diurne affectivement investies.
- et le rappel des évènements psychiques mémorisés : les résidus associatifs et les objets psychiques.
Plus simplement dit, la vie psychique est constituée de fantaisies mentales émergentes (imaginaires) et de souvenirs. La vie psychique procède d'un flux mental constant dès la formation du cortex, dont la fonction est de construire des images en prise avec les mouvements affectifs dont ils sont la représentation.
L'expérience psychique
La fonction psychique (fonction de formation d'images), opère comme une sorte de complexe télévisuel. Dans l'expérience psychique routinière comme dans l'expérience psychique inventive, l'émetteur psychique diffuse tantôt des synthèses de formes nouvelles (créations) en prise directe sur l'actualité affective du monde, et tantôt il puise dans la banque d'images résiduelles mémorisées. Vis à vis de l'organisation affective, les images ont une masse affective, une sorte de poids spécifique qui leur est affecté dans la chaîne des signifiants.
Par objets psychiques, j'entends des configurations mentales stables, des formes/traces psychiques affectées de façon infraliminaire, qui conservent une stabilité lors du travail de rappel. Ce sont elles qui sont opérantes dans le délire et qui viennent occuper l"espace de la perception en place des sensations, un peu à la façon des images d'archives utilisées à la télévision, plus ou moins trafiquées par le producteur en fonction des enjeux qui lui sont dictés par l'établissement, en place de l'émission en direct.
Toutes les excitations produites par l'organisme à l'état de veille sont perçues, c'est là leur qualité intrinsèque. Elles le sont soit de manière consciente, soit de manière infra-consciente. J'entends par là une modalité de la perception consciente déconnectée de la liaison au fonctionnement de la réalité. Une sorte d'absorption, de régression narcissique au sein même de l'univers affectif/psychique qui défait le sujet de son adhérence à la réalité. C'est cette conscience-là, cette perception narcissique qui opère durant le sommeil.
Les objets psychiques ne deviennent tels qu'après fixation dans la chaîne mémorielle des signifiants. C'est en tant qu'ils sont des représentants des signifiants affectifs qu'ils sont engrammés dans la chaîne mémorielle. Ces Objets psychiques sont susceptibles de fonctionner en tant qu'objets dans la réalité pour le sujet, en place des objets de la réalité, par où s'inaugure la perception délirante.
La saisie des formes psychiques et leur intégration à la chaîne mémorielle active est liée au pré-sentiment de leur utilisation potentielle comme matériau signifiant, prémonitoirement affecté à l'énonciation. Les matériaux du rêve sont en quelque sorte réquisitionnés à l'état de veille. De la même façon que, dans l'activité surréaliste de collage, les images sont perçues/arrachées/découpées dans les revues au moment de la cueillette flottante des images en lien avec leur résonance signifiante. C'est ce qui donne à ce mode de création sa promiscuité avec le rêve. Au terme du travail psychique de création, il reste une seule configuration d'images, une narration (ambiguë) un tableau, et des matériaux résiduels non-utilisés. L'organisateur de ces matériaux, dans la création, comme dans le rêve, est le Soi, instance globale et globalisante qui gouverne notre destin avec ou contre le concours du Moi.
Honoré Grissë
Quelle explication donnez-vous au travail du refoulement qui opère sur le rêve au moment du réveil ?
Guy Lafargue
Certes, l'hypothèse selon laquelle il existerait une instance refoulante qui exercerait activement un travail d'effacement du rêve peut se concevoir. Si cela est le cas, c'est en tant que mécanisme de conditionnement qu'il convient de le concevoir. Le rêve étant un manifeste de l'affect, dont l'activité inhibitrice cesse avec le sommeil, le scénario onirique se dissout avec le retour de la vigilance. Mais on peut faire l'économie de cette entité. Il y a, en effet, une cause physiologique à l'effacement du rêve nocturne au moment du réveil (qui est aussi le moment de sa production), qui est qu'on ne peut avoir plusieurs objets de perception volontaire simultanément. L'accommodation de l'attention ne peut se faire que sur un seul objet. C'est cette raison qui explique que l'on ne puisse simultanément, au réveil, s'ouvrir à l'expérience psychique du réveil, très active, et sur les traces psychiques du sommeil encore présentes sur le comptoir. Au réveil, il y a conflit entre deux modalités de l'émission psychique dont les valences affectives sont distinctes sinon hétérogènes: celle, résiduelle, propre au poids spécifique du rêve dans le champ de la régression, avec celle, très active où nous sommes engagés avec le réveil. L'émergence de l'intentionalité et le rétablissement de l'activité du Moi est antinomique avec l'état de relâchement physiologique préludant à l'expérience du rêve.
Peut-être un entraînement à la perception double est-il possible, c'est à dire de la coexistence de deux plans d'activité psychique simultanés . C'est en tout cas, d'une certaine façon ce qui se tente dans l'activité de retrouver le rêve au réveil.
Honoré Grissë
Il est clair que vous interrogez, avec quelqu'insolence parfois, un certain nombre de concepts centraux de la psychanalyse, même s'il semble que vous soyez très attentifs aux travaux cliniques des psychanalystes.
Sur la psychanalyse :
clinique et spéculations
Guy Lafargue
C'est exact. La psychanalyse clinique, c'est les mines du Roi Salomon, et je commence tout juste, à cinquante ans à y goûter avec plaisir. Mais le Jeu de la recherche m'excite. C'est un itinéraire pour moi. Expressif et créateur. Et c'est parce que j'invente aussi des mots, des concepts, que je me dois à une certaine ascèse. Un concept, c'est un outil pour permettre de parler. Mais il commence à y avoir problème lorsque l'outil pour permettre de parler de l'objet se met à fonctionner de manière décontextualisée, en place de l'objet lui-même. Lorsqu'il se met à exister comme croyance. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec la malencontreuse notion d'"appareil psychique" dont ils ont la page pleine, au point que ça bouche tout, et que ça leur obture la vessie de la pensée qui se met à se prendre pour une lanterne.
Entendez-moi bien, ce n'est pas l'existence de ces mots qui fait problème , ni leur usage explicatif provisoire. C'est réellement lorsque le mot, symbole utilitaire d'une pensée complexe (c'est bien cela le symbolique... si j'ai compris Lacan ?), vient à occuper la place de l'Objet; c'est lorsque le mot, qui est une forme abstraite de l'image en vient à assumer dans la réalité le pouvoir de l'Objet dans le Réel. Les théoriciens/psychanalystes s'imaginent que parce qu'ils élisent le Verbe, l'affect s'aligne; que parce qu'ils décrètent le mot, l'humanité s'instaure. Je trouve cela grossier. Le mot et le verbe sont en aval de l'affect. Le verbe, en tant que tel n'est cause de rien.
Moi, j' interprète le monde dans l'autre sens : le mot comme produit ultime de la détérioration de l'Imaginaire. Cela sera difficile à faire passer dans la culture de la vache folle, tellement convaincue que la chose humaine est le fleuron des espèces vivantes, le couronnement de l'évolution, alors qu'elle n'en est que le dernier effet de décomposition. Et la chose se complique encore lorsque la translation s'opère du concept sur un ensemble de concepts articulés en une théorie, si bien qu'en fin de processus, nous n'avons plus à faire avec des objets réels mais avec des objetsabstraits dits " théories" qui se mettent à fonctionner sur un mode autistique, comme objets auto-sensuels, de manière déréelle, uniquement dans le discours (n'est-ce pas cela la para-noïa?). Je me demande alors si je parle bien de la même chose avec ces personnes. Quand je lis Freud cela est très perceptible; et pour ce qui concerne Lacan, n'en parlons pas : le système de pensée de cet homme est tenu par une exigence omnipotente de construction logique. Tout le système est en tension idéalisante vers une totalité explicative rationnelle. Et au bout d'un moment de ce dérapage, on est dans la confusion la plus complète de ne plus savoir ce qui, dans l'élaboration théorique, relève de la rencontre avec des événements concrets produits dans l'expérience clinique, ou de purs événements psychiques entièrement soumis à l'arbitraire de l'affect du théoricien. La notoriété du théoricien trafiquée par ses adeptes ajoutée à ton complexe d'infériorité chronique fait le reste: tu gobes tout, l'eau du bain avec le bébé. Et avec, les petits immondices qui n'ont pas été captés par ses Pamper's.
Heureusement que tu oublies tout ça quand tu es avec ton client. Là, c'est le Réel qui prend les commandes. Sauf si tu restes préoccupé de continuer à savoir quelque chose sur ce qui se passe ou sur ce qu'il convient de faire ou de dire, auquel cas : soit il ne se passe rien (tu inexistes) soit tu te fais casser la gueule.
L'analyse, le travail analytique, que tu sois psychanalyste freudien ou autre chose, ça n'a rien à faire avec ton savoir, Ça a à voir avec la transgression permanente des codes psychiques et du jeu social qui sont la même chose. C'est au cœur même de ce drame analytique qui se noue entre un thérapeute et un client, qu'à certains moments critiques, la théorie viendra faire retour comme évidence, et comme principe opérant de l'orientation de ton action, parlée ou corporellement agie. C'est cette part de ta théorie qui est issue du Réel qui va pouvoir fonctionner comme cadre et espace fiable d'accueil des décharges affectives puissantes et dangereuses qui marquent le déploiement d'un processus thérapeutique. Cela sert essentiellement à ça une théorie, à travailler dans une relative force et sérénité. Que cela ait en outre des bénéfices narcissiques secondaires, est ma foi une chose bien agréable. Mais ces bénéfices-là ne sauraient justifier les guerres de religion auxquelles cela a donné lieu.
Honoré Grissë
Dans le fond, vous concevez la théorie comme une sorte de reflet du Réel, de "pictogramme" mis en scène dans l'espace de représentation du praticien, à son usage personnel. Dans l'article intitulé "Théorie mon amour", vous expliquiez que cette impulsion à traquer la structure et le processus est destinée à soulager le théoricien des poussées persécutives inconscientes. Il me semble qu'il y a là quelqu'analogie avec l'explication que Mélanie Klein donne de l'art. Elle dit que l'œuvre artistique remplit une fonction d'élaboration de la position dépressive, et de réparation des Objets détruits par les attaques envieuses.
Art/Création
Guy Lafargue
Oui. Je suis d'accord avec ce point de vue. En outre, Mélanie Klein a certainement fait avancer la question, par rapport aux premières explications de Freud sur l'art comme sublimation. Mais, si cette explication s'applique à l'élaboration artistique, elle n'est pas, comme elle semble le croire elle-même, l'explication de dernière instance de l'expérience créatrice. Mon expérience à moi m'enseigne que l'expérience créatrice est fondatrice plutôt que réactionnelle; constitutive de l'espace psychique plutôt que d'abord réparatrice. C'est plutôt du coté de Winnicott que de Mélanie Klein que je porterais le crédit. Cela, bien entendu, n'exclut pas l'existence de ce plan, mais en quelque sorte, il est une contribution de seconde main.
Honoré Grissë
Vous êtes très attaché à cette distinction entre l'art et la création...
Guy Lafargue
Oui. C'est la moindre des choses pour une personne qui pense. L'art est une pratique sociale et un concept sociologique. Il implique nécessairement l'existence de l'autre dans la tension résolutoire vers la réalisation de l'œuvre. L'art, c'est le métier. Cet @utre, ce sont les institution de l'art : galeries, musées, expositions, bizzness, célébrité, alimentation stéréotypée à la table des médias...qui détournent le sujet de l'expérience créatrice, qui n'a pas d'abord à voir avec l'œuvre et ses bénéfices secondaires, mais avec la cruauté et avec la Parole... avec la formation de la Parole.
C'est étonnant que le premier psychanalyste n'ait pas pas été vraiment concerné par l'essence du processus créateur. Freud qui était si obstinément préoccupé par sa théorie, au point d'essayer de tout expliquer par elle, n'a pas pris la mesure des aspects narcissiques du processus de sa propre création. Ça c'est le versant aliéné aux instances tutélaires, une tentative kleinnienne (avant la lettre) de réparation, de totalisation noïaque des Objets. Le fonctionnement de la science comme Objet subjectif me parait tout à fait assimilable au fonctionnement de l'art. Pourtant, Freud a entrevu la chose, mais il ne s'y est pas livré.
Dans l'art, l'expérience de création qui se manifeste est irrémédiablement inscrite, emprise dans le discours et dans le regard de l'autre, dans son supposé-regard. C'est le miroir de la marâtre. Le processus de la création lui-même, l'expérience créatrice, n'ont pas de frontière commune avec le processus artistique. Ils s'inscrivent au cœur même de l'expérience originaire du sujet, à l'intérieur de la clôture narcissique originaire. L'@utre en est absent, en instance de constitution, peut-être, au terme du parcours créateur.
Les mnésies
L'expression créatrice est un processus primaire en tension vers la constitution de l'Objet. Et l'histoire de l'œuvre, c'est cette histoire-là: de la création de l'@utre à l'intérieur de Soi qui marque la sortie de cette période que j'appelle l'Originaire.
Honoré Grissë
Pour parler de l'expérience de l'Originaire, vous avez créé le concept de mnésie. Dans les écrits psychanalytiques de Freud, on trouve le terme de "traces mnémiques" plutôt assimilé aux souvenirs reconstruits grâce au travail associatif. Qu'est ce que le concept de "mnésie"apporte de nouveau ?
Guy Lafargue
Les mnésies ne sont pas des souvenirs. Ce terme - mnésie - recouvre exactement ce qu'un certain nombre d'auteurs, mais en particulier Winnicott, ont appelé les expériences "impensables", "irreprésentables", et qui sont tout à fait autre chose que les produits (supposés) du refoulement tels que Freud les avait conceptualisés au travers de la notion d'"inconscient".
L'hypothèse de Winnicott, c'est que dans la toute première période de l'existence - celle que moi je qualifie d'Originaire - l'instance percevante (pour certains le "Moi", pour d'autres le "Je", pour d'autres la" conscience"), n'est pas encore constituée, ou suffisamment intégrée, pour absorber et contenir certains événements et sensations brutes (non encore analysables par un Moi inexistant ou peu élaboré) dont l'intensité est excessive pour le bébé. Selon moi, cette période originaire est le temps de mise en place de l'expérience affective.
L'expérience affective (l'"originaire" selon Piéra Aulagnier) c'est la somme des sensations, des décharges émotionnelles originelles brutes, dont le bébé est le siège à l'occasion de ses échanges avec l'environnement maternel. L'affect, c'est ce qui des émotions primordiales se constitue en une structure d'être au monde. L'expérience affective est inscrite comme structure stable, et génératrice de proto-représentations phantasmatiques (à la limite de l'hallucination), pour lesquelles l'organisme ne dispose pas encore de référant expérientiel antérieur. Le propre de ces éprouvés est de ne pouvoir être symbolisés. Il y a là une sorte d'alliance contradictoire entre ces deux modes de l'expérience. Le temps de constitution de l'affect se traduit, en terme d'expérience, par un blanc dans la représentation. La représentation est seconde en regard de cette mise en place inaugurale des modes d'ouverture au monde.
Notre expérience originelle est construite d'éprouvés non symbolisés. La somme de ces éprouvés non-représentés engrangés dans la chaîne mémorielle, c'est cela que je désigne par le terme de mnésies. Et l'Originaire, c'est cette masse de mnésies, d'expériences non représentables sur la scène du symbolique et de la nomination, qui le rend intrinsèquement inaccessible à la technique psychanalytique pure, en tant qu'elle circonscrit le travail de la formulation à l'aire des phénomènes psychiques/imaginaires et symboliques construits.
Les mnésies, c'est un capital d'expériences originelles en attente d'être constituées dans l'expérience actuelle du sujet. Et le processus de constitution par lequel les mnésies accèdent à l'histoire en tant que formes, c'est là à proprement parler le processus analytique. C'est ce qui fait que des événements virtuels (qui ont eu lieu) ne se mettent à exister comme événements réels qu'à partir du jeu de la formulation. C'est précisément ce qui se produit dans l'expérience créatrice. Ce n'est pas, paradoxalement, l'histoire qui est à l'origine de l'œuvre créatrice, c'est l'œuvre créatrice qui est à l'origine de l'histoire. C'est en cela, justement, qu'elle est créatrice. Il y a là un renversement paradoxal de perspective que Michel Thevoz, le gardien du temple Dubuffet, à Lausanne, a remarquablement exprimé dans son ouvrage : ART, FOLIE, GRAFITTIS :
... "l'œuvre réalise une interaction féconde entre l'impulsion plastique et les événements irrésolus de la préhistoire infantile. Elle reste en communication réversible avec le passé psychique ; elle ne s'explique pas par lui ; elle l'explique au contraire, elle l'élabore... de sorte que si l'on tient à un enchaînement causal, il faudrait alors l'envisager dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de l'œuvre comme détermination productrice qui résoudrait le suspens originaire, et qui peuplerait le passé psychique comme si celui-ci avait attendu d'elle sa réalisation symbolique".
Cette accession rétro-active à l'existence historique désigne parfaitement ce dont il est question dans toute expérience créatrice authentique, artistique ou thérapeutique. L'artiste, comme le dit si bien Thévoz "est artiste précisément dans son impulsion plastique à introduire du Jeu dans les signes à la faveur duquel une signification inédite, et sans doute involontaire, va s'approprier insensiblement des signifiants qui ne lui étaient pas primitivement destinés... L'œuvre d'art réalise la jonction d'une impulsion ludique et d'une signification inédite ou illégitime qui, à elles deux, ont raison de l'ordre canonique des signifiants" (op.cit.p.16 et 17).
Là, nous avons fait un pas décisif pour comprendre la nature du processus de création, qui rend caduque l'ancienne théorie réductionniste de l'art en termes de sublimation. La prédominance de cette dimension, dans une œuvre artistique, signe son degré d'invalidité en regard du potentiel créateur de l'artiste.
Il faut en finir avec la théorie de la sublimation et avec toute cette gymnastique contorsionniste et pédante à laquelle elle a donné lieu dans les textes psychanalytiques, (voir à ce sujet le livre de Didier Anzieu sur "La sublimation" - Tchou" ed). Je pense que loin de fixer la libido sur des objets non sexuels, l'expérience créatrice ramène au contraire la libido sur son lieu de prédilection : l'expression sexuelle. Elle transforme la libido du Moi en libido d'Objet.
Créer rétablit ou établit les conditions de possibilité du travail de l'amour génitalisé, restaure l'exercice du Désir dans le territoire de l'amour. Dans l'expérience créatrice, l'impulsion infantile, qui anime aussi bien la chiennerie transférentielle que la passion artistique, est conduite à maturation. Cela ne veut pas dire qu'il existe une idéalité de la relation d'amour qui serait indemne de toute affectivité infantile, mais que le sujet devient capable, sans conflit majeur, d'utiliser de façon créatrice dans la relation d'amour (j'oppose créateur à névrotique), les immenses ressources affectives de l'Originaire infantile.
Un autre abus de pouvoir tient dans l'application de la technique psychanalytique aux œuvres d'art. Une nouvelle fois, cet arraisonnement de l'œuvre par la procédure de mise en examen des contenus latents de l'œuvre et de leur articulation aux anecdotes biographiques du créateur doit être vigoureusement dénoncé. Il est réducteur, intrusif et réifiant. Comme pour le rêve, l'intérêt fondamental de l'œuvre réside dans ses effets de structure (dans les forces de résilience dont il est l'expression) et dans son contenu manifeste. L'œuvre est une condensation, une symbolisation qui emballe dans une forme ramassée un ensemble de signifiants qui tirent leur puissance æsthétique justement de leur opacité et de leur universalité, même lorsque cette universalité n'est partageable qu'avec quelques autres humains, ne serait-ce qu'un seul. L'œuvre n'est pas une métaphore, c'est une métamorphe.
A quoi sert cette intrusion ? A qui ?
Au critiquanalyste.
C'est une appropriation abusive, qui essaye de faire l'économie de la rencontre de l'œuvre dans les intensités affectives brutes où le créateur appelle l'@utre à lui restituer en miroir l'effet de sa propre passion, et de sa prise du risque créateur.
Honoré Grissë
Il y aurait donc, selon vous, une sorte de dialectique, ou de synergie, entre le Désir et l'Originaire.
Guy Lafargue
Pas exactement...
Le Désir est un manifeste affectif de l'Originaire qui ne se saisit qu'au travers de l'acte de formulation. Paradoxalement, le Désir n'est pas à l'origine. Le Désir n'est pas le Verbe. Freud nous a complètement emmêlé la pensée avec ses histoires de "principes-de-ci, principe-de-ça", de plaisir, de réalité, de constance, de Nirvana! (mais-oui mais-oui! Freud est le grand-père des Pisse-and-love...). Quoi qu'en dit Lacan, sur un certain nombre de choses, le texte de Freud -"Au delà du principe de plaisir" - est un article de brocante. C'est une théorie en noir et blanc. Ça ne sert à rien de vouloir la coloriser. L'explication de la pesanteur par "le principe de poids" a eu aussi son heure de gloire, à la sortie du Moyen Âge. On disait alors poétiquement "horreur du vide".
Plaisir/Jouissance
"Principe" veut exactement dire "origine". Expliquer l'inféodation de cette invention conceptuelle - l'appareil psychique - au principe du plaisir est un non sens. Il faut en finir une bonne fois avec ces vieux réflexes conditionnés, comme quoi, chaque fois que quelque chose fait problème insurmontable aux deux bouts de la chaîne cognitive, on invoque le principe de plaisir et la pulsion de mort comme explication de dernière instance. Ces concepts ne servent plus à rien sinon à encombrer les étagères.
La psychologie freudienne du plaisir est caduque. Le plaisir n'est pas un but poursuivi par l'organisme. Comment pourrait-il l'être, à fortiori, pour ce sous-produit de l'activité neurologique que sont les manifestations psychiques. La psyché n'est au principe de rien du tout. C'est ce truc-là que les créants de la psychanalyse vont avoir du mal à admettre.
Le "plaisir", c'est un mot que l'on prononce lorsqu'on veut rendre compte d'une certaine qualité de la sensation consécutive à la satisfaction. Le plaisir n'est qu'un effet de la satisfaction (que la nature de cette satisfaction soit physiologique ou qu'elle soit affective). Elle est là, l'origine du plaisir, dans la satisfaction.
La production psychique n'est pas là pour procurer du plaisir, mais pour indiquer au sujet que quelque chose s'inscrit dans son expérience comme manque, ou comme souffrance, et qu'il conviendrait de faire quelque chose pour s'occuper de la motion organique qui en est au principe.
Honoré Grissë
Donc, vous affirmez l'Originaire comme étant le "socle" de l'expérience subjective; comme fondation de l'expérience psychique elle-même, seconde en regard de la structure affective.
Guy Lafargue
C'est exact. C'est une evidence indiscutable.
Il est important de bien souligner que l'affectivité n'est pas un nouveau concept substancialiste destiné à remplacer l'ancien - l'appareil à penser - mais bien une structure, une organisation originelle des expériences douloureuses ou satisfaisantes. Cette structure est ce qui définit notre mode d'ouverture au monde. A partir d'elle, le sujet recrute de nouveaux espaces internes, par déplacement transférentiel sur des objets homomorphiques - des appeaux comme on dit chez nous dans les palombières des bords de Gironde - de certaines qualités de l'expérience acquise sur les Objets Originaires, .
Honoré Grissë
Il semble que vous ayez trouvé chez Piéra Aulagnier certaines formulations théoriques qui vous conviennent. En particulier, vous utilisez à plusieurs reprises comme frontispice à vos articles cette phrase tirée de son ouvrage "La Violence de l'interprétation", que je vous rappelle:
... "Si le regard désinvestissait la scène extérieure pour se tourner exclusivement vers la scène originaire, il ne pourrait qu'y contempler, sidéré, ces images de la chose corporelle, cette force engendrant une image du monde devenue reflet d'un espace corporel, déchiré par des affects qui sont à chaque instant, et totalement, amour ou haine, action fusionnelle ou action destructive"...
Pourquoi cette pensée vous fascine-t-elle ?
Guy Lafargue
Essentiellement parce que l'hypothèse d'Aulagnier, le "Si" inaugural de la question qu'elle pose, constitue pour moi le cœur de ma thèse. Ce qui, chez elle, est pressenti, virtuel, constitue la base de mon expérience, de mon observation clinique et de mon système de représentation des rapports existant entre l'affect, la représentation psychique et l'expérience æsthétique, en tant que cette dernière ramasse dans un agir unique la perception de l'Originaire et sa mise en représentation dans l'œuvre, qui est ce par quoi elle tire sa puissance "esthésiante" sur les témoins de l'œuvre.
La création tient son pouvoir de l'impact de l'Originaire : tant sur le créateur qui y trouve ce lieu de représentation pour l'irreprésentable (comme le dit Lebovici dans la préface au livre de Winnicott "Jeu et réalité") que sur le spectateur qui investit l'œuvre, qui ferait ainsi une sorte de placement de ses économies affectives. Le créateur est quelqu'un qui fait fructifier son capital affectif, qui y puise paradoxalement les moyens de sa croissance, et qui en indique le chemin au spectateur de son œuvre.
Cette résistance rebelle de l'Originaire à l'inquisition de la méthode psycho-analytique tient à ce que les psychanalystes ont fait le choix dans le champ langagier de se restreindre à la portion congrue du nommable, qui, quoi qu'ils en disent, procède de l'affect, qui procède lui-même en dernière instance de la viande, même si cette viande est polluée par des signifiants immuables. L'originaire n'est pas psycho-analysable justement parce qu'il est originaire, c'est à dire générateur de la matière psychique. Il y a là rien à analyser, en tant qu'analyser, ce symptôme obsédant relève d'une tension originaire durcie autour de ce rien qui incarne la prétention du Symbolique à s'envoyer le Réel.
Ce "regard" (idéel) dont parle Piera Aulagnier est en réalité contaminé de mots. Cela pourra paraître incongru, mais il n'arrive presque jamais que l'on regarde réellement quelque chose sans être saisi par l'incontinence d'un discours intérieur continu, encombrant, une sorte de voix "off", qui s'intercale entre l'objet et la rétine, qui filtre, sous-pèse le degré de conformité, évalue le risque et pour finir, guillotine le sentiment spontané. A la fin, tu ne voies pas l'objet, tu ne vois que ta propre pensée.
Créer, c'est une façon d'explorer l'espace interne sans cette résonance verbalisante. Quand tu crées vraiment, tu ne penses plus dans le système de la rationalité du Moi. La scène extérieure, essentiellement représentée dans la tête par les mots, se dissout, parce que la qualité d'attention qui s'ouvre est de l'ordre de l'esthésie, de la perception non-médiate, du ressenti, et non de la pensée-en-mots qui n'en est que le reflet lointain et diffracté où s'aménage le compromis avec les instances tutélaires. La pensée, contrairement à la présomption de la culture occidentale, est un écran à l'esthésie.
Ce à quoi est confronté le créateur qui parvient à cet état, c'est justement à l'esthésie de l'originaire, c'est à dire aux soubresauts de "la chose corporelle déchirée par des affects qui sont à chaque instant, et totalement, amour ou haine, action fusionnelle ou action destructive". Et ces images ne sont pas des images de la pensée, mais des images surgies du corps lui-même, des mains, sur la toile ou sur le marbre. Et, paradoxalement, cette confrontation directe, et cette sidération provoquée par l'œuvre créatrice, par cette forme accomplie de l'originaire, provoque une intense décharge affective, défait la structure pathogène, et ouvre le sujet à ses potentialités vivantes.
Piéra Aulagnier semblait être au seuil d'une rupture avec la tradition psychanalytique. Elle était peut-être debout sur le rebord de la fenêtre. C'est en tout cas ainsi que je comprends ses "Questions aux analystes" posées dans un chapitre de son livre "LES DESTINS DU PLAISIR" où elle interpelle ses coreligionnaires en leur disant:
- "Imaginons que l'on découvre que l'inconscient n'existe pas, que le refoulement est une pure illusion, que la pulsion est effectivement un mythe. Réalise-t-on que, dans ce cas, ce serait notre propre manière de nous penser, de penser notre monde, nos affects, nos espoirs, qui s'effondrerait".
Mon point de vue est que le Rubicon est franchi :
- L'Inconscient comme structure psychique n'existe pas (vous me direz que c'est bien prétentieux : ma parole contre celle de Freud...)
- La Pulsion est une fiction conceptuelle (si je puis me permettre ce pléonasme), utile seulement pour parler, dans l'après coup, d'un processus d'actualisation de la satisfaction .
- Et le refoulement, un concept qui ne tient pas devant les connaissances actuelles de la biochimie et de la physiologie cérébrale.
C'est bien normal que le vieux monde s'accroche à ses objets. C'est même plutôt sympathique. D'autant plus que Ça n'a plus beaucoup d'influence sociale.
Moi, d'une certaine façon, j'ai choisi de m'atteler à la pro-vocation créatrice. Je tente de former une pensée opératoire nouvelle. Je crois que je peux enfin dépasser ma résistance vigoureuse à lire Freud, et les autres, parce que je me suis forgé une représentation de mon expérience suffisamment homogène et éprouvée pour affronter ces autres modes de représentations sans m'en servir comme de prothèses. Et ma lecture est féconde. Elle me permet de voir l'écart et de sentir combien certaines explications, tout à fait novatrices et utiles à l'époque de leur élaboration, ont pris un coup de vieux. Et ce que je suis en train de découvrir des Séminaires de Lacan me conforte dans ce sentiment qu'il s'agit d'un effort pour ravaler le monument freudien et pour le délocaliser dans la ville nouvelle. Mais la ville nouvelle surgira d'une pensée nouvelle. Et le Panthéon restera à la Sorbonne. Il faut bien des objets pour la nostalgie.
La chose corporelle
Honoré Grissë
Pouvons-nous revenir sur cette évocation de la "chose corporelle"? Cela a-t-il un rapport avec ce que vous appelez images du corps ?
Guy Lafargue
Aulagnier parle des "images de la chose corporelle". Elle dit que les images de la chose corporelle et la matière affective originaire sont une seule et même réalité. J'adhère entièrement à ce point de vue. Elle a inventé le mot "pictogramme" pour désigner ces images. Ce mot ne me convient pas vraiment. Il est connoté de l'idée picturale de représentation visuelle, liée à cet espèce d'atavisme psychanalytique d'exaltation du rêve comme voie "royale".
Les formes affectives recrutent dans tous les espaces de la sensorialité, et donnent lieu à toutes sortes de langages de création. Je préfère le terme de mnésies pour désigner les expériences affectives qui construisent ce que l'on appelle l'Originaire. Les mnésies sont des forces en instance de représentation (et non des formes) ramassées sur elles-même, en attente de produire des formes, des images adressées au "Je", à cette instance dont il est convenable de ne rien dire sinon qu'elle est ce par quoi le Réel nous est accessible en tant que trace et que motion.
Pendant ma formation de psychologue, je me souviens que j'avais été frappé dans les enseignements sur la psychanalyse que nous donnait le Professeur Doron, par la question de l'amnésie infantile. Cette histoire-là me préoccupait beaucoup, Dieu savait pourquoi. L'affirmation selon laquelle il existait un univers psychique inaccessible me paraissait déjà incongrue. Et pendant longtemps, par boutade provocatrice, je disais que l'Inconscient n'existait pas. C'était une prémonition heuristique mais je ne le savais pas encore avec fermeté.
Ce que j'ai compris par la suite, c'est que c'étaient les outils de la psychanalyse qui étaient inadéquats à figurer les événements affectifs archaïques(la théorie aussi est une figuration). Et que ce que Freud appelait l'Inconscient, comme partie-psychique-clivée de l'appareil psychique, c'était en réalité l'expérience affective originaire. Autour de ce concept d'amnésie infantile, la théorie était là pour masquer ses failles et pour étayer les incertitudes de la technique.
C'est ma lecture de Winnicott (dans les années 80) qui a été le déclencheur de cette condensation, avec cette extraordinaire chose qu'il posait comme un "impensable " (un non-psychisable pourrait-on dire), des situations originaires, de nature différente de l'inconscient du refoulement posé par les freudiens. Et par la suite, lorsque j'ai plongé dans les travaux de Piéra Aulagnier, j'ai été conforté dans ma conviction naissante.
Mais ma conviction profonde, c'est tout de même à partir de ce que je vois quotidiennement surgir au cœur de mes Ateliers d'Expression Créatrice ou dans les psychothérapies que j'ai conduites, qu'elle s'est forgée. L'Originaire est le germe et le fumier de la formulation. Dans l'expérience créatrice de l'Art CRU s'accouchent des œuvres en prise directe sur les mnésies, dont il est aberrant d'attendre autre chose que des réactivations d'affects, en particulier corporels. Convoquer, comme cela est l'invite dans la cure psycho-analytique, des formulations psychiques verbalisables en provenance directe des strates affectives primitives est d'une certaine façon un espoir contre nature. Par contre, dans le jeu corporel de la création, la résurgence directe de l'affect est immédiate et parfois massive. C'est précisément parce que l'acte créateur est essentiellement mobilisation affective puissante au travers d'un agir corporel que la cristallisation des mnésies (engrammes organiques) est possible. Ce n'est pas exclusivement la parole qui marque fondamentalement le passage de l'animalité à l'humanité, c'est l'expérience créatrice, dont la parole est le dernier rejeton , dans ce processus irréversible de ce que j'appelle la dégénérescence adaptative qui conduit lentement le cosmos vers son vieillissement, et sa mort.
Perception/Inconscient
Honoré Grissë
Pensez-vous sérieusement ce que vous affirmez, que l'Inconscient en tant que strate psychique séparée n'existe pas?
Guy Lafargue
Oui. Comment peut on penser autrement ? Le seul vrai problème, c'est d'oser le dire. Et comme je n'ai pas de susceptibilités universitaires à ménager ni de sérail à séduire et qu'il m'importe peu de passer pour un imbécile, j'ose le dire : l'Inconscient est une fiction métapsychologique qui ne sert plus à rien d'autre qu'à maintenir la cohésion de l'ancienne théorie psychanalytique, sans laquelle c'est tout le système qui s'effondrerait, et c'est ce qui va arriver. Dans 20 ans on en sourira. Lacan est son dernier pape. Enfin...pour l'instant.
L'Inconscient, c'est le soldat inconnu. C'est le symbole d'un siècle qui croyait en la Science.
Ce qui est caduc, c'est cette trouvaille laïque géniale de l'appareil psychique comme contrecoup du scepticisme religieux de Freud . Tant que nous investissons cette image (l'"appareil" psychique) comme rendant compte d'une réalité dans l'expérience, l'édifice reste solide. Tous les textes de psychanalyse le montrent à l'évidence. Et ceux de Freud au premier chef. Cet "appareil psychique" est doué, doté de pouvoir causal (tu causes, tu causes...). Il est autonome. Il est le siège d'énergie...de toutes sortes d'énergies : libre, liée...traversé de toutes sortes de pulsions... Un jour, si j'ai le temps, je ferai un inventaire de toutes ces formules qui misent sur une crédulité de base nommée postulat, liées à l'allure "scientifique" de ses énoncés.
Tout est dit dans cette sorte de phrase de la structure latente de la spéculation psychanalytique, quant à la mécanique psychique. Quand Lacan dit que l'inconscient est structuré comme un langage, on en a une belle illustration. L'inconscient de la formulation théorique : c'est le postulat. Le contenu latent de la théorie, c'est la structure idéologique de la croyance. En clair, dans cette conception de la vie psychique, on ne met pas en doute le postulat selon lequel la fonction psychique est assimilable à un appareil, à un système, au demeurant topographié, et doué d'une propriété de conscience, dont on détermine mal si elle existe ( "La" Conscience) comme entité substanciale active ou comme une caractéristique attachée aux phénomènes?
Ce flou tient au mode de représentation lui-même de la psyché comme machine, avec un intérieur qui contiendrait (quoi : des souvenirs ? des fantasmes?) et un extérieur qui assiègerait et pénètrerait. Pourtant, il semble que lorsque Freud parle de l'expérience psychique en termes d'excitations et de processus, il n'attribue pas systématiquement aux faits dont il parle un coefficient psychique. Mais, pas plus qu'il n'existe de faits psychiques inconscients, il n'existe d'excitations inconscientes. Il est inhérent aux processus d'excitation d'être ressentis, d'être perçus. Chaque fois qu'il y a excitation, il y a perception, ressenti, même s'il n'y a pas de représentation psychique. Par contre, il y a bien des processus non conscients. La plupart des processus physiologiques le sont. Ou le deviennent en fonction de la loi d'habituation propre aux tissus neuroniques qui relâchent la tension d'alerte qui est à proprement parler l'excitation nerveuse.
En clair, la structure peut penser ses productions et ses Objets mais elle ne peut se penser elle-même.
Mon point de vue, je le répète, est que la psychologie est une science sans objet. Seule une épiphénoménologie (descriptive) est susceptible de rendre compte de l'organisation de l'expérience psychique. Alors, personnellement, j'opte provisoirement pour travailler pour une conception qui modifie les choses de la façon suivante:
- La notion de système C (la conscience) conçu comme fait psychique en contiguïté avec le monde des excitations d'origine externe est une incongruité.
- La notion d'intériorité et d'extériorité qui déterminerait les contours de l'"appareil" comme contenant, est une pure figure de pensée, sans aucun fondement logistique. Il n'y a pas de vacuité entre les faits psychiques, ni entre eux et le monde environnant.
- La croyance et l'existence d'un système psychique à tiroirs composant l'appareil est disqualifiée. Selon mon idée, il y a une seule fonction de production de formes psychiques entièrement assujettie à la perception, et non plusieurs ;
- Quand au processus de la conscience, je le conçois comme opération et non comme "propriété" attachée aux faits psychiques. La conscience n'est source de rien. Elle est opérat : celui de la perception elle-même; il n'y a pas de différence entre le processus de la conscience et le processus de la perception. Quand à prétendre en définir la nature... aucune psychologie ne saurait en rendre compte.
Ce qu'il me semble, c'est que :
- le processus de la conscience est issu du contact et de l'écart entre deux états successifs de l'expérience perceptuelle : résiduel et actuel.
- que ce frottement entre le résiduel et l'actuel est créateur d'une excitation spécifique, mesurée à l'aune de ce potentiel actualisant qui est la visée génétique (cette chose qui donne de l'urticaire à Lacan), expression virtuelle du Soi.
Mais cela devient aussi de la spéculation, et nous écarte singulièrement des obscurités attachées à la problématique de la relation opératoire que l'on appelle psychothérapie, où l'analyste/thérapeute vient prendre appui sur la capacité de figuration psychique des affects pour entraîner le sujet dans une expérience de croissance émotionnelle et d'ouverture à des relations créatrices avec son environnement.
Processus analytique/thérapeutique
Le fait paradoxal, c'est que l'on puisse mobiliser la fonction psychique, qui est une modalité expressive passive - une modalité de l'aval c'est à dire surdéterminée par l'affect - comme moyen de dé-structuration des signifiants affectifs, ce qui constitue une tentative d'établir le maniement des formes psychiques en une thérapeutique de l'amont.
C'est autour de cette production des images du corps où se figure le sujet (soit dans la dynamique psychique pure, soit dans la dynamique créatrice) que le drame thérapeutique vient se nouer, se déployer et se conclure. C'est en cela que la psycho-analyse, en tant que technique, est parfaitement fondée, malgré un certain nombre de présupposés idéo-théoriques inadéquats. Probablement, d'ailleurs, seule la psychanalyse peut invoquer la dénomination de "psychothérapie" pure, en ce sens qu'elle borne le territoire de la formulation créatrice du sujet, à la seule production psychique. Le verbe lui-même étant ce par quoi le psychique est susceptible d'échapper à la pure mentalisation pour prendre corps et devenir expression (dans le système de la motricité phonatoire). C'est en tous cas le pari de Freud.
Ma propre démarche, sous le surnom familier d'ART CRU, ne peut être définie comme une stricte psycho-thérapie, dans la mesure où j'invite la pulsion créatrice, le jeu de la formation de formes æsthétiques, à se saisir de toutes les possibilités langagières que le sujet est susceptible de mettre en œuvre dans le cadre de l'Atelier (y compris celles de la plasticité psychique). Alors, au point actuel de ma recherche, j'en viens maintenant à appeler les Ateliers d'Art Cru : Ateliers d'Expression Créatrice Analytiques.
Honoré Grissë
Par "Expression Créatrice", vous entendez donc ce mouvement par quoi l'image est instituée comme forme de la parole. Dans cette perspective, l'image psychique semble avoir pour vous le même statut que les images picturales ou poétiques ou que de toute autre médiation créatrice.
Guy Lafargue
Oui, à ceci près que la fonction psychique (inscrite dans l'ordre neurologique) et la fonction créatrice (inscrite dans l'ordre de l'agir corporel) sont indissolublement liées, co-extensives l'une à l'autre et interdépendantes. Ce sont des fonctions siamoises. Mais elle ne sont pas douées des mêmes propriétés. La fonction psychique est placée sous le contrôle du Soi et échappe à la détermination volontaire ; la fonction créatrice est placée sous la détermination du "Je", et elle implique la prise en compte des contraintes imposées au Désir par la réalité.
C'est dans le cadre thérapeutique, et dans ma position singulière d'animateur/analyste, que je confère aux images psychiques le même statut qu'à l'image créatrice - plastique, poétique ou dramatique - en tant qu'elles peuvent se donner à saisir comme formes prenant consistance et spécularité dans le champ de perception du thérapeute. Et en ce sens, la formulation psychique, de purement passive, est susceptible de pouvoir se mettre à fonctionner comme médium créateur, comme matière, pour le sujet lui-même. C'est là un renversement paradoxal: ce par quoi la fonction psychique peut être utilisée de façon créatrice, alors même que le processus de son utilisation est un processus illusoire. Et à mon avis, c'est ceci qui se produit dans une psychanalyse qui marche. Il me semble même qu'une psychanalyse ne peut se mettre à fonctionner que lorsque le sujet trouve auprés de l'analyste cette qualité d'attente active et sensible. C'est aussi ce qui se produit pour l'artiste créateur (ce que ne sont pas tous les artistes).
Honoré Grissë
Vous utilisez les termes de " médium", de "médiumnité" pour désigner cette propriété plastique de l'Imaginaire par quoi le sujet et le thérapeute sont livrés au jeu de la mise en forme de l'expérience affective originaire. Pour en revenir à la question des "images du corps", vous vous représentez le corps lui-même comme médium. Il y a là, me semble-t-il une contradiction : à savoir que le corps - vous dites plutôt l'"organisme" - ne peut être à la fois structure productrice de formes et matière constituante de la forme. Comment peut-on parler d'"expression" ou de" langage" corporels ?
Quid du corps ?
Guy Lafargue
Cette contradiction n'est qu'apparente. L'idée d'un corps purement biologique est un non-sens. Il en va de même de ces représentations de la "pulsion" ou de l'"énergie" en termes de forces biologiques pures de toute contamination par les signifiants.
Le propre de l'humain, c'est d'être irrémédiablement formulé par les expériences affectives originaires. Le corps est une instance affectée. Ce qui se donne du corps à la perception de l'autre est toujours de l'ordre d'un imaginaire premier. En ce sens, je suis d'accord pour dire que le corps est langage. Mais on m'a souvent cherché querelle lorsque j'affirme qu'il y a un langage du corps, que l'expression du corps, et surtout entre les corps (du client et du thérapeute) peut avoir, sous certaines conditions, le statut d'une énonciation et d'une parole. Ce qui gratte furieusement certains théoriciens intégristes dans cette affirmation, c'est qu'elle outrepasse, qu'elle enfreint une Loi inédite et difficilement avouable de la psychanalyse comme quoi "Tu ne toucheras pas", qui est une version éthiquettée de l'injonction faite à l'enfant : "on touche avec les yeux": en l'occurrence, pour le psychanalyste, avec les mots et avec le fantasme. Et, quoi qu'ils en disent, parler-n'est-pas-toucher. Le corps à corps, en particulier dans la relat a des effets différents de ceux d'une d'une énonciation interprétation ou d'une énonciation verbale ; et une réaction corporelle, une communication corporelle ou émotionnelle, peuvent aussi avoir valeur interprétative non-médiate.
De l'expression des affects dans la cure
Depuis mon premier engagement comme thérapeute, en 1974, j'ai pris le temps de mûrir, de conclure aussi un certain nombre de situations thérapeutiques avec mes clients, d'en ouvrir d'autres qui prennent en compte les expériences acquises. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet espèce de puritanisme qui prétend, en forme d'idéalité abstraite, que l'analyste est exempté d'ouvrir le travail de la vérité entre lui et son client. Je ne conçois pas un thérapeute qui ne soit pas obligé de se trousser les manches sur cette question. En tout cas, ce n'est pas la façon dont moi je suis opérant comme thérapeute.
Au demeurant, j'ai souvent le sentiment, à la lecture des écrits psychanalytiques "orthodoxes" qu'il règne un étrange silence sur certains phénomènes tels qu'ils se déploient dans le jeu analytique de mes clients, dont je suis sûr qu'ils existent aussi dans une psychanalyse :
- expression de haine : tenter de griffer, de mordre, de déchirer, d'attaquer le sein, de détruire les objets ; fracasser la tête de la poupée contre le mur, la démembrer et aller en jeter les membres dans la décharge du cimetière voisin sur le chemin du retour ; renverser les meubles, tenter de se mutiler etc...
- expression régressive : fouir, sucer son pouce, apporter son biberon en séance, "rentrer dans le ventre", se masturber ;
- expression d'amour : prendre dans les bras, pelucher, demander d'être câliné, appeler le thérapeute "maman" et tout cela qui constitue des formes affectives dans le transfert.
Certes, il m'est difficile d'imaginer la clientèle prépostsoixanthuitarde de Lacan, un tantinet balisée, se livrant à cette débauche et à cette luxuriance phantasmatique... quoi que ? En tous cas, à part celles de Searles, je n'ai pas encore vu publiées de monographies dans lesquelles les psychanalystes évoquent la façon dont ils réagissent corporellement lorsque de telles manifestations se produisent.
Alors, ce qui me pose problème à moi, ce serait plutôt de savoir pourquoi cela n'arrive pas, ou exceptionnellement, dans une psychanalyse académique, sinon parce qu'un interdit massif, structuré dans le cadre tel qu'il est institué, y est clairement perçu et intériorisé par le client en manque d'introjection. Moi, il me semble que cela est une façon d'opérer la sélection par le haut psychique, et de tenir en laisse le bas affectif. Et que cela établit une frontière entre ce qui se joue de la question du corps, du contact non-médiat et de l'expression non verbale dans la psychanalyse académique et cette tension que je dessine vers une forme progressivement construite d'Expression Créatrice Analytique.
Honoré Grissë
Il semble que les manifestations que vous décrivez renvoient incontestablement à l'univers Kleinien, et aux affects liés à la relation primitive à la mère, plutôt qu'au monde Freudien de l'Oedipe et de la relation au père. Lacan est certainement réputé pour avoir puissamment tenté de restaurer la fonction paternelle, à une période où l'analyse dérivait du côté du maternel et des premières relations entre mère et enfant.
Guy Lafargue
C'est effectivement ce qu'en disent André Green et bien d'autres, et ce dont les intégristes Lacaniens nous rabattent les oreilles. Moi qui suis en train de prendre connaissance de la nébuleuse/Lacan, des ouï-dire extatiques et des malveillances, je trouve dans sa pensée et surtout dans son attitude envers la donne explicative que l'on appelle métapsychologie, une analogie profonde avec celle de Freud, notamment quant aux préoccupations de notoriété et de leadership d'Ecole, qui me paraissent faire complètement écran à la préoccupation thérapeutique où bon nombre de gens comme moi qu'on appelle des cliniciens rament dans l'ombre.
En 1969, Lacan avait 68 ans et il créait le Département de Psychanalyse de Vincennes. Il a à ce moment-là, semble-t-il, abandonné la clinique thérapeutique psychiatrique directe. On pourrait se demander pourquoi. Un partie de sa pratique est devenue essentiellement philosophique et, si l'on peut dire, pédagogique (et je serais tenté, à la lecture des "Ecrits", de dire : "ésotérique"). Comme psychanalyste, un certain nombre de ses clients sont ses disciples (hors du Symbolique, point de grâce à espérer). C'est un didacticien. Ça change considérablement les choses, du point de vue du thérapeutique en particulier. Les candidats analystes ne se laissent probablement pas aller à l'incontinence affective comme ça. Peut-être que oui, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé à lire sur ce sujet d'écrits cliniques de Lacan rendant compte du travail analytique avec ses élèves/clients aspirants psychanalystes . Vu les grands déchirements doctrinaires et cléricaux des années 80, je dois dire que ça devrait être croquignolet. Il y a sûrement dans les coffres du Saint Siège, des monographies d'analyses de ses clients encore vivants , par Lacan, prêtes à redorer le compte en banque du légataire.
Dans ce que je repère grossièrement de l'aventure, c'est à partir de ce moment-là où il ne travaille plus de façon prévalente avec les clients de l'institution psychiatrique, que la théorie émerge comme signifiant-maître par rapport à la problématique du travail clinique où il était homéopathiquement engagé à l'aube de sa carrière. C'est à partir de ce moment-là, semble-t-il, que sous le masque de l'anarchiste universitaire, il se révèle que Lacan est, ni plus ni moins que les autres universitaires de sa génération un mandarin, autocentrique certes, mais un mandarin tout de même, flamboyant de surcroît ; et que, de la même façon que Freud, c'est un homme qui semble entièrement dominé par la préoccupation de créer Ecole, et d'en être le chef absolu et incontesté. En fait de restauration de la loi paternelle, on en revient aux basses pratiques de l'arbitraire phallocratique des mères abusives et de l'impérialisme de la pensée. C'est bien là que se désigne la rupture qualitative de cette génération avec la mienne. C'était bien normal que Lacan ait posé la question de la loi paternelle, après avoir traversé deux guerres mondiales (et même trois par ascendants interposés). Ils en ont un pris un coup fantasmatique du côté de l'impuissance, de la castration, de l'humiliation, les pères qui ont connu le Nazisme, le Pétainisme, le Stalinisme et la grande castratrice cléricale. Et ils avaient encore réussi à fourguer entre les cuisses de notre génération la bombe à retardement du Viêtnam et de l'Algérie et de toutes les autres ordures guerrières de la décolonisation, et celles à venir tout à l'heure.
Alors, il y avait bien quelqu'héroïsme et générosité de cœur à vouloir rétablir le Père tellement détruit dans l'exercice de ses fonctions symboliques. Mais voilà, les gens de ma génération, ceux qui sont nés sous l'occupation nazie, c'est du côté de la relation à la mère qu'il semble qu'il y ait eu des failles et de grands désastres. Sûrement que la mobilisation des pères du côté des tranchées y était pour quelque chose.
Alors moi, je ne prends pas pour argent content ce que dit André Green lorsqu'il parle/écrit de "la dérive du côté des mères qui n'est pas finie" à propos du courant maternel-kleinien de la psychanalyse ( et par extension de ma propre inscription identificatoire dans cette fluence autour de l'originaire). Ce n'est une dérive que pour ceux qui ont tranché et choisi un camp dans le champ f(ph)antasmatique. L'identification monolithique à une théorie est une défense. Moi, je pense qu'il y a des thérapeutes et des analystes dont le tropisme paternel est prévalent et qui ne peuvent probablement travailler de façon privilégiée et avec satisfaction que dans le champ de la névrose ou de la paranoïa (c'est à dire de troubles articulés autour de la souffrance dans le lien au père); et d'autres dont l"histoire est marquée de façon prévalente par le défaut fondamental (Balint) et les distorsions originaires du lien à la mère, et qui peuvent opérer de façon prévalente dans le champ des états dissociés et des états-limites. Et d'autres, enfin, suffisamment plastiques, créateurs et peu défendus contre le travail de la régression qui peuvent travailler avec leur client dans ce double champ.
De la médiumnité
Honoré Grissë
Cela nous ramène à la question précédente concernant la médiumnité : vous pensez que le thérapeute n'agit pas à proprement parler avec son discernement cognitif mais avec sa structure affective?
Guy Lafargue
Absolument. La médiumnité, c'est de placer la surface sensible de la fonction psycho-affective en signifiant-maître. Au premier abord, cela pourrait paraître assez incongru d'utiliser un tel concept de foire. Pourtant, c'est une question extrêmement sérieuse et difficile. Pour la résoudre, cela suppose que nous nous entendions sur la définition d'un certain nombre d'instances que nous traitons souvent avec désinvolture dans le commerce théorique, comme si les choses allaient de soi sans avoir à rendre compte du sens que nous attribuons à ces termes: le Moi, le Soi, le "Je", l'Inconscient, la Conscience, l'Originaire...
La pratique de la médiumnité, c'est de placer une instance opératoire en position médiatrice - en interface - entre deux réalités interdépendantes : l'une envers les mouvements de l'autre; et dans le processus de leur propre construction interne, dont les éléments identificatoires fournissent les matériaux. En l'occurrence ici, le corps et l'environnement, constitués l'un et l'autre d'éléments objectifs (génétiques ou historiques); et d'éléments liés aux processus de projection et d'introjection.
On peut ainsi dire que l'environnement humain est une structure qui tend vers la reproduction, à l'échelle du macrocosme, du système biologique humain (dont le réseau des transports, l'informatique, la télécommunication et les médias audiovisuels constituent les système circulatoires et nerveux) . Et que le corps, qui pense et élabore l'ordre social, introjecte en retour certains éléments d'information qui le construisent. C'est pour cela qu'il faut se garder de considérer le corps comme une entité purement biologique. Le corps est aussi, et de manière irréductible, marqué par les déterminants sociaux. Il est indissociablement matière et langage. Instinct et pensée. Pulsion et représentation. Et c'est précisément cela qui confère au corps ses potentialités médiatrices, médiumniques, entre l'organisation instinctuelle, l'organisation psychique, et l'organisation culturelle.
L'organisme humain est une structure bio-psycho-sociale. De cette complexité, le thérapeute/analyste apprend à jouer. Son métier consiste à utiliser sa propre plasticité comme matière et comme outil de création au service de son client. Et la partition du client, dans ce Jeu, c'est de rétablir le libre fonctionnement des dynamismes créateurs qui le constituent, en attente de déploiement. C'est de restaurer, comme on dit, la confiance en Soi.
Le Soi
Honoré Grissë
Je peux entendre que lorsque vous parlez de confiance en Soi, vous évoquez l'existence d'une force organisatrice fondamentale, le Soi, que dans votre système de représentation, vous placez en première instance. Pouvez-vous revenir sur ce que vous comprenez comme étant le Soi?
Guy Lafargue
Oui. Pour ce faire, j'utiliserai une métaphore.
Autrefois, la clef de voûte était la pièce maîtresse des édifices religieux, en ce sens qu'elle dictait une dynamique de l'âme organisée autour des lois de l'édification de la pierre. L'émotion religieuse et l'émotion esthétique (magies de l'ombre et des rosaces, enveloppe acoustique, sensualité olfactive et métamorphe cannibalique) s'accommodaient idéalement l'une de l'autre. La clef de voûte était le point ultime de tension de l'architecte où tout le reste du scénario mystique, confié à des artisans subalternes, devait être intégré.
Avec le béton et le ferraillage, les lois ont changé. Le Corbusier pouvait penser le contenant religieux à partir de l'interprétation poétique de la demande du client, de façon à peu prés totalement indépendante de la contrainte lié à l'entassement et au mortier de liaison.
Avec la Sagrada Familia, Gaudi, lui, a opéré un renversement total de point de vue. Comme les vrais cuisiniers, il a décidé d'accommoder les restes, comme on dit. Il s'était donné comme épreuve d'utiliser les ruines d'une cathédrale bombardée comme matrice de son rêve de constructeur fou. Ce n'est pas du tout insignifiant qu'il ait trouvé une Sacrée Famille pour cette opération phantasmatique. Le problème à résoudre était de re-construire une œuvre totalement nouvelle en prenant appui dynamique sur des fondations historiques. Si cela n'est pas une métaphore de la transmission sociogénétique, je veux bien me faire pendre. Gaudi travaillait sur la transmission culturelle des ancêtres. Il travaillait aussi avec les supports (comme au Parque GUËLL); mais aussi avec l'épiderme , avec les sous-tasses ébréchées, les tessons de céramique façon Picassiette, cet autre constructeur fou, concierge à la décharge municipale de la ville de Chartres. Pour résoudre cette tension fondamentalement mystique, et bien Gaudi est parti du ciel au lieu de partir du sol. Il a suspendu un parachute retourné au plafond de son Atelier, et il a dessiné les lignes de forces de la soie. Ce grand désordre de la procédure a donné naissance à une vision unique dans l'histoire de l'architecture.
Moi, dans cette histoire, je m'identifierai à Gaudi plutôt qu'à Freud. Freud a travaillé son système théorique à la manière des architectes du Moyen Age. Il était tenu, par son mode de pensée scientifique, à une logique de l'édification du bas vers le haut. Et sa technique analytique en portera la trace comme d'un recrutement progressif du haut vers le bas, du présent vers le passé, à la manière des fouilles archéologiques. Freud était hanté par la trace, par la retrouvaille des Objets anciens. Gaudi était hanté par la dynamique du Jeu. Comme Winnicott.
Cette digression pour dire que dans mon propre système de représentation du dynamisme vital, le Soi est le point de tension de tout l'édifice, point virtuel, comme on dit aujourd'hui, non à la manière de la clef de voûte, mais à la manière d'une vision accomplie, d'un projet préalable inscrit dans le dispositif vital, même si ce but ultime de la détermination biologique est de différer le moment du vieillissement et de la mort.
De manière moins métaphorique, je dirai que le Soi est une façon pour le sujet humain de se figurer en tant que totalité orientée vers un but. Cette entité comprend une part accessible à la perception consciente, et une part soumise à la perception non-consciente, qui dépend des structures sous-corticales du cerveau. Il existe des écarts entre la visée génétique de la structure (qui implique l'ensemble des analyseurs corticaux et sous corticaux, où se ramifie le Soi) et l'état actuel de la structure ; entre le virtuel et l'actuel ; entre le résiduel et l'actuel.
Le processus de la perception (de la conscience) est l'opération par laquelle se constitue et s'appréhende toute réalité existante. Je me représente le Soi comme une sorte de tension perceptuelle globale qui procède, aux fins de corrections et d'ajustement dynamique, à des comparaisons entre ce qui est établit dans l'expérience globale et ce qui la traverse actuellement ; entre le résiduel, constitutif du Moi, et l'actuel, tous deux référés à la visée génétique inconsciente. Cela suppose l'existence d'une telle visée dynamique fondatrice de l'expérience, antérieure et englobante de toute expérience. C'est en ce point qu'il y a un mouvement de bascule entre la déduction phénoménologique et la spéculation métaphysique.
Honoré Grissë
Vous admettez l'existence d'une perception non-consciente ?
Guy Lafargue
Naturellement.
Le maintien de l'intégrité de l'organisme dépend de sa capacité à percevoir la totalité des signaux qui conditionnent sa survie. Et toute une partie des terminaux perceptuels est contrôlée par des structures nerveuses archéo et paléo-corticales qui fonctionnent de façon indépendante des structures néo-corticales où se joue le drame de la pensée et probablement de la conscience vigile propre aux être humains, qui sont les seuls à avoir un néo-cortex complexe (qui remplit, entre autres, une importante fonction d'inhibition de l'action).
Par ailleurs, le système nerveux humain obéit à une loi fondamentale qui est dictée par la physiologie des cellules sensorielles qui ont pour propriété de cesser d'être actives lorsque le signal d'alerte n'est pas suivi d'effet mettant le système en danger. Les psychophysiologistes appellent cela la loi d'habituation. La répétition d'un stimulus non chargé d'affect entraîne la perte de ses propriétés subjectives. En l'absence de signaux éroceptif ou nociceptifs, le système d'alerte se désactive et l'attention peut se porter vers les stimuli internes. C'est ainsi qu'un certain nombre de stimuli réguliers cessent de provoquer des effets de conscience, de perception. Il sont immédiatement réactivés lorsqu'un signal fait rupture dans la répétition du même. C'est cette analyse instantanée qui est le fait de l'instance appelée Soi.
Le Soi est le système analytique des ruptures dans la continuité de l'expérience vécue dans sa globalité. Il est le pilote et le gardien de l'intégrité de la structure. Et, de même que la rétine organise le codage du message visuel pour le cortex, de même, il existe cet organe virtuel, le Soi, qui organise le codage du message existentiel lorsqu'un élément étranger vient faire rupture dans le continuum circonstanciel où se représente le Moi. Et, de même que la rétine ne peut se voir elle-même sinon dans le regard de l'autre, le Soi ne se peut percevoir lui-même, sinon au travers de ses effets de sens.
Je le répète : la structure peut penser ses productions et ses Objets d'investissement, mais elle ne peut se penser elle-même.
Aujourd'hui, le modèle informatique me paraît plus propice à nous éclairer sur la question du fonctionnement du cerveau que celui que semblait révérer Lacan de la cybernétique, car le système ordinateur reproduit, à une fonction-près - celle de la conscience comme phénomène interne au système organisateur/analyseur - la physiologie du système nerveux. Notamment pour ce qui concerne la question de la mémoire et du rappel de l'information. Le micro-processeur fonctionne exactement comme un neurone cérébral : comme un accumulateur d'informations. Là où la machine cybernétique (comportementale) est affairée à résoudre la question de l'autonomie d'énergie, de l'analyse des obstacles et de l'action adaptée, la machine informatique est occupée à mémoriser, trier, organiser et interconnecter les flux d'informations. Probablement la synthèse des deux machines donnera, si ce n'est déjà fait, des robots réellement intelligents.
Contrairement à ce que l'on aimerait bien croire, l'intelligence n'est pas le propre de l'homme; et réunir l'acte et la pensée dans une machine n'est plus une utopie. Restera à résoudre la question du Sens et du Désir (où s'initie précisément la pulsion métamorphique), et pour finir à recréer l'Olympe.
Mais cela nous écarte de notre préoccupation autour de la question du rapport au corps et entre les corps dans l'espace analytique.
Honoré Grissë
Peut-être le cours même de notre entretien se heurte à une résistance de la matière à définir concrètement, à savoir: la question de la communication corporelle instaurée comme modalité langagière dans l'espace de séance analytique/thérapeutique. Comme si se vérifiait cette contradiction qui vous est opposée que quand on touche le corps, on ne peut plus rien savoir en dire ("Le toucher" Revue Scalène).
Guy Lafargue
Oui, mais seulement si l'on restreint le dire au langage parlé, ce qui est évidemment le cas dans le travail d'élaboration théorique. Il y a un tel tabou sur cette question de la communication corporelle dans le travail analytique! Vous remarquerez que je ne dis pas de relation corporelle, mais de communication. La très problématique question est en effet celle de la distinction entre processus primaire et processus secondaire, quels que soient les plans de l'expérience sexualisée affectivement engagés dans la relation thérapeutique : symbiotique ou oedipien. Il ne s'agit, bien entendu, en aucun cas de satisfaire aux pulsions sexuelles incestueuses ou aux impulsions destructives du client, mais d'autoriser le libre jeu des manifestations affectives dans la représentation de corps. Je suis absolument convaincu et déterminé sur ce point, que, sans le déploiement complet de ce jeu affectif, qui inclue la satisfaction affective mutuelle du client et du thérapeute, aucune ouverture maturante n'est possible. Je voudrais illustrer cela d'un exemple à mes yeux significatif.
Au début de sa thérapie, à chaque séance, Erynie, d'entrée de Jeu et après quelques minutes de prostration silencieuse, rentrait dans des états de violence incoercible extrême : d'abord dirigés contre les objets, les murs, l'ornementation de mon cabinet, qu'elle tentait de mettre en pièces; puis contre moi, lorsque je m'opposais à son travail de destruction, en tentant de me griffer, de me mordre, d'arracher mes lunettes. Je ne vous dis pas les intenses émotions que j'ai traversé à certains moments, pris dans d'évidents éprouvés de haine ou de sadisme; ou d'une angoisse de mur. Je vous jure que dans ces cas-là, on n'a pas le temps de s'interroger pour savoir si on est dans l'éthique ou dans la perversion, ou pour évaluer quel type de réponse ou d'exercice serait pertinent à proposer, ni même à chercher la bonne interprétation. Moi, passé un certain seuil de tolérance, je me décrétais en légitime défense et je mettais le paquet du coté de la contenance. Très rapidement, je tentais de la maîtriser dans un corps à corps que ma supériorité physique pas toujours évidente, tournait finalement à mon avantage, et qui se prolongeait par une rupture de résistance sous la forme d'un accès émotionnel d'intense souffrance; puis, pour terminer, par une régression "adhésive" contre mon corps, moi-même enveloppant le sien avec mes bras. Ou bien elle se roulait en boule contre moi sous un édredon.
Ce n'est qu'au bout de cet épuisant processus qu'Erynie pouvait accéder à un état de détente et d'ouverture de la parole. Vers le 6° mois de la thérapie, sans que rien ne le laisse présager, Erynie est arrivée en séance avec une poche en plastique qu'elle a posé prés d'elle. Après une lutte particulièrement intense, elle a pris la poche et a sorti un biberon et une boîte de lait en poudre "1er âge", et elle m'a demandé de lui faire un biberon. Ce que je suis allé faire. Et je le lui ai moi-même donné. Elle l'a bu pelotonnée contre moi, exactement comme un bébé, retrouvant ce mouvement de rouler ma barbe entre son pouce et son index. Parfois, elle est corporellement traversée par une décharge hallucinatoire. Et lorsque je lui demande de me faire récit, elle me dit, cette fois-là, qu'elle s'était vue enfermée dans la tétine du biberon, ce qui, ma foi, est une bien belle métaphore.
Tout ce travail du transfert, indissolublement affectif/corporel, renvoie aux dépôts phantasmatiques des mauvaises parties du Soi dans le corps maternel, et aux intenses conflits liés à la sphère de l'oralité la plus archaïque vécue comme persécution: de la bouche ("ma bouche est dangereuse!", "il faut tuer ma bouche!", "Arrache ma bouche"),) et des orifices sensoriels (les bruits vécus comme pénétration par des corps étrangers: "ferme mes oreilles!"). Lorsque ces épisodes ont été conduits à terme, Erynie est enfin paisible, et elle parvient à évoquer certaines scènes de sa petite enfance; à aborder les difficiles et sporadiques sentiments de haine envers sa mère, ou à prendre conscience de la similitude entre certains de ses comportements, qu'elle perçoit avec précision (et une certaine terreur) comme discordants (c'est des fous qui pensent ça ! ), et ceux des enfants autistes dont elle s'occupe professionnellement.
Je pourrais illustrer mon propos avec cent exemples aussi convaincants où la communication corporelle est dictée impérativement par un agir corporel du client qui s'offre comme signifiant de dernière instance, c'est-à-dire en deçà duquel aucune formation représentative n'est possible parce que c'est la matrice affective elle-même qui vient, en quelque sorte, se constituer prisonnière, offrir sa reddition au thérapeute.
C'est vrai que, d'une certaine façon, comme on m'en a parfois fait reproche, on pourrait très bien dire que parvenus à ce stade de la communication archaïque, nous ne sommes plus dans le langage mais dans un phantasme auquel le thérapeute donne sa caution en tant que fragment du réel. On peut toujours le dire, mais ce serait, à mon sens faire comme si le phantasme n'était pas déjà langage: embryonnaire, certes, mais tout de même et pleinement langage.
Moi, de toutes façons, je sais que ce qui est joué là fonctionne pour moi comme langage, et que c'est grâce à ma propre capacité de constituer cette expérience (abolitionniste du moi) en une pensée, puis en une métacommunication restituée à Erynie, que celle-ci peut à son tour commencer d'ouvrir un espace psychique personnel qui lui fait défaut ( où le jeu des représentations permette le décollement du réel ). L'objection qui m'est faite du "ne plus rien savoir en dire si l'on touche" n'est qu'une énonciation fantasmatique révélatrice de l'inhibition induite par le tabou psychanalytique lui-même.
Honoré Grissë
Dans ce que vous rapportez, il me semble que l'on peut difficilement soutenir la notion de "médiation corporelle"; de même que celle de "médiumnité". Ce que vous décrivez évoque la symbiose, c'est à dire la dissolution de l'aire intermédiaire de représentation où peut seulement se jouer, selon la psychanalyse, le travail analytique.
Guy Lafargue
Ce qui est placé en position tierce, c'est mon propre processus de penser les mouvements issus du fonctionnement de la dyade que je forme avec mon client (en tous cas dans les moments cruciaux de l'analyse). C'est ce qui vient se réfléchir dans mon propre espace de pensée qui vient faire scansion, scissure, dans l'expérience affective fondamentalement satisfaisante et angoissante de la symbiose. C'est d'ailleurs pour cela qu'à certains moments Erynie veut "arracher ma bouche". Elle exprime très clairement que l'on ne doit pas dire ces choses-là"; que ma bouche à moi est dangereuse; qu'elle va "tuer ma bouche". Et l'expérience me montre que ce qui joue chez moi - l'élaboration psychique de l'expérience - opère aussi chez mes clients, dans la séance, et beaucoup plus encore dans leur réalité quotidienne.
Alors, sur cette objection qui m'est faite comme quoi "vous c'est le corps, nous c'est le langage" je pense qu'il y a une résistance à y aller voir de plus près au "toucher".
Moi, je suis maintenant convaincu que même les formations affectives les plus archaïques viennent faire forme; mais que les psychanalystes qui ont le nez dessus, qui ont même inventé le concept qui en rend compte, ne le perçoivent pas en tant que forme, en tant que figuration de dernière instance : le transfert. Le transfert est la forme manifeste de l'affect (inconscient). Et ce qui fait obstruction en tant que prise en compte du transfert comme langage, c'est le précepte freudien comme quoi il faut que Ça se représente obligatoirement en mots. Si cela veut se représenter en autre chose qu'en mot, cela est disqualifié par avance comme résistance. Moi, dans mon travail, je ne fixe pas du tout cela, l'analyse du transfert, comme visée du travail. Je consacre toute mon intentionnalité thérapeutique à permettre l'engagement de la formidable masse énergétique réveillée par le transfert dans l'ouverture d'un Jeu créateur. Et cela est à l'évidence possible. Et cela a, ensuite, des effets de mots et de parole.
En ce moment, il y a quelque chose qui me travaille dont je cherche la sortie, relativement à la question du rôle que Freud assigne à la représentation de mot. Je suis en train de méditer ça, que je découvre. Et il me semble que cela a à voir avec ce que BION décrit comme la fonction Alpha, comme d'une sorte de réalité interstitielle, comme un interface entre le plan, pour Freud, de la psyché inconsciente, et celui de la conscience. Comme s'il y avait un organe charnière, le préconscient, qui convertirait de l'amorphe en forme perceptible. Et pour Freud, il semble que ce soit de la transformation d'éléments psychiques inconscients en représentations conscientes grâce à la représentation de mot qui accomplirait cette transmutation. Il semble que pour Freud la conscience est une "qualité" présente ou absente, coalescente aux faits psychiques.
Moi qui ne crois pas en l'existence de quelque chose qui existerait psychiquement et qui serait clivé de la perception, je fais l'expérience du processus inverse: à savoir que la parole, la représentation de mots, advient comme effet de sens (de ressenti), en aval de l'expérience expressive et non l'inverse.
En tous cas, je suis convaincu que pour certains sujets, la visée directe de faire produire "l'appareil à parler" est un non-sens. Ce qu'ils appellent l'appareil se met à penser lorsqu'il est placé en position de jouissance. Jouissance qui appartient à l' aire de représentation affective et non à celle de la satisfaction instinctuelle (qui est l'objet légitimement visé par le tabou). La psychanalyse érige ici ce qu'il en est de son fantasme du désir incestueux de l'analyste mis en danger de passage à l'acte, comme réglementation maniaque du fonctionnement analytique pour tous. Ils s'en tirent avec la parole.
De la médiation
Honoré Grissë
Dans le fond, cette question de la médiumnité autour de laquelle nous évoluons pourrait se ramener à trois modalités opératoires: celle de la médiation créatrice; celle de la communication affective libre, et celle de la résonance psychique empathique du thérapeute:
- d'une part vous dissociez les deux processus de l'expression et de l'organisation langagière. Vous nous dites que l'expression est un mouvement qui part directement de l'affect (et non de la psyché) et qui est susceptible d'utiliser différents modes de formulation (émotionnelle, corporelle, poétique, plastique, verbale, onirique, théorique, voire institutionnelle ...);
- et d'autre part, vous accordez à ce que je serais tenté de nommer le pouvoir poétique du psychothérapeute, la place privilégiée de partenaire de jeu psychique du client. Vous utilisez d'ailleurs dans un de vos articles la notion d'"inconscient auxiliaire" qui me semble à la fois proche de ce que les psychanalystes appellent l'attention flottante", et distinct quand à ses modalités d'utilisation.
Guy Lafargue
Oui. J'ai souvent eu ce débat au sein de notre institution, notamment avec Jean Broustra, débat sur lequel nous avons, me semble-t-il des positions conflictuelles. Je l'ai eu à propos de savoir comment, dans nos brochures, nous devions nommer la chose : "Ateliers Thérapeutiques d'Expression", "Ateliers Thérapeutiques d'Expression Créatrice"... Lui, à un moment donné disait systématiquement : " Ateliers Thérapeutiques à médiation Expressive". Je n'étais pas du tout d'accord avec cette dénomination parce que je pense avec force que le processus expressif advient justement lorsque tout recours à une médiation est abandonné. Le statut de la médiation, ici, est celui d'un auxiliaire, d'un vecteur permettant le déclenchement de quelque chose qui, lorsque cela se produit, traverse l'expérience de façon non médiate, brute, d'une décharge affective pure, directe, essentiellement engagée dans le corps et le système émotionnel, avec, dans un second temps de puissants effets de résurgence mnésique.
J'affirme en effet que le concept d'Expression, dans ma ligne directrice de travail en tous cas, n'est pas auxiliaire, mais axial. Cela signifie très concrètement pour moi que l'expression affective dans le langage est la visée centrale de ma proposition thérapeutique; et que le travail de la formulation médiatisée, de l'organisation langagière de l'affect dans l'investissement des média de la création, est la médiation. C'est cela, pour moi, l'expérience créatrice. Et c'est une des raisons, je crois, pour lesquelles je n'ai pas besoin de circonscrire les modalités de l'expression à la fonction psychique et verbale: parce qu'elles sont considérées ici seulement comme l'une des modalités créatrices parmi d'autres de l'accès à l'expression affective médiatisée. Cette nuance, que l'on pourrait qualifier de radicale, tient je pense, à l'inscription fondamentale de Jean Broustra dans le réfèrent psychanalytique où lui opère comme psychiatre, ce qui est bien de l'ordre d'une différence entre nous (et non d'une divergence); et de son élection de la psychose en institution hospitalière comme terrain clinique de déploiement créateur de son engagement de thérapeute. Cela veut dire que dans le réfèrent psychanalytique, c'est l'attelage de la Parole et de la Trace qui est placé en position de signifiant-maître, alors que pour moi, c'est celui du Jeu et de la catharsis créatrice. Mais je crois que dans la réalité de notre fonctionnement, chacun de nous épice librement sa pratique des condiments qu'il affectionne, et que c'est justement cela - le plaisir pris à la communication thérapeutique - qui constitue la clé du processus d'évolution positive de nos clients.
Alors, pour conclure sur ce point, et parce que Jean Broustra est un mordu de l'Expression, nous avons établi un pacte dialectal, et nous avons appelé notre Objet: "Ateliers d'Expression Créatrice à visée Thérapeutique". La dimension du verbe y est pleinement prise en compte, c'est même cela qui spécifie la dimension inhérente au pacte thérapeutique, mais elle n'est pas instituée, ici, en règle fondamentale, ni comme unique modalité de la Parole. Nous avons fait chacun une part de chemin, qui n'est nullement de l'ordre du compromis, mais plutôt de l'ordre de de la synergie heuristique engagée à partir de la désignation mutuelle des points aveugles où nous reconnaissons à l'autre une compétence fraternelle. De ce coté-là, il a eu beaucoup plus de travail que moi...mais pas au même endroit où l'a placé mon engagement de praticien border-line, travaillant avec des sujets border-line, dans une stratégie thérapeutique du passage-par-l'acte.
Pour en revenir à votre question, je ne pense pas que l'expression vienne de l'affect. L'affect n'est pas un centre d'énergie, ni un épicentre tectonique. C'est un point virtuel. Lorsque je parle d'expression affective, c'est une manière de prendre en compte l'infrastructure qui détermine la forme et l'intensité pulsionnelles attachées aux manifestations instinctuelles. C'est peut-être cela que je comprends comme étant la notion lacanienne de "signifiant".
C'est comme s'il y avait un logiciel de base - organisateur de la réception des informations internes et externes, et de l'émission des messages moteurs complexes - qui configure la pulsion (et pas seulement la pulsion: il configure aussi la matrice psychique, ce lieu virtuel, cet organe du Soi où les images se forment à l'adresse de la perception).
Ce logiciel est lui-même programmé par les premiers modes de relation au monde et de satisfaction instinctuelle connus par le nouveau-né. Et mon idée, c' est que le travail thérapeutique s'exerce précisément au niveau de ce logiciel-base. C'est son mode initial d'"être-au-monde" qui va être bouleversé et re-structuré sur d'autres bases, dont le sujet va faire l'expérience dans la relation thérapeutique/analytique, parce qu'une variable constituante va soudain et brutalement placer en porte-à-faux l'organisation rigide des signifiants. Et, selon moi, la source de cette rupture, c'est l'augmentation brutale de l'intensité instinctuelle originaire (ressentie comme une intrusion extrêmement angoissante), habituellement recouverte par une armature défensive plus ou moins solide, sous l'effet d'une rencontre singulière. Dans cette rencontre le sujet configure une image de l'autre qui devient personnage imaginaire, un Objet affectif/psychique extrêmement puissant, auquel il attribue projectivement les qualités de premier objet satisfaisant.
Le Soi ne renonce jamais à trouver l'Objet satisfaisant fondamental. C'est cela que Freud a inventé/découvert et à quoi il a donné le nom de transfert. Et c'est cela qui est à l'œuvre aussi bien dans l'état amoureux, à plus forte raison dans la passion amoureuse, que dans cet attachement archaïque très particulier qui se déploie dans le travail analytique. Et si l'on veut bien accepter de considérer l'état amoureux comme cette explosion et ce déploiement spectaculaire de l'attachement infantile originaire à la mère, on comprendra sans peine la violence que constitue la position de l'analyste pour le sujet, surtout lorsque l'analyste possède les caractéristiques projetées sur lui.
Pour ce qui me concerne, je pense que c'est l'effet conjugué d'une configuration projective (génératrice d'une intense érotisation archaïque du sujet), autorisée par une configuration subjective du thérapeute/analyste (qui place celui-ci dans le double statut d'Objet imaginaire et d'Objet réel) qui possède la force suffisante pour produire la fission nucléaire des signifiants originaires à partir de quoi seulement s'ouvre une nouvelle configuration organisatrice, fondée sur le libre Jeu de la représentation instinctuelle et d'un fonctionnement psychique créateur et non plus aliéné. L'aliénation est inscrite dans la structure et non dans les effets de structure. C'est essentiellement pour cette raison que je n'accorde aucune prévalence particulière à la production psychique par rapport à d'autres modalités d'effets de la structure, émotionnelle ou poétique ou verbale. Et c'est aussi pour cette raison que je considère que beaucoup de ces techniques soi-disant thérapeutiques qui contournent soigneusement l'attaque créatrice de la structure ne sont que des prothèses comportementales. Parce que le processus de la fission nucléaire des signifiants n'est possible que si l'analyste accepte de renoncer à toute activité intentionnelle qui viserait les effets de structure et non la structure elle-même. Ce qui me semble être le cas chaque fois que l'on place en position de signifiant-maître l'un ou l'autre des sous-systèmes de la structure: l'émotion (comme dans la bio-énergie ou la thérapie primale), le soma, la psyché... ou même l'articulation de plusieurs de ces sous-systèmes entre eux. Cela constitue, à mon avis, une défense du thérapeute contre l'attaque nucléaire de son propre système affectif qui le placerait en danger de décompensation. Ce qui est aussi une façon de dire que, sous certains aspects, la fonction de thérapeute est une fonction compensatoire; et tout ce qui se présente comme technique et méthodologie thérapeutique, opère comme conjuration omnipotente de la désintégration affective. Comment peut-on désirer devenir thérapeute !
Pour ce qui concerne la deuxième partie de votre question, à propos de la part créatrice du thérapeute - l'inconscient auxiliaire - mise à disposition du sujet et de l'interaction analytique, je voudrais souligner que s'il y a bien là une parenté avec la pratique de l'attention flottante, il y a tout de même une différence fondamentale. L'attention flottante est une attitude abstentioniste, si je puis dire. Le psycho-analyste se sert de l'attention flottante pour laisser se construire les matériaux de l'interprétation qu'il livrera au moment opportun. Elle est un processus de pensée, à la manière d'une rêverie, placé en orbite des échanges affectifs actuels. Et l'analyste y applique son attention. On pourrait dire qu'il n'écoute pas le sujet, mais les effets de la sujétion sur sa propre production psychique. Cela est une des formes majeure de la médiumnité (et aussi de la disposition hystérique). C'est une processus d'interdépendance psychique. Mais ce n'est pas là, à mon sens, une aire de création. C'est une modalité de représentation passive. Avec cette mise à disposition de l'"inconscient auxiliaire" du thérapeute dans la communication comme partenaire du jeu inconscient du sujet, je pense que j'introduis une dimension créatrice interactive de nature différente, de l'ordre du Jeu, ce qui n'est pas le propos du procédé de l'attention flottante, quelque soit la richesse iconographique de l'activité psychique de l'analyste. Je suis absolument formel : rêver n'est pas créer. Cela n'a pas les mêmes effets.
Honoré Grissë
On pourrait pourtant dire que l'interprétation aussi se donne comme modalité interactive et créative du Jeu psychique entre analysant et psychanalyste. Il y a bien une aire de jeu et de communication dans la rencontre psychanalytique. Certes, le jeu y est instauré à l'intérieur d'une règle qui fait injonction dynamique aux seuls processus psychiques (comme médiation) et à l'énonciation verbale; et d'une réglementation implicite comme quoi ce qu'il en est du corps doit passer par la voie obligée de la parole et de l'imagerie psychique. Mais une fois cette règle du jeu posée, il me semble qu'il y a analogie de structure entre ce que vous instaurez du coté des modalités corporelles de l'interaction analytique et ce qu'il en est dans le cadre d'une psychanalyse.
Guy Lafargue
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là. La différence qualitative porte sur le processus du jeu lui-même. Le psychanalyste engage son travail associatif par devers lui, dans la solitude du fauteuil. Et même si l'on peut dire que le jeu interactif existe bien dans l'aire psycho-affective de leur rencontre, cela n'a pas les mêmes effets que lorsque le jeu se déroule dans la communication ludique directe, y compris dans ses dimensions corporelles. Dans la modalité qui est la mienne, l'interprétation est une construction mutuelle issue du jeu d'un ensemble d'affects dans le champ psychique et corporel , et non du jeu avec les seuls objets psychiques.
C'est bien évident qu'il y a des effets de corps dans une psychanalyse, mais leur caractère spectaculaire ne doit pas dispenser de garder la tête chaude. Ces effets se déploient sans aucun étayage sur le corps de l'autre, sur la matérialité sensuelle/sensorielle/motrice/f(ph)antasmatique de la rencontre tactile/kinétique. Le phantsme du corps de l'autre n'est pas son corps. Je suis persuadé que cela est opératoire pour des sujets dont la souffrance est structurée autour d'un trop-de-corps (celui de la séduction parentale oedipienne par exemple); ou bien d'une régression défensive contre les exigences de l'accession au symbolique qui oppresse une fonction psychique aux abois, prête à décoller et à s'affranchir de l'emprise des imagos. C'est peut-être pour cette raison que l'hystérie et la paranoïa constituent la terre promise de la psychanalyse. Mais lorsque la souffrance existentielle majeure du sujet est structurellement liée à l'absence du lieu de l'@utre, à la terreur de la forme, aux persécutions grouillantes de l'univers symbiotique, aux attaques internes des organes, il me paraît absolument nécessaire que le thérapeute engage sans réserve sa corporéité dans la communication analytique. Elle est le seul mode langagier empathique propre à ces zones critiques de la vie affective.
Et, probablement, la plus grande souffrance et angoisse pour un psychanalyste c'est probablement d'assister impuissant au glissement de sujets pressentis suffisamment étayés pour affronter le silence et l'abstinence, qui s'enfoncent dans une régression défensive et basculent dans la dissociation. Je pense que le maintien d'une position technique inflexible du psychanalyste, maintenue contre l'évidence, est, pour ces personnes, la véritable cause de l'installation de modes de défense psychotiques. Dans ce cas là, ce n'est pas le transfert qui est psychotique, comme on aimerait le croire pour pouvoir intégrer la culpabilité. C'est la structure analytique, c'est le cadre, parce qu'ils reproduisent les contours de la forme maternelle originaire terroriste. Ce que l'on appelle une psychose de transfert est assimilable dans le cadre de la séance si l'analyste accepte de s'y engager corporellement. A mon avis, il y a une part aveugle de la structure/psychanalyse , qui est formée sur le déni de l'originaire. Il y a probablement des psychanalystes qui font le voyage, qui ont opéré le décollement des tables de la Loi et de l'identification projective adhésive à l'Ancêtre idéalisé. Freud, d'après ce que je suis en train d'en découvrir, était probablement moins orthodoxe qu'on a bien voulu nous le faire croire.
Honoré Grissë
A vous écouter, j'ai le sentiment que pour vous l'analyste est opératoire lorsqu'il rencontre sa propre structure psycho-affective dans son client; que vous posez toute structure thérapeutique comme une modalité d'identification projective. Le thérapeute percevrait comme structure optimale du soin analytique, l'envers de sa propre négativité, l'empreinte de la faille fondamentale dont il est construit. Le thérapeute serait quelqu'un qui travaille projectivement sur son client pour surmonter ses propres conflits infantiles...
Guy Lafargue
Je suis convaincu de cela. Il y avait des raisons d'économie psycho-affective à inventer le dispositif de la psychanalyse en l'état où il s'est fixé. Et je crois que cela a été le cas de tous les inventeurs de systèmes thérapeutiques. C'est aussi pour cela que toute tentative hégémonique de définir un modèle leader universel est une pure sottise. La véritable question est de savoir comment moi, je puis être opératoire comme analyste/thérapeute si telle est la pente sur laquelle le destin m'a précipité (et la nécessité de gagner ma croûte et d'avoir une place gratifiante dans la société)? Le problème se complique pour ceux qui sont dans un processus d'identification mimétique avec la trouvaille du maître d'école. Essentiellement parce qu'un tel processus permet de faire l'économie d'effectuer sa propre figuration. Glisser ses pas dans les pantoufles du Maître, suivre les sentiers qu'il a ouvert sans décoller le nez de ses odeurs et de sa trace et des diktats qui lui échappent, dégénère vite dans la religion, l'ésotérisme et la logorrhée. Le problème est le même lorsque la figuration praxique/théorique est faite dans la contre-dépendance au système du Maître aimé/haï. La véritable provocation, c'est du lieu analytique lui-même qu'elle naît; des contradictions où nous place notre désir, notre imaginaire face à la souffrance, la notre en tout premier lieu, sans laquelle ce métier ne nous concernerait pas. En tout cas, il en est ainsi pour moi.
Les expériences de travail analytique que j'ai été amené à conduire ont eu comme point de départ l'espace de mes Ateliers d'Expression Créatrice. Pour tous mes clients, la demande d'un travail thérapeutique s'est déclenchée dans la structure groupale de l'Atelier d'Expression. Ils ont ensuite posé une demande de travail individuel avec moi. Pour certains d'entre eux l'utilisation des médiations a pu accompagner le travail thérapeutique et analytique. Pour d'autres, les niveaux de régression atteints dans le transfert affectif ont rendu totalement impossible toute autre médiation que la médiation corporelle, au moins pendant un certain temps. Par contre, dans tous les cas, l'investissement des médiations créatrices s'est fait hors des séances, notamment dans le champ professionnel, dans une position identificatoire créatrice. Ce fait que la demande analytique vienne en aval de la rencontre et non en amont, comme cela est probablement le cas la plupart du temps, pose en fait le transfert comme préalable à l'analyse et non comme effet de l'analyse. Dans mon cas, le client choisit réellement son thérapeute sur la base du transfert. J'ai le sentiment que cela a une très grande importance.
Si je dois rendre compte des processus à l'œuvre dans mon travail de thérapeute (je conserve ce mot tant que je n'en ai pas trouvé un autre qui n'ait pas la connotation médicale qui s'y est attachée), je dirai ceci:
- que mon action est explicitement centrée sur l'expérience affective actuelle manifestée dans le jeu intertransférentiel;
- que je sollicite activement l'expression, c'est à dire l'actualisation des mouvement affectifs actuels du sujet;- que cette expression est invitée à faire forme dans les langages de la création lorsque cela paraît possible;
- que j'engage avec le sujet un travail actif de métacommunication au cours duquel nous reévoquons ensemble les mouvements affectifs, émotionnels et psychiques qui se sont manifestés pendant la séance; et les résurgences événementielles de son histoire actuelle ou infantile. Et que nous tentons ensemble de relier ce surgissement aux autres moments du travail thérapeutique antérieur. Cela fonctionne comme une sorte de communication didactique, d'enseignement mutuel par l'expérience.
En fait, ce qui est interdit dans la situation de la cure psychanalytique orthodoxe, c'est l'expression affective non-médiate. La psychanalyse circonscrit l'aire de l'expression affective a deux modes de représentation : représentation psychique et représentation de mot, c'est à dire l'aire du pensable, à l'exclusion de tout autre mode. D'une certaine façon, les psychanalystes tiennent l'impensable pour inexprimable. Moi, je place l'expression affective non-médiate en position de signifiant-maître, et j' ouvre la rencontre analytique à une pluralité des médiations langagières, par où l'exprimé, justement devient pensable. C'est bien là la marque singulière de ce que j'appelle l'Expression Créatrice Analytique.
MONTETON le 1°Mai 1994
Des grumeaux dans le placenta
Des grumeaux
dans le placenta
Revue "Pratiques Corporelles" 1990
L' expérience créatrice
de l'affect à la représentation
GUY LAFARGUE
Essai sur la création comme processus liant la fonction psychique aux formations
affectives originaires et son utilisation à des fins éducatives, artistiques et thérapeutiques
@
..." Imaginons que l'on découvre que l'inconscient n'existe pas, que le refoulement est une pure illusion, que la pulsion est effectivement un mythe. Réalise-t-on que, dans ce cas, ce serait notre propre manière de nous penser, de penser notre monde, nos affects, nos espoirs, qui s'effondrerait ?"
Piéra Aulagnier
Questions aux analystes dans
"LES DESTINS DU PLAISIR"
@
Ouvrir ce débat sur l'acte créateur par une mise en doute déterminée de l'existence d'un inconscient psychique paraîtra bientôt naturel puisque, comme le@ sait intimement toute personne qui crée, la création authentique est un phénomène de pure conscience.
La Psychologie contemporaine a inséminé notre cortex culturel, et tenté de reconduire sur la scène scientifique, la croyance primitive en l'existence d'une entité supra-organique, autonome et non connaissable :" l'Inconscient ".
Au travers de la théorie et des discours, l'Inconscient nous est présenté comme une sorte de "corpus" de représentations soustraites à la perception, comme un système homogène de morphes psychiques, habituellement séparées des formes psychiques conscientes par un mécanisme de nature également psychique, le "refoulement". Selon la rumeur officielle, cet "appareil" est doué d'autonomie ; il est, de façon occulte, déterminant de nos conduites ; il est le siège de perturbations entre unités psychiques conflictuelles ; il est une source productrice de souffrance.
Dans cette représentation théorique, la partie inconsciente de l'appareil psychique global gouverne la production de la vie psychique consciente, dont elle est la partie immergée. Cet ensemble est organisé à la manière de couches géologiques susceptibles d'interpénétrations, dépendant du jeu des forces pulsionnelles et de la curiosité analytique des sujets humains.
L'Inconscient, cette fiction poétique qui n'existe pas, et que l'on rencontre pourtant dans l'expérience du rêve, dans les lapsus, dans l'expérience analytique et dans l'expérience créatrice, est un concept qui fonctionne comme croyance dans la langue, chaque fois qu'il est utilisé dans sa forme nominative.
Il est, bien entendu, indéniable qu'il y a des pans entiers de notre expérience vécue, affective, qui échappent à la perception du "Je". Aussi, l'utilisation adjective du terme "inconscient" reste-t-elle pertinente.
Personnellement, j'utilise le terme "non-conscient" pour désigner cet état d'a-perception où se trouve placé le "Je" vis-à-vis de la masse considérable d'expériences et d'informations de nature somatique et affective soustraites à la connaissance du "Je" pour autant tant qu'elles n'exercent aucune attractivité analogique avec l'expérience actuelle du sujet.
Dieu merci, la théorie de la Création reste à faire. Freud, qui a quand même été le Grand Saugrenu de son époque, le libertaire en pantoufles de la comédie médicale, n'a pas apporté grand-chose à la question de la Création. Il ne s'est intéressé, comme psychanalyste, qu'à ses manifestations les plus académiques les plus culturelles, qu'à ses effets de vitrine. La puissante expérience Surréaliste l'a laissé profondément hébété et hostile, probablement envieux vis-à-vis de la richesse onirique et esthétique étourdissante des créations de ces artistes furieux ; expérience qui allait pourtant faire exploser l'Art culturel du 19°/20° siècle et plonger l'expérience culturelle dans les chantiers subversifs de l'Imaginaire. Les Surréalistes, qui ne demandaient qu'à dérouler le tapis rouge sur les pavés de Paris et sous les pieds de Freud, ne reçurent de sa part que doute, mépris et dénigrement psychopathologique.
En définitive, Freud resta coincé dans le rôle de la vierge effarouchée et pudibonde, et il fourvoya ceux qu'il dénommait narcissiquement sa "horde sauvage" dans l'adipeux concept de "sublimation", encore rapiécé par les intégristes de ce temps-ci. Il a surtout commis un non-sens en prétendant confiner la Création dans le rôle ancillaire du lapsus, du rêve ou de l'acte manqué; comme matériau ponctuel dans une chaîne associative assignée à l'ultime fin de la remémoration des souvenirs.
Or, la création est un évènement de nature totalement différente, puisqu'au contraire de ces phénomènes passifs et obligés que sont le rêve ou le lapsus, la Création se présente d'abord comme un acte intégrateur exigeant, intentionnel, actif, vigilant et désiré, du champ de forces qui habite le sujet. Paradoxalement, la Création échappe au déterminisme mécanique de la mémoire
C'est toi ma p'tit'folie
"Les mouvements expressifs ne sont soumis dans leur essence à aucune autre finalité que de concrétiser du psychique. La tendance de toute Gestaltung est d'atteindre à une perfection de la forme. Son accomplissement implique que le mouvement créateur soit saturé du psychique dont il est l'expression"...
Hanz Prinzhorn
"Expressions de la Folie"
Conférence prononcée au congrès
de Psychanalyse de Vienne en 1921
Dès 1921, Hans Prinzhorn, musicien et psychiatre autrichien, au fait des théories freudiennes tourne le dos à trois conceptions réductrices de l'expérience créatrice :
- La conception psychiatrique qui assimile, à cette époque là, la production artistique au symptôme pathologique et qui débouchera sur le malencontreux et toujours actuel concept de " psychopathologie de l'expression".
- La conception psychanalytique qui, dans sa tentation d'explication universelle de la phénoménologie imaginaire, extrapole hors du cadre clinique qui est le sien un point de vue qui concerne les phénomènes à l'œuvre dans la cure. Cela aboutira, dans la théorie Freudienne, à ne voir dans l'œuvre créatrice qu'un matériau parmi d'autres dans la chaîne associative ; à déplacer l'attention du sujet : du processus sur l'œuvre elle-même ; à considérer que l'œuvre créatrice est chargée de transmettre un message à interpréter ; enfin, à considérer l'investissement créateur comme un processus de déplacement de l'investissement libidinal sur des objets psychiques (non sexuels par définition), conception qui trouve sa consécration dans le piètre concept de sublimation. Nous verrons ultérieurement en quoi, justement, l'acte créateur échappe à ces considérations.
- La conception culturelle de l'Art, qui verrouille toute tentative de poser la question fondamentale de la fonction de l'expérience créatrice, autrement que du point de vue formel ; qui fétichise l'œuvre au détriment du processus créateur ; qui privilégie les dimensions spectaculaires de l'expression créatrice au détriment de ses composantes spéculaires, qui entraînent l'artiste sur le toboggan mortel de la séduction et de la déchéance æsthétique.
@
En ce point de croisement de mon expérience de créateur et d'analyste/thérapeute offrant à mes clients un espace d'expression créatrice ; de mon expérience d'animation, depuis 1975, d'Ateliers d'Expression Créatrice à des fins de développement personnel et de formation de thérapeutes/ animateurs, il m'est devenu évident que l'Acte Créateur et les processus affectifs/corporels/ psychiques qui trament l'expérience créatrice, sont à considérer comme la métabolisation du système pulsionnel humain, dans sa dimension spécifique : la pulsion créatrice.
A mon usage personnel, je me suis forgé le concept de " PULSION METAMORPHIQUE" pour représenter le mouvement de la nécessité créatrice dans l'expérience humaine dans ses dimensions d'expression plastique, poétique, psychique et intellectuelle, qui constituent, à proprement parler, le champ de la création ; par différenciation avec la notion abstraite et instrumentalisée de créativité qui fonde l'humain dans l'échelle des espèces vivantes.
Ce qui fonde l'humain, c'est la compétence spécifique, co-extensive au développement du néo-cortex, à fixer et modeler les empreintes mnésiques, les traces sensorielles et les charges affectives dans des combinatoires langagières partiellement affranchies des exigences de l'instinct biologique, et des contraintes de l'environnement humain et non-humain.
C'est cette compétence qui constitue, à proprement parler, la fonction créatrice : fonction de "FORMATION DE FORMES" (la "Gestaltung" de Prinzhorn), de la "FORMULATION" (selon la terminologie d'Arno Stern), qui fonctionne par la substitution d'une cosmographie sensible/imaginaire à la réalité des phénomènes biologiques et communicationnels ; d'une méta-physique sur la physique organique (la physiologie). La visée de ce processus étant de permettre la présentation de l'affect à la connaissance du "Je" et la résolution satisfaisante des complexes affectifs dont nous sommes construits.
Dans cette disposition, lieu de l'opacité, de l'effervescence, de la division et du clivage, l'Acte Créateur sert à mettre en communication concrète, incarnée dans une forme sensible, l'expérience affective (non-consciente) et le "Je", lieu central de la perception (la "conscience"). Là où les formes imaginaires pures (psychiques) restent dans une perpétuelle volatilité, dérive, instabilité et relative indétermination, l'expérience créatrice vient faire condensation, œuvre, trace stable.
La Création est un processus de reconquête par le "Je" de l'histoire de son avènement. Elle est au service des forces profondes de l'organisme humain qui œuvrent à l'actualisation du Soi.
L'expérience créatrice suppose une ouverture sincère du sujet à l'exploration de ces zones opaques et violentes que sont les expériences originaires non-conscientes du manque, de la perte, des violences périnatales, de la douleur affective, des intenses plaisirs de la satisfaction, de ses excès... et des phantasmes originaires dont ces expériences, irréversibles, ont été génératrices. Cet extraordinaire privilège, la Création le tient de ce que s'y engage un rapport dialectique entre la souffrance affective (résiduelle), qui est, comme dans toute expérience analytique, réactivée, pleinement redéployée ET RESSENTIE ; et la jouissance actuelle prise par le "Je" : d'une part dans la décharge de l'affect dans le travail de la "mise en œuvre" ; et, d'autre part, dans la satisfaction liée à l'intégration d'éléments non connus de l'expérience originaire à la structure du Moi.
Comme l'a si bien exprimé Piéra Aulagnier, seules la qualité et l'intensité de la satisfaction procurée au "Je" par la connaissance et l'intégration d'éléments de l'expérience inconnus ou chaotiques permettent de comprendre que l'on puisse s'engager dans cette déraison que constitue une analyse thérapeutique.
Réfléchir sur la Création suppose donc que nous disposions d'une théorie de la dynamique liant expérience affective et formulations psychiques. Et, comme il paraît quand même, sur ce terrain, difficile de faire abstraction de la théorie métapsychologique freudienne, autant se situer vis-à-vis d'elle sur un certain nombre de ses hypothèses explicatives que l'on peut considérer comme des postulats aux fondements incertains, enkystés dans la conscience culturelle sous la forme de préjugés et d'arguties défensives :
- S'il y a bien des faits psychiques, ceux-ci n'ont pas d'existence en dehors du moment et de la durée de leur production par les plages corticales qui les forment dans le langage, et de différencier les évènements et les formes psychiques émergentes (que j'appellerai des "morphes") de leur mémorisation c'est à dire de leur constitution et persistance à l'état d'engramme, de souvenirs, c'est-à-dire de codage stable des ensembles neuroniques concernés par la le processus cortical de la mémorisation).
- L'illusion de la consistance et de la permanence des morphes psychiques tient à ce que l'instance qui perçoit, le "Je", ne discerne pas à coup sûr entre la morphe et sa trace mémorisée (la remémoration est un mécanisme mental de restitution des engrammes corticaux et non une activité à proprement parler psychique). Les souvenirs constituent une matière inerte, les morphes sont des unités vivantes, qui font flèche psychique de tout bois, y compris des souvenirs.
- C'est ce processus de superposition entre la morphe et son empreinte mémorielle qui est responsable de mécanismes confusionnels comme le délire, la projection, le transfert...
- Aucun phénomène psychique n'existe hors du champ de la perception. Tout ce qui se forme dans cette sphère se réfère à un état de conscience spécifique.
- Un certain nombre de formes psychiques acquièrent pour le "Je" le statut d'objets psychiques. En tant que tels, ils viennent s'inscrire durablement dans le jeu de la perception à côté des objets réels ; et parfois, comme dans la projection ou le délire, en place et au détriment des objets réels eux-mêmes.
- Il découle de cet état de fait que la notion de "conflit intra-psychique" est dénuée de signification. En effet, si conflit il y a, ce ne saurait être entre des représentations, qui ne sont que les manifestes terminaux, provisoires et instables de l'affect, mais entre les motions pulsionnelles et les résistances à leur actualisation qui composent cette entité virtuelle que l'on nomme le Moi.
L'illusion d'un conflit intra-psychique est créée par la présence contradictoire, dans le champ de la perception, d'objets psychiques incompatibles entre eux du point de vue de la logique du "Moi". Mais le conflit lui-même ne se forme pas dans la sphère psychique, dont la psychanalyse a justement démontré qu'elle était entièrement organisée autour de la non-conflictualité. - De la même façon, nous sommes tout à fait autorisés à invalider l'alliance des mot : "psycho-pathologie" et "souffrance psychique" (qui en est la traduction étymologique). A qui viendrait-il l'idée saugrenue qu'une image télé-visuelle "souffre"? Ce qui souffre, c'est l'organisme dans sa globalité ou dans l'un de ses ensembles organique. Le système affectif lui-même constitue l'une de ces parties originaires génératrices de l'expérience de la souffrance.
- Nous réintérrogerons enfin la notion de refoulement conçue comme instance psychique, fonctionnant à la manière d'une "douane" qui aurait pour mission de trier parmi les représentations inconscientes celles qui présenteraient une incompatibilité avec les représentations tolérées par le "Moi".
@
Une fois levées ces hypothèses heuristiques largement inspirées par la quête freudienne, il nous reste à définir ce que j'appellerai la FONCTION PSYCHOMORPHIQUE pour désigner cet ensemble de processus générateurs de formes mentales distinctes des processus perceptuels/mémoriels.
Cette définition repose sur la séparation de la fonction mentale en deux plans hétérogènes : le plan des phénomènes liés à la perception, à la mémoire et au rappel ; et le plan des phénomènes psychiques, libres de déterminations objectives, entièrement orientées par des inductions qui prennent leur source à la confluence de la pulsion, de l'affect et des résidus sensoriels.
C'est dans le jeu dialectique entre les degrés d'intensité de la mobilisation de la pulsion (tramée par l'affect) et la capacité du "Je" à intégrer l'émergence de l'affect (et de la pulsion qui innerve l'affect), sans risque fondamental de s'y abolir, que se forme l'extraordinaire aventure psychique, où se déploie ce que l'on peut appeler sans réserve la PULSION CREATRICE, qu'il me plaît à moi d'appeler la PULSION METAMORPHIQUE.
- La FONCTION PSYCHOMORPHIQUE est une fonction dynamique de combinaison/conjugaison d'éléments hétérogènes d'origine perceptuelle, émotionnelle et pulsionnelle.
L'émergence de cette fonction est probablement liée à l'apparition, dans la chaîne génétique des hominiens supérieurs, des structures néo-corticales appelées par les neurobiologistes "plages de convergence". Ces territoires corticaux ont pour caractéristique de recevoir des afférences en provenance de tous les autres territoires corticaux récepteurs, de nature sensorielle, motrice, émotionnelle et langagière. Il est important de comprendre que les stimuli qui arrivent dans ces territoires de convergence ne proviennent pas directement des organes sensoriels mais des centres nerveux eux-mêmes, et que la structure neuronique de ces "plages" est radiale et interconnectée. Ils ne sont pas, en outre, soumis à la barrière inhibitrice de l'action que constitue chez les humains le cortex préfrontal.
Du point de vue de la neurobiologie, il me semble que l'on ne peut faire une objection majeure à la théorie selon laquelle l'apparition de la fonction psychomorphique intervient (simultanément ou consécutivement) à un moment de l'évolution génétique où l'espèce hominienne est invalidée du côté des dispositifs instinctuels. - Les activités psychiques pures sont constituées par le rêve nocturne, la rêverie diurne, les images hypnagogiques, les phénomènes idéatoires déclenchés par les états de relaxation, les images médiumniques propres aux états de transe, les phantasmes originaires (proto-psychiques), les fantasmes primaires (de la période œdipienne), toutes les modalités sensorielles de l'hallucination et du délire ; et les diverses modalités de la pensée créatrice (artistique et intellectuelle).
- La visée "organismique" (pour reprendre la terminologie de Carl Rogers) du développement de la fonction psychique est l'élaboration des zones de l'expérience vécue, notamment de l'expérience originaire, inaccessibles à la perception du "Je". Elle est le lieu de transformation de l'affect (non-conscient) en représentation (assujettie au "Je").
Winnicott est, me semble-t-il, le premier à avoir postulé l'existence de ces zones de l'expérience affective originaire "impensables" ; de ces évènements " qui ont eu lieu, et qui n'ont pas trouvé leur lieu de représentation " (Lebovici, Préface au livre de Winnicott "Jeu et Réalité") dont le caractère non-conscient n'est pas lié, comme le postule la théorie Freudienne, au travail du refoulement, mais à ce que le "Moi" n'était pas encore en mesure de les intégrer (Winnicott : "La crainte de l'effondrement"). Winnicott privilégiait en particulier ce qu'il nommait " les états d'agonie primitive" comme prototypes de ces évènements inscrits dans l'expérience originaire qui n'ont jamais fait l'objet d'une élaboration dans le système du "Je".
Avec les recherches psychanalytiques de Piéra Aulagnier, nous allons pouvoir élargir le champ de ces évènements originaires centrés sur les intensités traumatiques ("agoniques") ; "érotiques", liées aux processus originaires de satisfaction, qui sont, de façon complémentaire aux premiers, à la base des affects. Et nous verrons, tout à l'heure, de quelle façon la PULSION METAMORPHIQUE se déploie sur ce territoire de prédilection de l'affectivité originaire qu'elle a précisément pour fonction d'élaborer sur la scène du "Je". - Le principe directeur de l'activité psychomorphique repose sur la représentation imaginaire des visées pulsionnelles (ou de leur altération) et sur le dépassement de la conflictualité à l'intérieur de l'activité psychique elle-même. Le système neurologique qui secrète l'activité psychique n'est pas, rappelons-le, relié en voie directe aux analyseurs sensoriels, mais aux "terminaux centralisés" de provenances corticales multiples. L'idée d'un aboutissement imaginaire des visées pulsionnelles n'est pas exactement superposable à la notion Freudienne de "principe de plaisir". Contrairement à la rumeur, je postule en effet que le plaisir n'est pas un but poursuivi par l'organisme (le "Soi") mais par le "Moi". Seule la satisfaction des besoins fondamentaux, dont le plaisir est un effet, peut être considérée comme une visée directrice de l'action dictée par le Soi.
Ce principe d'aboutissement pulsionnel dans la représentation ne saurait dont être opposé au principe de réalité puisqu'il en est une des modalités structurantes. - Le travail de conversion des morphes psychiques en objets psychiques stables place le "Je" en position de possible contradiction ou confusion. En effet, là où la création psychique intervient comme énonciation manifeste en réponse à une expérience affective actuelle, les objets psychiques sont susceptibles de venir substituer leur propre tissu résiduel de représentations familières au "Je", comme cela est le cas dans la perception délirante ou dans les phénomènes de transfert.
Au fond, il est tout à fait légitime de considérer que l'ensemble des "objets psychiques", résidus mémorisés de l'activité psychomorphique, constituent un ensemble doué d'un certain degré d'homogénéité vers lequel, en l'absence d'objet réel, se tourne le "Je" lorsqu'il rencontre un obstacle affectif. C'est cette structure que l'on peut à juste titre appeler la "Psyché".
Cette distinction entre "activité psychique créatrice" et "Psyché résiduelle" va revêtir une particulière importance lorsque nous aborderons la question de la psychothérapie ; et de l'accent que l'on mettra, selon l'école à laquelle on se réfère, soit sur l'analyse de la genèse et de la structure des "objets psychiques" (dans le processus de l'anamnèse) ; soit sur le Jeu et sur les processus créateurs et relationnels spontanés, comme cela est le cas dans les dispositifs psychothérapiques (ou de formation thérapeutique) que j'ai élaborés, en adéquation profonde, je crois, avec les orientations cliniques de Winnicott et de Carl Rogers. - Le processus inaugural du fonctionnement de la pensée créatrice (qui est une des modalités co-extensive à la formation du "Je") a été remarquablement décrit par Winnicott sous les termes de "PHENOMENES TRANSITIONNELS" .
Cette forme primitive de constitution de l'activité psychique permet au sujet humain, au travers de la constitution d'objets internes représentant les objets externes dont dépend sa survie biologique, de médier sa relation au monde. Le phénomène est suffisamment et universellement admis pour qu'il soit nécessaire d'y revenir en détail. Pour l'essentiel, je rappellerai les différentes étapes de la genèse de la fonction psychique :- Au cours de la période périnatale, l'intensité des expériences corporelles de satisfaction et de frustration, et les intenses sentiments d'amour et de haine qui accompagnent les paroxysmes du plaisir et de la douleur originaires génèrent les premières protoreprésentations que Suzan Isaac a appelées "PHANTASMES", terme auquel je me référerai par la suite (plutôt qu'à celui élaboré par Piéra Aulagnier sous le terme de PICTOGRAMME). Pendant ces temps chaotiques et bénis, le nourrisson est la proie d'une intense activité hallucinatoire placée sous le sceau de la symbiose, de la dévoration, de la persécution, de l'omnipotence... phantasmes qui constitueront la matrice affective des FANTASMES de la deuxième génération, liés à la sphère œdipienne.
- La période psycho-génétique suivante s'organise autour des phénomènes de dissolution de la relation symbiotique à la mère, de la résolution de l'omnipotence, de l'accès à la position dépressive et de l'individuation, c'est-à-dire de la mise en place de l'instance appelée "Je", à partir de laquelle s'ordonneront les modalités "objectives" et "subjectives" de la perception et de l'expérience créatrice.
Les processus "TRANSITIONNELS" remplissent cette fonction de la façon suivante :
- Dans un premier temps, le nourrisson sélectionne un ou plusieurs éléments sensoriels combinés émanant du contact au corps de la mère, auxquels sont associées des expériences de satisfaction : odeurs du corps, tissus des vêtements empreints de ces odeurs ; ou parties du corps propre...
- Dans les situations anxiogènes, le recours à ces "objets" doublement investis de sensorialité et d'affect provoque l'apaisement du nourrisson. Ils fonctionnent comme "image internalisée" de l'objet externe maternel.
- L'investissement simultané d'un de ces objets privilégié, par la mère et par le nourrisson, comme "signifiant" du lien d'amour et de sa permanence, va contribuer activement à développer chez le nourrisson une image stable et consistante de la mère, mobilisable au gré des tensions et des angoisses liées à sa disparition sporadique hors du champ de la perception du bébé.
- Dans un dernier temps, l'image interne prend le pas sur l'objet intermédiaire, qui est "oublié".
Winnicott, rappelons-le, fait de ce processus le prototype de l'expérience créatrice, en ce sens, justement, que le nourrisson passe au cours de cette épreuve du statut dyadique (symbiotique) au statut du sujet différencié. La création du DOUDOU en constitue la base stratégique. Tout au cours de cette période, c'est l'infrastructure même du fonctionnement psychique qui se met en place. Et le bébé qui ne parvient pas à effectuer ce travail de translation de l'objet réel à l'objet imaginaire, via l'objet transitionnel, a de fortes chances de rester fixé sur des modalités affectives de type narcissique (substrat de la position psychotique).
C'est au travers du jeu des phénomènes d'hallucination somesthésique/coenesthésique (qui constituent les protoformations psychiques) que vont se structurer les premières relations objectales que le nourrisson va établir avec son environnement humain et non-humain.
Ce n'est que lorsque cette transformation est terminée que le jeune enfant est capable d'énoncer une représentation du monde en première personne, c'est-à-dire de rentrer en dialogue avec une image dont il discerne qu'elle incarne son idéïté. C'est ce processus qui aboutira, à terme, à l'avènement du "Je".
@
Les démélées conjugales
de l'affect et de la pulsion
Certains concepts, dits, pour cette raison, opératoires, servent à décrire des processus observables dans l'expérience clinique. Ils offrent une sécurité analytique suffisante pour permettre au praticien de travailler avec confiance. Ils constituent les fondements de la théorie.
Certains concepts, par contre, sont de pures créations psychiques du théoricien, destinées à combler les intervalles opaques de la connaissance. Ils ont une valeur explicative hypothétique. Leur utilisation au sein du discours explicatif global reste légitime, à la condition que le théoricien, et le lecteur averti, gardent à leur sujet une attitude normalement circonspecte et dubitative. Dans le cas contraire, de provisoire et approximative, la pensée se fait croyance ; le discours se fait dogme ; l'attitude se teinte d'intégrisme ; et le groupe des élus s'organise sur le mode de la consommation totémique du Nom et des Œuvres du Père, avec le cortège de mauvaise foi, d'intolérance et d'organisation cannibale du pouvoir qui caractérise ces sociétés ésotériques.
Nous avons vu tout à l'heure comment il en allait ainsi avec la notion d'"Inconscient", qui a finalement remplacé dans la conscience culturelle scientiste la très religieuse notion d'âme.
Des deux concepts que nous allons examiner maintenant, celui de PULSION et celui d'AFFECT, nous allons essayer de tirer le meilleur parti. Cet apparent détour théorique est rendu nécessaire, pour la question qui nous occupe de la Création, à un double titre :
- d'une part, parce que dans les préludes de cette réflexion je pose la PULSION CREATRICE comme l'une des facettes, un des aspect du système pulsionnel qui singularise l'humain parmi les espèces animales ;
- d'autre part, parce que j'en arrive aujourd'hui à considérer ce que l'on appelle l'AFFECTIVITE comme étant l'ensemble des dispositions originaires qui établissent entre l'expérience et la perception une contiguïté infranchissable, celle là même qui est à l'origine de l'illusion de l'existence d'une instance psychique clivée dont la psychanalyse a pérennisé la croyance sous le vocable d'"Inconscient".
@
Mâleries de la pulsion
Etymologiquement, le terme "pulsion" désigne l'exercice d'une "poussée" : Ondes péristaltiques puissantes déclenchées par les hormones de l'accouchement qui poussent inexorablement le bébé hors de la matrice ; spasmes intestinaux commandés sur la base de signaux neurovégétatifs, qui expulsent la merde par le trou du cul qui se dilate ; pulsion génésique qui précipite le contenu des vésicules séminales dans le tendre et brûlant réceptacle à lui destiné...
A côté de ces "pulsions biologiques pures", dont la source et l'objet sont endogènes, on trouve des pulsions dont la source est endogène et l'objet exogène : l'agression orale de la bouche du bébé sur le mamelon turgescent de la mère (et, de manière générale, le comportement alimentaire) ; l'agression du mâle sur la femelle pour l'exercice du coït et les comportements sexuels. Voici tout ce que l'on peut dire de consistant sur les pulsions : qu'elles sont la matérialisation dans le corps et le comportement d'un travail hormonal et neuronal tourné vers la conservation de l'intégrité du corps et vers la perpétuation de l'espèce.
Lorsque l'excitation est exogène et l'objet exogène, l'orientation pulsionnelle va dépendre de l'analyse, innée ou acquise, des signaux liminaires au degré de menace encouru par le sujet. Du résultat de l'analyse, et de la précarité de la position du sujet, dépendra le comportement d'attaque ou de fuite de l'objet qui menace son intégrité.
Du point de vue de la neurobiologie et de la neurophysiologie, la pulsion est le résultat de sécrétions hormonales et neuro-transmettrices actives. Ceci écarte d'entrée de jeu toute conception de la pulsion, en tant que mécanisme basique, qui ne la représente pas comme orientée vers l'intégrité, la continuité, la réalisation des potentialités, l'adaptation et la survie de l'organisme dans son environnement humain et non-humain. En particulier, cela disqualifie une fois pour toutes, espérons-le, l'obscène concept Freudien de "pulsion de mort". A ce sujet, il serait pertinent de parler d'"impulsion suicidaire", c'est-à-dire d'un comportement (et non d'une pulsion) dans lequel la prégnance de la souffrance affective et des objets psychiques persécuteurs prend le pas sur la perception du réel, et prive le sujet de toute capacité "immunitaire".
C'est dire ici qu'une des caractéristiques majeures du destin des pulsions est d'être marqué irrémédiablement du sceau des affects originaires, de ceux précisément dont la perception directe est définitivement occultée au "Je".
@
Les femelleries de l'affect
Celle-ci est la réflexion centrale : de la compréhension de la nature, de la genèse et des modes de manifestation de ce que nous appelons l'affectivité dépend en grande part la compréhension des dynamismes sous-jacents à la vie psychique ; et la détermination de nos options techniques dans le domaine de la psychothérapie, ou du développement de la créativité.
La notion d'affect reste, dans le vocabulaire de la psychologie contemporaine, une notion floue, reliée avec imprécision au système de la décharge émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas purement et simplement assimilée à l'émotion. Il est à mon sens tout à fait important de bien signifier que le système émotionnel est un "système" physiologique homogène, qui possède une fonction régulatrice et immunitaire fondamentale, même si par ailleurs, comme l'ensemble des systèmes neuro-hormonaux, il est susceptible d'être perturbé par les condition-nements affectifs.
La compréhension de l'organisation affective passe par la théorie de la mémoire et du codage des informations dans les ensembles neurologiques, hormonaux et musculaires. Nous savons aujourd'hui que l'image de la mémoire comme "réservoir" de souvenirs est inadéquate à décrire les processus mnésiques. L'inscription, provisoire ou durable, d'une information dans le système nerveux, résulte d'un codage particulier des acides aminés et des enzymes constituants du noyau neuronique, et de la modulation des agents neuro-transmetteurs. Ces ensembles bio-chimiques et bio-électriques sont directement soumis aux conditionnements hédoniques ou nociceptifs (renforcement positif et négatif). Il ressort de ceci un certain nombre de choses extrêmement importantes pour notre propos :
- La première, c'est que la remémoration n'est pas un processus psychique, mais un processus mental lié au travail de synthèse des colonnes cellulaires concernées par une unité mnésique (Apprentissage et mémoire : Delacour, 1989);
- La deuxième, c'est que le "refoulement" est lié au verrouillage biochimique du travail de synthèse des ensembles cellulaires imposé par un conditionnement nociceptif. Nous disposons d'un modèle neurologique pour expliquer ce phénomène, que l'on appelle les "boucles auto-régulées" : certains neurones possèdent des dentrites (efférents du corps cellulaire du neurone) dont la synapse est directement reliée au corps cellulaire du neurone émetteur (afférent). L'activité sécrétionnaire de la dendrite est programmée pour déverser des messagers chimiques inhibiteurs (recapture de la sérotonine dans le processus de la dépression par exemple) lorsque certains signaux (analysés comme menaçants pour l'intégrité) apparaissent dans le circuit. C'est cette inhibition du travail de synthèse des molécules du corps cellulaire (dont l'organisation est "codée" de façon stable dans des ensembles neurologiques solidaires) qui constitue ce que nous appelons le refoulement qui n'est autre qu'un trouble du "rappel" par inhibition de la synthèse des constituants biochimiques du souvenir (Delacour, "Apprentissage et mémoire : une approche neurobiologique", Masson, 1987).
- La troisième, que la théorie du conditionnement de base des unités cellulaires s'applique à l'"enregistrement" des expériences globales, notamment des expériences originaires vécues par le nourrisson ; qu'elle s'applique également aux ensembles comportementaux complexes que le sujet traverse sous le non d'"éducation".
- La quatrième enfin, que le système pulsionnel lui-même est "affectable" par voie de conditionnement, en particulier lors des premiers échanges néo-nataux.
@
Les deux déterminants fondamentaux du codage organique de l'information que l'on appelle l'"affect" sont : le plaisir, en tant qu'effet de la satisfaction des besoins vitaux ; et la douleur en tant que marque d'une menace contre l'intégrité de l'organisme.
Les affects "hédoniques" ont pour effet d'ouvrir l'organisme aux échanges avec l'environnement ; les affects nociceptifs ont pour effet de les rétrécir, voire de les éviter ou de les empêcher.
Le lecteur attentif aura compris au terme de ce parcours que je dessine une théorie dans laquelle pulsion et affect existent de manière monolithique. Pas plus qu'il n'existe de pulsion "pure", il ne se peut "isoler" d'affect. Ce qui existe, c'est un alliage compact de l'énergie pulsionnelle orientée, tant au niveau de l'intensité que de la qualité, par des expériences affectives déterminantes, à quoi il convient, en dernier ressort, d'ajouter les remaniements introduits par l'élaboration imaginaire que le sujet impose à l'expérience des fonctions corporelles. La notion de "MOTION PULSION-NELLE", créée par Freud, pourrait à mon sens tout à fait servir à désigner ce qu'il en est, dans l'expérience, de cette "fusion" de l'affect, de la pulsion et de l'élaboration psychique des fonctions instinctuelles.
@
Le bal des mnesies originaires
Un autre voile reste à soulever sur l'épineuse question qui a traversé un siècle de Psychologie, qui prend son origine dans les observations de Freud concernant l'"amnésie infantile". Freud situe son origine dans la tentative d'effacement de la sexualité infantile par le refoulement de ses représentations dans l'Inconscient (le "réservoir").
Quoi qu'il en soit du destin de cette explication, nous sommes en mesure aujourd'hui de définir un champ d'expériences "inconscientes" qui ne procède pas du refoulement, mais d'un autre mécanisme qui lui est antérieur, et dont la théorisation a été faite par Winnicott dans un article intitulé : "La crainte de l'effondrement" (Nouvelle revue de Psychanalyse, n° 11). J'ai consacré un long développement à cette analyse dans une conférence prononcée lors du congrès des psychomotriciens (Paris 1989 "De l'énonciation plastique à la représentations psychique", Revue "Thérapie Psychomotrice, (n° de Janvier 1991) à laquelle je renvoie le lecteur. Pour l'instant, j'en résumerai les aspects essentiels :
- Winnicott montre qu'un certain nombre d'expériences affectives périnatales, "originaires", n'ont pu être intégrées à la structure du "Moi" dans la mesure où celle-ci n'est pas encore suffisamment cohésive.
"Dans le contexte dont je parle, l'inconscient (qui n'est pas l'inconscient de la formulation Freudienne) signifie que l'intégration du "Moi" n'est pas en mesure d'absorber quelque chose. Le "Moi" est trop immature pour rassembler tous les phénomènes dans le champ de la toute-puissance" (art. cit.p.93). - Il fait en particulier référence aux événements affectifs qu'il appelle les "agonies primitives", c'est-à-dire des expériences de souffrance subjectivement ressenties comme menace de mort par le nourrisson, qui ne donnent lieu à aucune possibilité intégrative, car l'instance percevante, le "Je", n'est pas encore formée. Le "Je" constitue le logiciel indispensable à la saisie et à l'interprétation des informations.
- En l'absence de ce "Je", le nourrisson n'existe pas de manière différenciée. Il est "engobé" dans la dyade originaire, et, comme le dit Lebovici (préface au "Jeu et réalité" de Winnicott), " quelque chose a eu lieu, qui n'a pas de lieu", qui n'a pas trouvé son lieu de représentation". Cette géniale intuition va nous permettre de comprendre le rôle fondamental de l'expérience créatrice comme offrant cet espace/temps privilégié où vient prendre forme l'"impensable originaire".
- Nous retrouvons la même analyse chez Piéra Aulagnier qui va élargir le territoire des premières formations d'affects aux expériences hédoniques. C'est dans son ouvrage "La violence de l'interpréta tion" que Piéra Aulagnier précise le caractère "inconnaissable" de " l'originaire" (terme générique qu'elle substitue purement et simplement au terme d'"Inconscient").
- Pour désigner cette réserve d'expériences originaires soustraites à la connaissance du "Je", j'ai proposé dans deux articles récents d'utiliser le terme de "MNESIE" ("Théorie mon amour", revue "Pratiques Corporelles", n° spécial Winnicott ; et "Thérapie Psychomotrice", n° de janvier 1991 : http://www.art-cru.com/textes-theoriques/articles-du-cru/theorie-mon-amour )
Les MNESIES sont les engrammes neuro-somatiques actifs d'évènements bruts enregistrés de façon stable par l'organisme, mais dont l'incrustation, en l'absence d'un mode d'organisation de l'information (le "Je"), n'a abouti ni à une configuration interprétable, ni à la constitution d'objets psychiques stables , puisque la fonction psychique n'est pleinement opérationnelle et mobilisable que relativement tard dans le développement du nourrisson (probablement à partir de ce seuil d'irréductibilité, où bute la psychanalyse, de l'amnésie infantile).
La caractéristique majeure des mnésies réside dans leur tendance active permanente à générer des représentations : soit sous la forme de scénarii psychiques (dans le rêve ou dans le fantasme) ; soit sous forme corporelle/psychique (dans le travail de la Création) soit sous la forme de symptômes.
Les mnésies sont donc des structures distinctes de celles des souvenirs inhibés. Elles forment la strate primitive constituante de l'expérience affective, et elles sont le creuset de la formation des phantasmes originaires, autour desquels l'activité psychique prendra son essor.
Le point dynamique majeur, tiré de l'expérience clinique, pour comprendre le potentiel subversif de l'acte créateur, c'est que l'effraction créatrice réussit là où les dispositifs psycho-analytiques fondés sur l'énonciation verbale échouent : à savoir, la pénétration des formations mnésiques originaires, directement productrices d'œuvres, et secondairement d'élaboration psychique.
C'est cette tendance active du noyau originaire constituant l'expérience fondamentale du sujet humain que Carl Rogers appelle " la tendance à l'actualisation du Soi" ; que Harold Searles appelle "la tendance thérapeutique" ; que j'appelle moi-même la "pulsion métamorphique".
C'est sur cette tendance fondamentalement dynamique et positive que nous allons nous appuyer dans la "psychothérapie expressionnelle à médiation créatrice" ; et dans l'éducation de ce précieux outil de développement de l'être humain qu'est la créativité.
@
Les voix du saigneur
sont pénétrables
Il me reste à dessiner le schéma d'intelligibilité qui va nous permettre de saisir la nature profondément subversive du processus créateur.
La théorie globale que je forme des processus psycho-génétiques et des dispositions psycho-analytiques repose sur les bases suivantes :
- L'avènement de l'expérience existentielle primitive est doublement marqué (et de manière irréversible) par la qualité du travail parturient, et par les degrés d'intensité des souffrances primales traversées par le fœtus à l'occasion de la naissance ; ainsi que par la qualité des premiers modes d'échanges du nouveau-né avec son environnement néo-natal, notamment par la qualité des processus de réparation affective et de restauration symbiotique proposés par la mère.
- Selon la qualité des opérations précédentes, l'organisme nouveau-né va développer un mode d'être-au-monde et d'investissement objectal organisé entre deux polarités affectives : la confiance instinctuelle qui ouvre le champ à la relation symbiotique et narcissique ; et la défiance instinctuelle qui resserre l'organisme nouveau-né sur des modalités persécutives, qui sont susceptibles de déployer chez le nourrisson les composantes "haïques", destructrices, hallucinatoires et/ou autistiques.
Il est important de noter à ce sujet que si certains comportements maternels post-nataux sont susceptibles de favoriser ces modalités destructrices, celles-ci peuvent aussi se développer de façon totalement indépendante d'un réel amour maternel, comme réaction à des souffrances subjectivement ressenties comme excessives par le nouveau-né. - Les premières formations de "phantasmes" sont co-extensives au développement des premières expériences affectives. Il s'agit de "proto-représentations" à composantes somatiques hallucinatoires, dans lesquelles les expériences sensorimotrices de la nutrition, du portage et des soins corporels jouent un rôle prépondérant : incorporation, dévoration, persécution, puis, ultérieurement, omnipotence...
Ces formations phantasmatiques archaïques sont inaccessibles à l'investigation par voie associative verbale ; elles le sont par contre dans l'expérience d'expression plastique dans un dispositif psychothérapique approprié. Les phantasmes originaires constituent la première expérience organique non corporelle (psychogénétique) dont la structure servira de trame aux formations psychiques ultérieures.
La vie psychique proprement dite s'inaugure à partir du développement de la réussite ou de l'échec de la capacité du nourrisson à mettre en place une "matrice narrative" composée de formes affectives, mentalisées ou "sensorialisées", homothétiques au monde objectal (dont l'image de la mère va constituer le prototype).
C'est à l'issue de ce processus, opérateur de la dissolution de la dyade originaire, que va s'entamer l'étape suivante de l'épreuve identitaire qui aboutit à la mise en place de l'instance appelée "Je" : c'est cette expérience qui inscrit la dualité perceptuelle au sein de l'être.
Cette période va être dominée par les modalités psychiques "fantasmatiques" de la période œdipienne.
C'est au cours de cette période également que le jeune enfant va traverser les premières mises en demeure de domestiquer son activité instinctuelle, et d'intérioriser les interdits à l'expression manifeste de la pulsion. Entre la "poussée" instinctuelle et l'injonction répressive, le jeu psychique élabore des scénari résolutoires adressés au "Je".
Il convient de souligner que la censure peut également provenir d'objets internes subjectifs, et remplir cette fonction avec la même efficacité. - Lorsque, pour des raisons endogènes (conflit entre le "Je" et les produits psychiques), ou exogènes (répression exercée à l'encontre de l'activité psychique elle-même), le sujet est invalidé dans son fonctionnement spontané, il va alors développer une production symptomatique de type somatique, ou d'exacerbation psychique, au cours de laquelle l'activité fantasmatique va progressivement prendre le pas sur la perception du réel.
Dans cette perspective, le symptôme apparaît comme création de dernier recours ; comme ultime représentation de l'expérience affective interdite d'énonciation. C'est précisément à cet endroit que va se jouer le drame de la demande analytique.
@
Qui peut le cru
peut le cuit
... " Si le regard désinvestissait la scène extérieure pour se tourner exclusivement vers la scène originaire, il ne pourrait qu'y contempler, sidéré, ces images de la chose corporelle, cette force engendrant une image du monde devenue reflet d'un espace corporel, déchiré par des affects qui sont à chaque instant, et totalement, amour ou haine, action fusionnelle ou action destructive "...
Piéra Aulagnier
"La violence de l'interprétation"
Cette citation, probablement l'une des pensées les plus percutantes de Piéra Aulagnier, décrit de manière incisive ce dont il est question dans l'expérience créatrice, artistique ou thérapeutique, authentique.
Quelques brefs commentaires sur cette phrase-clé.
- Elle contient en réduction la totalité de la théorie du fonctionnement psychique proposée par Piéra Aulagnier, organisée en trois plans : l'"Originaire" (inconnaissable) ; le "Primaire" (niveau du "pictogramme" et des représentations) ; le "Je" (instance percevante).
Notons au passage que dans cette théorie architecturale (extrêmement construite) de Piéra Aulagnier, il est fait table rase du modèle topique Freudien. - Le "Si" inaugural donne à penser (et confirme) le postulat d'inaccessibilité de l'Originaire. Mais il donne aussi à entendre quelque chose de l'ordre du Désir, et laisse miroiter, à l'horizon théorique la splendide tentation du "péché originaire" : à savoir, que si tu ne vas pas à l'originaire, l'originaire vient à toi. Mais il est bien possible que le système de la psychanalyse, enkysté autour des stériles concepts de "castration" et de "pulsion de mort", soit définitivement hostile à comprendre que si l'Originaire est incorruptible à la curiosité du "Je", cela ne signifie pas que l'Originaire soit informulable. Simplement, il n'est pas formulable en mode verbal de représentation, qui est la modalité expressive du Moi. Il l'est, par contre, en mode d'Expression Créatrice. La preuve clinique en est faite quotidiennement dans les Ateliers d'Expression Créatrice. C'est le logiciel/psychanalyse qui est inadéquat à faire cracher l'originaire.
- Ce qui est donné à voir au regard du "Je" dans l'expérience créatrice (selon Aulagnier : "qui serait donné à voir si..."), c'est : d'une part,"l'image de la chose corporelle", le " reflet de l'espace corporel déchiré par des affects" ; et d'autre part, " cette force engendrant une image du monde" traversée par les affects primitifs de haine et d'amour . Mais on ne sait pas très bien si, pour Aulagnier, cette "force", cette énergie hypothétique de représentation, désigne la fonction affect. Pour ma part, l'expérience clinique me montre que ce qui surgit sur un mode éruptif de l'Originaire dans l'expérience d'Expression Créatrice, c'est la reconstitution de l'intrication de la pulsion et de l'affect sur la scène de la Création.
- Ajoutons, en clôture de ce commentaire, que cette " chose corporelle", cette psy-chose, est précisément ce qui est exposé à l'état nu, au "Je" de l'analyste/thérapeute par le sujet régressé, psychotique ou non-psychotique. N'oublions jamais que la psychose est agissement permanent d' une "mise-en-œuvre" psychique.
Il nous reste maintenant à répondre à une dernière question concernant la façon dont l'expérience créatrice vient déstabiliser l'organisation rigide des signifiants originaires ; et comment, à l'occasion du Jeu qu'elle y introduit, elle remanie les rapports entre le "Je" et le "Soi" ; comment elle réconcilie le sujet avec son expérience vécue ; et comment elle accomplit cette fonction médiante entre l'Originaire et l'élaboration psychique, qui est au cœur de tout travail analytique sérieux.
@
Le pet du diable
Créer suppose l'engagement libre et déterminé dans un processus de connaissance de Soi et d'intégration des éléments affectifs originaires qui compromettent la qualité de notre existence et entravent le plein exercice de nos potentialités vitales. Créer suppose une prise de risque de transformer totalement notre construction du réel et de renoncer aux pseudo-valeurs épuisantes auxquelles nous tentons d'amarrer notre destin.
Créer, à la différence de rêver, implique que l'éradication de la résistance soit accomplie par le sujet lui-même, alors que dans le rêve (et dans toutes les formes altérées de la conscience vigile) la chute de la résistance vient de l'absence du sujet (due à la mise hors circuit du système activateur ascendant pendant le sommeil).
Créer implique l'engagement corporel du sujet, c'est-à-dire le système de l'action, de l'agir physique . La mise sous tension et la mobilisation de l'énergie somatique a pour conséquence immédiate de mettre également en tension et en effervescence les "mnésies" corporelles (non-conscientes), et à réanimer les stases affectives qui leur sont associées. Créer va donc se traduire, dans un premier temps, par le développement d'un mal-être et par la mise en tension des résistances du "Je" à la reconstitution des évènements originaires qui ont marqué le développement.
Le processus central qui opère cette métamorphose de l'expérience affective en représentation a été remarquablement décrit par Michel Thévoz, exégète de l'Art Brut et conservateur de la collection Dubuffet à Lausanne, dans son livre "Art, Folie, Graffiti". Sous les termes d'" accession rétroactive à l'existence historique", Thévoz explique comment l'œuvre créatrice accomplit la transmutation de l'affect. Thévoz dit ceci :
..."La chronologie psychique n'obéit pas à la succession linéaire du temps historique ; elle contrevient au contraire à l'anamnèse médicale conventionnelle puisque le passé, le présent et le futur interfèrent continuellement. Tout se passe comme si la préhistoire infantile conservait son caractère lacunaire, suspensif, "en souffrance", attendant de l'élaboration phantasmatique adulte son accession rétro-active à l'existence historique".
Cette contrevention introduit un renversement de perspective considérable dans la question de la conduite du travail analytique/thérapique, dans la mesure où la recherche anamnétique n'apparaît plus comme la (seule) visée (possible) de la quête associative.
Bien au contraire, dans le travail analytique qui va prendre pour visée le Jeu psychique lui-même, tel qu'il s'élabore et se déploie, en particulier dans l'expérience créatrice spontanée, le surgissement des souvenirs traumatiques et le libre fonctionnement émotionnel viennent en aval de l'engagement créateur. L'affect, et les stases pulsionnelles qui y sont intriquées y trouvent leur dénouement. Le sujet fait alors l'expérience d'un intense déploiement énergétique susceptible d'investir les objets adéquats ; et il devient capable d'intégrer ces fragments de son histoire dans la mesure où ils ont perdu, dans le mouvement de leur révélation, leur charge d'angoisse et leur toxicité.
Thévoz ajoute ceci :
... "l'œuvre réalise une interaction féconde entre l'impulsion plastique et les événements irrésolus de la préhistoire infantile. Elle reste en communication réversible avec le passé psychique ; elle ne s'explique pas par lui ; elle l'explique au contraire, elle l'élabore... de sorte que si l'on tient à un enchaînement causal, il faudrait alors l'envisager dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de l'œuvre comme détermination productrice qui résoudrait le suspens originaire, et qui peuplerait le passé psychique comme si celui-ci avait attendu d'elle sa réalisation symbolique ".
Cette "accession rétro-active à l'existence historique" désigne parfaitement ce dont il est question dans toute expérience créatrice authentique, artistique ou thérapeutique. Comme le dit si bien Thévoz "L'artiste est artiste précisément dans son impulsion plastique à introduire du Jeu dans les signes à la faveur duquel une significations inédite, et sans doute involontaire, va s'approprier insensiblement des signifiants qui ne lui étaient pas primitivement destinés... L'œuvre d'art réalise la jonction d'une impulsion ludique et d'une signification inédite ou illégitime qui, à elles deux, ont raison de l'ordre canonique des signifiants" (op.cit.p.16 et 17).
Ce que Thévoz dit de l'artiste est parfaitement applicable au client en analyse, à la condition que l'aire d'expression que nous lui accordons (ou qu'il s'accorde) soit réellement construite comme un lieu favorable à l'investissement créateur, quel que soit le médium expressionnel choisi, verbe, corps, langages plastiques... Les termes d'" analyse transitionnelle" conviendraient parfaitement pour désigner une telle modalité de travail analytique.
Comment le fait de se placer en état de création provoque-t-il ces bouleversements? Quel est-il cet état magique qui déclenche un tel flux de jouissance que les digues dressées contre le libre exercice pulsionnel se desserrent progressivement, parfois brutalement, pour perdre toute raison d'être ?
Que se passe-t-il de tellement évident du côté de la satisfaction affective profonde pour que la personne qui a commencé à pénétrer dans cet état d'intense "æsthésie" accepte d'être envahie par ces fragments inconnus, angoissants et douloureux, de sa préhistoire de sujet ?
La réponse en est extrêmement simple : ce qui fonde cette audace, c'est que, dès l'instant où est surmontée la résistance liée au pressentiment de la violence intérieure que le sujet devra affronter, le travail de décharge affective commence. Et le sujet ressent cela immédiatement, et avec une telle acuité, qu'il comprend instinctivement qu'un processus régulateur fiable se met en mouvement. Toute personne qui crée, même en position psychiquement défendue, peut témoigner que lorsqu'elle est "à l'œuvre", elle est dans une qualité de présence au réel (au réel de sa propre expérience) qu'elle n'atteint que rarement dans la réalité, et qui lui donne la qualité de satisfaction "actuelle" que lui procurerait une pleine satisfaction charnelle amoureuse.
La personne qui crée est placée dans l'état paradoxal de ressentir simultanément la mise à jour et le déploiement de sa souffrance affective comme un intense soulagement.
Il n'y a pas d'autre réponse à ces interrogations. Et il n'y a pas d'autre possibilité de validation de cette analyse que d'y aller voir soi-même.
Ceci est une théorie de l'expérience : la mienne et celle des centaines de personnes qui m'ont offert leur confiance et dont j'ai pu observer le travail fécond de "crise" dans mes Ateliers d'Expression Créatrice depuis 1975.
@
Ad libidum
(du latin "désir à volonté")
Il n'est certes pas très convenable d'introduire le lecteur en fin d'émission, mais comme vous l'aurez compris si vous avez eu la patience de lire cette réflexion, la créativité psychique ne s'accommode pas de la convention.
Mon propos, au travers de cette "mise-à-plat", est de contribuer à la constitution d'une théorie de l'expérience créatrice, et d'une théorie des conditions opératoires de son développement dans les domaines de l'éducation, de l'art, de l'analyse et d travail thérapeutique. Le projet paraîtra peut-être prétentieux... cela ne me touche guère. Le terrain est vierge. La réflexion sur la Création et sur l'Art est restée un point aveugle de la recherche psychanalytique académique (il serait d'ailleurs passionnant de comprendre où s'articule cette résistance des intégristes du Freudisme à aller s'y soumettre, à ce travail dissolvant de l'expérience créatrice, dans les mêmes conditions de rigueur que celles dans laquelle ils sont censés s'être placés au moment de leur propre analyse).
Dans son état actuel d'élaboration, la théorie que je propose suppose la nécessité, pour le chercheur avancé qui pense la phénoménologie de la Création, de considérer qu'elle est inanalysable si l'on ne maîtrise pas une théorie claire du rapport affect/pulsion/représentation et du fonctionnement de la figuration psychique. La principale difficulté de cette obligation tient à ce que l'observation de l'expérience créatrice elle-même (non médiate et didactique), invalide le modèle explicatif Freudien traditionnellement admis de l'"appareil psychique". Et que cette "mise en doute" ne peut faire sens hors d'une expérience significative de l'engagement créateur.
Dans le fond, la "démonstration" que je fais ici est simple, même si le lecteur peut avoir l'impression que l'"appareil démonstratif" est encombrant. Cet écrit, réalisé d'une traite, sans remaniement, et sans consultation de mes textes antérieurs, me donne le sentiment d'une grande continuité dans les thèses que je développe. En particulier dans le souci qui est le mien de conceptualiser ma propre expérience, "à-typique", de créateur, de thérapeute et de formateur, et d'en soumettre les découvertes et les énoncés à la confrontation.
A ce Jeu excitant, je prends quelques risques épistémologiques avec le vieux bâtiment théorique. Les "pro" de la théorie y rongeront leur dentier : moi, je m'adresse à tous ceux qui sont à pied d'œuvre sur le terrain de l'éducation et du soin psycho-affectif, pour qu'ils sentent qu'il y a des alternatives aux hégémonies, aux exclusions, aux psychothérapies de classe, comme aux arsenaux chimiothérapiques ; qu'elles sont à leur portée pour peu qu'ils ne soient pas totalement englués dans les conformismes institutionnels ; que c'est cela la créativité: cette espèce d'effervescence corrosive, contagieuse et non domesticable, seule capable de déstabiliser les défenses institutionnelles chroniques, érigées en codes du travail et de l'immobilité, qui régimentent les deux institutions les plus nocives pour la Liberté, pour la Culture, et pour l'Economie même : l'Educationationale, qui ne parvient pas, réforme après réforme, à comprendre les exigences d'une pédagogie réellement créatrice, et qui n'arrive pas, surtout, à surmonter les puissantes résistances au changement du "corps" enseignant affairé à protéger ses pauvres privilèges et représentations archaïques de leur métier ; et la Psychiatrie traditionnelle dans ses fringues néo-aliénistes et comportementalistes.
Montêton, le 23 août 1990
Article édité par la Revue "PRATIQUES CORPORELLES" 1991
revisité pendant la période de confinement du mois de Mars 2020
Société Française d'Éducation et de Rééducation Psycho-motrice